 Michel Embareck aime les escrocs. Enfin, encore faut-il s’entendre sur la notion, qui exclut le syndrome Cahuzac par exemple et dont Bernard Malakoff, cet ancien plombier devenu Président d‘une grosse société d’investissement, à Wall Street, serait la figure emblématique, quelque chose du moins comme le Saint Patron bien mérité du monde de la finance contemporaine…
Michel Embareck aime les escrocs. Enfin, encore faut-il s’entendre sur la notion, qui exclut le syndrome Cahuzac par exemple et dont Bernard Malakoff, cet ancien plombier devenu Président d‘une grosse société d’investissement, à Wall Street, serait la figure emblématique, quelque chose du moins comme le Saint Patron bien mérité du monde de la finance contemporaine…
L’escroc, à tout prendre, paraîtrait donc sympathique. Et Michel Embareck de nous rappeler parmi ces arnaques de haut vol qu’il nous conte, cette femme dépourvue de tout diplôme qui a fini par délivrer quelques quatre cent expertises psychologiques à la Cour d‘Appel de Bordeaux, avant d’être confondue…
Il aime les escrocs pour leur douce folie, leur bagout, leur aplomb, pour ce culot de "vendeurs illégaux de rêves" qui ont placé l’imagination au poste de commandement et au service d’une cause toujours nécessairement perdue. C’est que l’échappée serait moins belle s’il n’y avait sa révélation presque joviale devant les tribunaux, l’escroc siégeant à son procès comme dans son jardin, pariant encore, une dernière pour la route, qu’il entortillera cette fois le juge.
Il y aurait ainsi quelque chose de désintéressé dans l’escroc, qui préfère la construction énergumène de l’escroquerie à son résultat, l’art au métier. Un professionnel à la longue, car il faut du métier pour réussir, sinon un véritable expert, parfait connaisseur des rouages du monde qu’il veut déshabiller.
Mythomane, en grand le plus souvent, imposteur de talent, forcément, s’emparant de la crédulité de ses interlocuteurs pour dévoiler accessoirement la cupidité humaine. Toujours réactif donc, à l’écoute, prenant le pouls du monde, cherchant les interstices pour s’y loger sans scrupule. Une figure du temps présent en somme, empoignant l’offre sans ménagement, construisant la demande, leurrant chaque jour un peu mieux ses semblables, casant le monde là où il a voulu être pour en libérer la formidable vacuité, et débrider enfin son goût de l’anecdote.
Et l’auteur de jubiler lui-même au récit des boniments que l’escroc épand inlassablement. Bluffs, esbroufes, épates… Quoi de plus savoureux pour la langue ? C’est l’art du conteur qui vient ici se poster au chevet de cette figure de baladin. Scénarisant les affaires judiciaires qu’il a suivies, Embareck donne voix à ses personnages avec une gourmandise d’écriture étourdissante. Quelle voix ! Gaillarde, alerte, minutieuse, incarnant à merveille le type même de l’escroc, ses tactiques, ses discours, son vocabulaire. Quel festival ! On y croit bien sûr, pas un propos qui ne soit vrai.
Mais n’allez pas vous imaginer que le registre soit exclusivement loufoque. Embareck nous conte aussi ces milliers de tonnes de blé en provenance de Tchernobyl, refourgué pour du bio… Là c’est moins drôle. Qui donne du blé à moudre sur notre crédulité collective, le discernement politique et ce qu’il est devenu, cette dimension du sens que nous n’osons pas être.
Faux certificats d’authentification bio, ça marche et l’auteur d’asséner que dans cette affaire, "aucune expertise ne fut demandée afin de déceler l’hypothétique présence de substances radioactives"… Vieille de plus de dix ans, le dossier n’a toujours pas été jugé !
Abuseurs de biens sociaux, truqueurs de marchés publics, à l’un des bouts de cette pelote, Michel Embareck n’oublie pas qu’il y a quelque chose comme le Quercy sinistré par un modèle économique assassin. C’est toute une vision sociale dans laquelle il nous embarque mine de rien. Celle des petits boulots, des emplois précaires, du chômage qui frappe durement des millions de gens, oubliés de la République et "qui ont fait de la résignation et du renoncement une philosophie adaptée à la précarité du quotidien". Edifiantes sautes d’écriture, alternant la dérision et la gravité, diversifiant les registres pour ne pas oublier que ces hommes qui fourguent à grande échelle des DC10 ou des médicaments périmés à l’Afrique sont les symptômes d’un monde déjà beaucoup moins drôle.
Très chers escrocs : Fausse banque, faux blé bio, faux flics, faux trésor..., de Michel Embareck, L'Ecailler, 11 avril 2013, Collection : L'Ecailler Documents, 171 pages, 17 euros, ISBN-13: 978-2364760257.



 Les frères Boniface. Superbe page du rugby français !
Les frères Boniface. Superbe page du rugby français !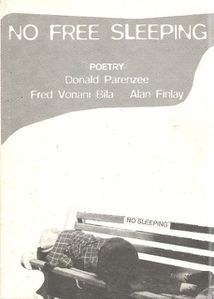 "C’est le silence étouffant
"C’est le silence étouffant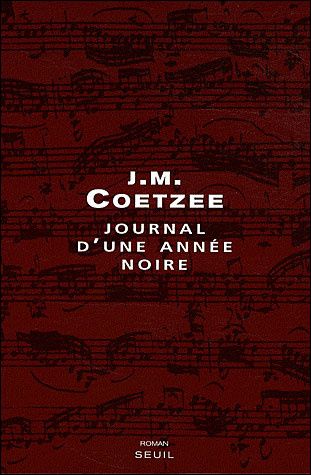 Avec Disgrâce, on devinait un Coetzee à l’étroit dans sa narration. Et pas uniquement parce que le sujet l’embarquait sur les lisières d’une langue exténuée. L’exténuation était profonde, rejoignant les thèmes affrontés, celui du vieillissement en particulier. Or voici que dans ce Journal, le même thème revient, plus insistant, plus obsédant, empoignant le statut de l’auteur jusqu’à voir dans la forme physique la condition même de l’exercice narratif.
Avec Disgrâce, on devinait un Coetzee à l’étroit dans sa narration. Et pas uniquement parce que le sujet l’embarquait sur les lisières d’une langue exténuée. L’exténuation était profonde, rejoignant les thèmes affrontés, celui du vieillissement en particulier. Or voici que dans ce Journal, le même thème revient, plus insistant, plus obsédant, empoignant le statut de l’auteur jusqu’à voir dans la forme physique la condition même de l’exercice narratif. Disgrâce (Booker Price 99, le second qu’obtenait Coetzee) est paru en français au moment où ce dernier quittait l’Afrique du Sud pour l’Australie. Avec une audace incroyable, Coetzee défriche de nouvelles exigences pour cette société nouvelle qui surgit en Afrique du Sud, qui se doit de lutter contre toutes les oppressions, sans complaisance. Il n'hésite ainsi pas à pointer la violence aveugle du ressentiment qui transforme parfois les anciens esclaves en bourreaux.
Disgrâce (Booker Price 99, le second qu’obtenait Coetzee) est paru en français au moment où ce dernier quittait l’Afrique du Sud pour l’Australie. Avec une audace incroyable, Coetzee défriche de nouvelles exigences pour cette société nouvelle qui surgit en Afrique du Sud, qui se doit de lutter contre toutes les oppressions, sans complaisance. Il n'hésite ainsi pas à pointer la violence aveugle du ressentiment qui transforme parfois les anciens esclaves en bourreaux. Peu à peu et non sans combats douloureux, l’Afrique a fini par se libérer du joug occidental. Avec la fin du colonialisme, toute la littérature en provenance de ses régions aura été imprégnée d’un très légitime esprit anti-colonialiste qui faisait la part belle à la culpabilité de l’occident. Les peuples exploités sans vergogne ont ainsi trouvé une légitimation à leur révolte dans cette littérature de libération nationale. Mais si le monde contemporain s’est construit sur le modèle oppresseurs/opprimés, reste que les choses n’étaient pas si simples. Alexandra Fuller appartenait au camp des Afrikaners. Il y a vingt ans, nul ne se serait intéressé à ce genre de littérature. Or ce témoignage, d’une rare beauté, écrit dans une langue limpide, ouvre justement à ce refoulement occidental et nous présente une figure inédite de la littérature post-coloniale : celle du petit blanc. C’est cet univers interdit d’existence, au-delà de toute identité mais traversé par une "africanité" aussi improbable que déchirée, qu’elle nous conte avec un rare talent, nous donnant à voir la beauté de l’humain dans sa fragilité la plus pure.
Peu à peu et non sans combats douloureux, l’Afrique a fini par se libérer du joug occidental. Avec la fin du colonialisme, toute la littérature en provenance de ses régions aura été imprégnée d’un très légitime esprit anti-colonialiste qui faisait la part belle à la culpabilité de l’occident. Les peuples exploités sans vergogne ont ainsi trouvé une légitimation à leur révolte dans cette littérature de libération nationale. Mais si le monde contemporain s’est construit sur le modèle oppresseurs/opprimés, reste que les choses n’étaient pas si simples. Alexandra Fuller appartenait au camp des Afrikaners. Il y a vingt ans, nul ne se serait intéressé à ce genre de littérature. Or ce témoignage, d’une rare beauté, écrit dans une langue limpide, ouvre justement à ce refoulement occidental et nous présente une figure inédite de la littérature post-coloniale : celle du petit blanc. C’est cet univers interdit d’existence, au-delà de toute identité mais traversé par une "africanité" aussi improbable que déchirée, qu’elle nous conte avec un rare talent, nous donnant à voir la beauté de l’humain dans sa fragilité la plus pure.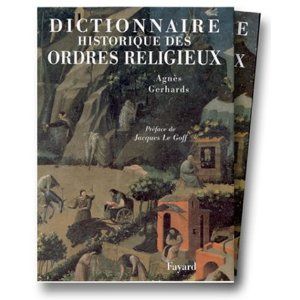 Qui saurait encore, aujourd'hui, définir avec précision ce que fut l'ascèse monastique, les enjeux théologiques mais aussi intellectuels, entre la règle de Saint Benoît et celle de Saint Augustin ? Qui saurait évaluer ce que fut la formidable aventure des Ordres Mendiants et ses conséquences sur la société médiévale ? Qui saurait expliquer comment les moines ont créé l'emploi du temps et quelles en furent les conséquences pour l'homme du monde occidental ? Le Dictionnaire d'Agnès Gerhards, déjà auteur d'un remarquable Dictionnaire de la société médiévale, situe avec précision les enjeux de connaissance qui nous permettent de mieux comprendre les fondements de notre civilisation, tout en rappelant la vocation spirituelle mais aussi la force d'entraînement de la société monachique, favorisant largement l'évolution économique de la société médiévale.
Qui saurait encore, aujourd'hui, définir avec précision ce que fut l'ascèse monastique, les enjeux théologiques mais aussi intellectuels, entre la règle de Saint Benoît et celle de Saint Augustin ? Qui saurait évaluer ce que fut la formidable aventure des Ordres Mendiants et ses conséquences sur la société médiévale ? Qui saurait expliquer comment les moines ont créé l'emploi du temps et quelles en furent les conséquences pour l'homme du monde occidental ? Le Dictionnaire d'Agnès Gerhards, déjà auteur d'un remarquable Dictionnaire de la société médiévale, situe avec précision les enjeux de connaissance qui nous permettent de mieux comprendre les fondements de notre civilisation, tout en rappelant la vocation spirituelle mais aussi la force d'entraînement de la société monachique, favorisant largement l'évolution économique de la société médiévale. J’avais pris goût à rester immobile, couché dans la prairie.
J’avais pris goût à rester immobile, couché dans la prairie. "Pièce d’étoffe longue et étroite déplacée dans l’espace" (Larousse, 1874). De la bannière au bandeau, c’est toute l’histoire du renouvellement des formes de l’écriture qui nous est offerte dans cet essai. Une histoire populaire avant tout, qui doit tout à la rue, au fond le seul théâtre légitime du politique. Depuis plus d’un siècle, la banderole aura ainsi dit les fêtes, les luttes, les grèves, les insurrections. Outil de contestation, elle fut inventée par des prolétaires qui décidèrent de s’emparer de la ville, et de leur destin.
"Pièce d’étoffe longue et étroite déplacée dans l’espace" (Larousse, 1874). De la bannière au bandeau, c’est toute l’histoire du renouvellement des formes de l’écriture qui nous est offerte dans cet essai. Une histoire populaire avant tout, qui doit tout à la rue, au fond le seul théâtre légitime du politique. Depuis plus d’un siècle, la banderole aura ainsi dit les fêtes, les luttes, les grèves, les insurrections. Outil de contestation, elle fut inventée par des prolétaires qui décidèrent de s’emparer de la ville, et de leur destin. Lyon. La canicule. Un ancien préfet, placé hors cadre, est découvert dans son appartement, mort. L’affaire est délicate : la République n’aime guère ce genre de publicité. Le commandant Farel s’en voit chargé. Une exécution, à ses yeux. Mise en scène. Lamentablement. Farel déploie son équipe. La routine qu’ils ont adoptée et d’une efficacité redoutable. Très vite sont mis à jour les collusions d’intérêts –on y est- qui voyaient le préfet emprunter discrètement les allées de la Finance privée : il jouait de son vivant les facilitateurs auprès du business immobilier. Les Affaires. On y est, le décor est planté de cette France du fric où les énarques godillent sans vergogne entre intérêts privés et publics.
Lyon. La canicule. Un ancien préfet, placé hors cadre, est découvert dans son appartement, mort. L’affaire est délicate : la République n’aime guère ce genre de publicité. Le commandant Farel s’en voit chargé. Une exécution, à ses yeux. Mise en scène. Lamentablement. Farel déploie son équipe. La routine qu’ils ont adoptée et d’une efficacité redoutable. Très vite sont mis à jour les collusions d’intérêts –on y est- qui voyaient le préfet emprunter discrètement les allées de la Finance privée : il jouait de son vivant les facilitateurs auprès du business immobilier. Les Affaires. On y est, le décor est planté de cette France du fric où les énarques godillent sans vergogne entre intérêts privés et publics.