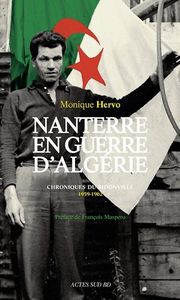 "A l’une des extrémités du terrain vague, côté gare de triage, de nombreuses cabanes sont la proie des flammes. Quarante ouvriers algériens n’ont plus d’abris. Pas relogés. Où vont-ils dormir ce soir ?"
"A l’une des extrémités du terrain vague, côté gare de triage, de nombreuses cabanes sont la proie des flammes. Quarante ouvriers algériens n’ont plus d’abris. Pas relogés. Où vont-ils dormir ce soir ?"
Vous avez bien lu : on est en France, en 1959, et on parle de gare de triage d’êtres humains.
Monique Hervo a une vingtaine d’années. Elle vient d’être diplômée de l’école des Beaux-Arts de Paris, en même temps que César. Son carnet de commande est déjà plein, mais elle, qui se rappelle ses longues journées passées à attendre en vain le retour de sa famille des camps nazis sur le quai de la gare de l’Est, tourne le dos à la vie d’artiste et de confort qui lui tend les bras pour lui préférer une vie d’engagement social. Monique entre au Service Civil International, une sorte d’ONG avant l’heure, qui s’est donné pour mission de soulager la souffrance des immigrés algériens parqués dans les bidonvilles français.
De 1959 à 1962, elle tiendra le journal de celui dénommé La Folie. A Nanterre. Rue de la garenne. A trente minutes à l’époque de Paris. Où des dizaines de milliers d’algériens survivent et meurent dans des conditions d’effroi quotidien.
Jusque là, les ouvriers algériens mouraient sous les ponts de Paris. Ou bien se terraient dans les champignonnières des environs de la capitale. Des grottes humides et froides. Ils venaient des camps ouverts à la hâte par l’Administration française en Algérie pour accueillir les populations dont l’armée avait rasé les villages. Ou bien des camps français dits "centre d’assignation à résidences" où, derrière des barbelés, des miradors, on avait entassé les algériens récalcitrants ou suspectés d’appartenir au FLN. Dans les années 1950, il en existait de nombreux en France, où des hommes mouraient des sévices et des privations qui leur étaient infligés sous des prétextes jamais vraiment vérifiés, comme à Saint-Maurice l’Ardoise, dans le Larzac ou à Vedenay. Sur simple décision administrative, on vous y déportait en attendant un très hypothétique jugement.
 Ceux du bidonville de Nanterre étaient pour la plupart des travailleurs salariés, ouvriers des papeteries de la Seine, des usines Simca ou des Entrepôts de tabacs…
Ceux du bidonville de Nanterre étaient pour la plupart des travailleurs salariés, ouvriers des papeteries de la Seine, des usines Simca ou des Entrepôts de tabacs…
Tout un système de servage s’était alors mis en place dans cette France des Trente Glorieuses pour asservir les populations immigrées de l’Empire colonial, celui d’un Etat d’exception qui développait ouvertement sa politique d’exactions.
La presse nationale, quant à elle, servait aux bons français éprouvés par la guerre le mirage des Trente Glorieuses et parlait des "tanières" des nord-africains que la police, fort heureusement, "quadrillait", "ratissait", "nettoyait"… On ne parlait pas des "rafles" qu’elle y perpétrait, elle qui savait si bien, depuis 42, les organiser, Papon aux commandes.
C’est que "les sidis étaient lâchés", affirmait cette presse insane qui parlait d’une "invasion barbare", de sauvages aux appétits sexuels monstrueux. Mais ne disait rien des campagnes de racolage promues par les barons de l’industrie française et leurs sbires politiques, en Algérie même, pour faire miroiter le mode de vie français à des familles algériennes terrorisées dans les camps qu’ont leur avait installés déjà là-bas, et à qui on ne donnait guère le choix qu’entre le pire et l’épouvantable.
La Folie, c’était donc dangereux. Monique Hervo est alors une toute jeune fille. Elle s’y rend seule et va y vivre trois ans sans jamais subir la moindre agression. Les coups, c’est la police française qui les lui assénera, aux yeux de laquelle elle ne peut être qu’une putain de si bien savoir se débrouiller parmi les "ratons"…
 "La Guerre d’Algérie, je l’ai rencontrée dans toute son horreur, ici en France. A Nanterre."
"La Guerre d’Algérie, je l’ai rencontrée dans toute son horreur, ici en France. A Nanterre."
Son témoignage est hallucinant. Et donne envie de vomir. De déchirer pour le coup sa carte d’identité française. Malnutrition, maladies endémiques. La tuberculose sévit dans le camp, sans que l’Administration française ne s’en soucie.
1959. Monique Hervo note dans son journal le quotidien de ces familles abandonnées à une survie aussi affreuse dans cette agglomération de papiers goudronnés. Elle décrit les talus et la pierraille, le large fossé qui encercle le bidonville, un gigantesque cloaque d’eau pourrie, réalisation de l’Administration française.
"12 août 1959. Je traverse le Bois de Boulogne à mobylette. A couvert du feuillage, cinq agents matraquent deux arabes."
Au détour d’une ruelle, Monique tombe sur Fatima, qui joue aux osselets devant la porte de sa baraque. Fatima rêve d’aller un jour à l’école. Le soir, les cars de CRS se rangent le long de la rue de la Garenne. Des projecteurs sont braqués sur le bidonville, allumés en pleine nuit. Une centaine d’hommes font la queue pour puiser de l’eau à l’unique borne fontaine du camp. Les haut-parleurs de la police hurlent leurs ordres. En 59, le pouvoir civil passe la main au pouvoir militaire pour le contrôle et la surveillance du bidonville de La Folie. L’armée entre dans le camp. Monique raconte, les efforts désespérés des gens qui vivent là, ces parents qui ont installé un tableau noir dans un secteur du bidonville pour tenter d’éduquer les enfants. Le courage. La solidarité. L’hospitalité. les petits commerces solidaires, les gens n'ont rien mais le partagent encore. Autour des bidonvilles, là où les enfants viennent jouer, Monique Hervo découvre des pièges à loup posés par les habitants de Nanterre. A trois kilomètres des Champs Elysées. Quelles proies voulaient-ils mutiler ?
Le lendemain, elle est dans un bar de Nanterre, côté "blancs". Un incendie ravage un secteur du bidonville : "qu’ils grillent dans leurs cabanes!", s’amusent les consommateurs.
"Devant eux, chaque jour, ils voient passer les gamins qui vont chercher de l’eau à la borne fontaine, rue de Chevreul. Les gros rires de satisfaction sont terrifiants. Vous laissent impuissants devant tant de haine."
 Les hommes, les femmes, les enfants accourent de tous les coins du bidonville pour tenter d’éteindre l’incendie. Sous les regards goguenards de la police et des habitants blancs de Colombes.
Les hommes, les femmes, les enfants accourent de tous les coins du bidonville pour tenter d’éteindre l’incendie. Sous les regards goguenards de la police et des habitants blancs de Colombes.
La nuit, les bergers allemands de la police sont lâchés dans le bidonville. Les flics, armés jusqu’aux dents, cassent des cabanes, tirent les enfants de leur sommeil. Tirent sans sommation sur des algériens. Les chiens, les projecteurs, les bruits de bottes, les sifflets, les cris, les coups de feu… L’opération de "ratissage" du 11 janvier 1961 ne donnera rien. La police cherchait des armes, elle ne débusquera que des gamins endormis, bousculés sans ménagement tandis que les bulldozers rasent tout un secteur de La Folie. Nul n’ayant le droit de sauver ses affaires, un grand trou est creusé où tout est enfoui…
Le 18 décembre a été décrété Journée Internationale des Migrants. Une date choisie par l’ONU pour promouvoir la convention adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990, restée inapplicable faute de ratifications suffisantes - la France ne l’a toujours pas ratifiée...
Cette Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille concerne tous les migrants qui ont, qui exercent ou qui vont exercer un travail "pendant tout le processus de migration". Tous. Avec ou sans papiers. Leur affirmant des droits fondamentaux en considération de "la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent fréquemment les travailleurs migrants et les membres de leurs familles". Ce devrait être la journée de la honte, pour un pays tel que le nôtre…
Nanterre en guerre d'Algérie, Chroniques du bidonville 1959-1962, Monique Hervo, préface de François Maspero, éditions Actes Sud, octobre 2012, 256 pages, 23 euros, ISBN-13: 978-2330012854.
Images : photo du camp de Saint-Maurice l’Ardoise et du bidonville de Nanterre.



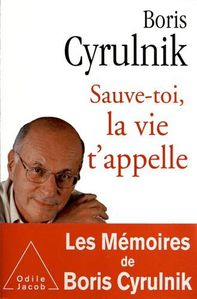 La clef du passé, c’est le présent. Ce présent que construit Boris Cyrulnik, ce présent qu’il instruit littéralement dans ce récit de vie. Un présent structuré par notre relation au monde, à autrui, un présent qui a renoncé non pas aux égarements ni aux erreurs de jugement, mais aux dangereuses abstractions utopiques auxquelles nous aimons tant nous soumettre quand nous coupant les choses du passé de la réalité pour en faire des blessures autour desquelles tourner sans cesse. Un présent au cœur duquel insérer, vivre la cohérence narrative d’un récit qui tirera sa force de l’harmonie que nous aurons su bâtir entre les récits de soi et les récits d’alentour.
La clef du passé, c’est le présent. Ce présent que construit Boris Cyrulnik, ce présent qu’il instruit littéralement dans ce récit de vie. Un présent structuré par notre relation au monde, à autrui, un présent qui a renoncé non pas aux égarements ni aux erreurs de jugement, mais aux dangereuses abstractions utopiques auxquelles nous aimons tant nous soumettre quand nous coupant les choses du passé de la réalité pour en faire des blessures autour desquelles tourner sans cesse. Un présent au cœur duquel insérer, vivre la cohérence narrative d’un récit qui tirera sa force de l’harmonie que nous aurons su bâtir entre les récits de soi et les récits d’alentour. C’est au fond le plus important de cet ouvrage pour nous, que cette modalité d’écriture que nous voyons s’effectuer au fil des pages, balançant entre les lésions de l’enfance et le relèvement que la science apporte et qui contribue, elle aussi, à fabriquer cette chimère de soi qui permet d’échapper au trauma de la mémoire.
C’est au fond le plus important de cet ouvrage pour nous, que cette modalité d’écriture que nous voyons s’effectuer au fil des pages, balançant entre les lésions de l’enfance et le relèvement que la science apporte et qui contribue, elle aussi, à fabriquer cette chimère de soi qui permet d’échapper au trauma de la mémoire. Il faut donc s’évader, échapper au poids des images traumatiques. La clinique du traumatisme décrit une mémoire singulière : intrusive. Une mémoire qui modifie le fonctionnement même du cerveau, explique Cyrulnik. Centrée sur une image claire entourée de perceptions floues, elle impose l’horreur de la sidération visuelle. Elle barre, biffe, empêche que le langage, dans son aptitude à verbaliser, ne puisse aider à prendre la distance salvatrice qui nous soustraira aux images terrifiantes qui ne cessent de tétaniser l’être. «Tous les traumatisés ont une claire mémoire d’images et une mauvaise mémoire des mots », nous dit-il encore. Mais «les enfants dans la guerre ne sont pas les enfants de la guerre » : nous pouvons, nous devons, que l’on nous y aide ou non, chercher ailleurs des solutions. Ce peut être la fonction des ordalies intimes lorsque manque l’analyste qui viendra sceller la possibilité d’un récit de soi cohérent. Au moment où la douleur se re-présente, nous n’avons parfois que très peu de moyens à notre disposition. Boris Cyrulnik voit très bien comment ce courage morbide lui fit reprendre ses études par exemple, lui qui a choisi cette voie difficile à celle qui l’aurait soumis à la compassion mutilante que l’entourage propose trop souvent. Il faut pouvoir se faire témoin plutôt que martyr, bien que l’étymologie des deux mots soit identique : l’un est marqué, l’autre se dé-marque dans la distance qu’impose le témoignage. Car ce n’est qu’après coup qu’il est vraiment possible, dans la représentation du trauma vécu, d’affronter sa douleur. Dans cette créativité du témoin, comme lieu de résilience entre l’assemblage des images par trop précises et un halo de mots qu’il faut peu à peu arracher au trauma. C’est tout l’enjeu de ce travail d’écriture, dont la structure rhapsodique montre assez comment il se relance, tournant autour des mêmes images traumatisantes pour se défaire du poids de leur sidération par l’attention de l’explication savante
Il faut donc s’évader, échapper au poids des images traumatiques. La clinique du traumatisme décrit une mémoire singulière : intrusive. Une mémoire qui modifie le fonctionnement même du cerveau, explique Cyrulnik. Centrée sur une image claire entourée de perceptions floues, elle impose l’horreur de la sidération visuelle. Elle barre, biffe, empêche que le langage, dans son aptitude à verbaliser, ne puisse aider à prendre la distance salvatrice qui nous soustraira aux images terrifiantes qui ne cessent de tétaniser l’être. «Tous les traumatisés ont une claire mémoire d’images et une mauvaise mémoire des mots », nous dit-il encore. Mais «les enfants dans la guerre ne sont pas les enfants de la guerre » : nous pouvons, nous devons, que l’on nous y aide ou non, chercher ailleurs des solutions. Ce peut être la fonction des ordalies intimes lorsque manque l’analyste qui viendra sceller la possibilité d’un récit de soi cohérent. Au moment où la douleur se re-présente, nous n’avons parfois que très peu de moyens à notre disposition. Boris Cyrulnik voit très bien comment ce courage morbide lui fit reprendre ses études par exemple, lui qui a choisi cette voie difficile à celle qui l’aurait soumis à la compassion mutilante que l’entourage propose trop souvent. Il faut pouvoir se faire témoin plutôt que martyr, bien que l’étymologie des deux mots soit identique : l’un est marqué, l’autre se dé-marque dans la distance qu’impose le témoignage. Car ce n’est qu’après coup qu’il est vraiment possible, dans la représentation du trauma vécu, d’affronter sa douleur. Dans cette créativité du témoin, comme lieu de résilience entre l’assemblage des images par trop précises et un halo de mots qu’il faut peu à peu arracher au trauma. C’est tout l’enjeu de ce travail d’écriture, dont la structure rhapsodique montre assez comment il se relance, tournant autour des mêmes images traumatisantes pour se défaire du poids de leur sidération par l’attention de l’explication savante  Une anthologie. Poètes français en guerre contre la sale Guerre, d’Aragon à Seghers, amis de Maurice Audin lui rendant hommage, poètes algériens enfin, de Djammel Amrani à Malek Haddad, écrivant en français ou en arabe.
Une anthologie. Poètes français en guerre contre la sale Guerre, d’Aragon à Seghers, amis de Maurice Audin lui rendant hommage, poètes algériens enfin, de Djammel Amrani à Malek Haddad, écrivant en français ou en arabe. C
C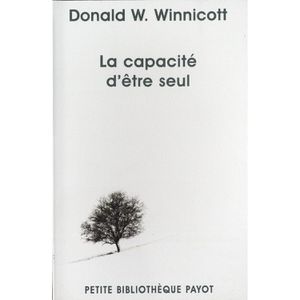 L’ouvrage est technique, plutôt qu’inscrit dans on ne sait quelle philosophie de la vie, voire compulsion à la sagesse new age recyclant tout texte ouvert à l’expérience de soi en bréviaire d’une assomption laborieuse.
L’ouvrage est technique, plutôt qu’inscrit dans on ne sait quelle philosophie de la vie, voire compulsion à la sagesse new age recyclant tout texte ouvert à l’expérience de soi en bréviaire d’une assomption laborieuse. Winnicott décrit cette solitude comme "un état sans orientation", où l’être s’ouvre d’un coup à une expérience toute "instinctuelle". Que faire de ce vocabulaire, de cet "instinctuel" jaillit d’on ne sait trop quelle pulsion ? Que faire de cette pulsion, de ce moment où sa venue s’impose en nous comme réelle et seule vraie expérience personnelle ? Une pulsion ? Je comprends bien, oui, que dans cette solitude, je ressente ce qui m’envahit comme m’étant propre plutôt que d’un autre, ou d’un lieu qui ne serait pas le mien. Pourtant… Winnicott affirme également que "l’état de solitude est un état qui (paradoxalement) implique toujours la présence de quelqu’un d’autre". La mère, évidemment. Et dont l’introjection maintiendrait de bout en bout la possibilité d’être seul. (En prenant garde que cette introjection ne recouvre pas tout, au point de se muer en pathologie, comme dans l’orgasme de l’extase que convoque Winicott). La mère donc, sa présence indicielle plutôt, marque, trace, mémoire, on ne sait trop. Pouvoir être seul donc, plutôt que l’être. Dans cette présence confiante, différée, asymétrique sinon dissymétrique, de la mère qui peut ne plus être, là, inaugurale pourtant, qui fait que l’on n’est plus jeté là (Dasein) dans le monde puisqu’elle a précédé ce jeté.
Winnicott décrit cette solitude comme "un état sans orientation", où l’être s’ouvre d’un coup à une expérience toute "instinctuelle". Que faire de ce vocabulaire, de cet "instinctuel" jaillit d’on ne sait trop quelle pulsion ? Que faire de cette pulsion, de ce moment où sa venue s’impose en nous comme réelle et seule vraie expérience personnelle ? Une pulsion ? Je comprends bien, oui, que dans cette solitude, je ressente ce qui m’envahit comme m’étant propre plutôt que d’un autre, ou d’un lieu qui ne serait pas le mien. Pourtant… Winnicott affirme également que "l’état de solitude est un état qui (paradoxalement) implique toujours la présence de quelqu’un d’autre". La mère, évidemment. Et dont l’introjection maintiendrait de bout en bout la possibilité d’être seul. (En prenant garde que cette introjection ne recouvre pas tout, au point de se muer en pathologie, comme dans l’orgasme de l’extase que convoque Winicott). La mère donc, sa présence indicielle plutôt, marque, trace, mémoire, on ne sait trop. Pouvoir être seul donc, plutôt que l’être. Dans cette présence confiante, différée, asymétrique sinon dissymétrique, de la mère qui peut ne plus être, là, inaugurale pourtant, qui fait que l’on n’est plus jeté là (Dasein) dans le monde puisqu’elle a précédé ce jeté. Edition revue et augmentée, mais toujours aussi pessimiste quant à nos chances de rompre avec la contre-révolution néolibérale qui a fini par s’imposer presque partout dans le monde.
Edition revue et augmentée, mais toujours aussi pessimiste quant à nos chances de rompre avec la contre-révolution néolibérale qui a fini par s’imposer presque partout dans le monde. Deux nouvelles introuvables de celui qui vitupérait contre la presse, agacé qu’on le prît pour un bon samaritain bourré et qui, quoi qu’il arrive, par-delà la culpabilité, l’alcool et les signes divers, tenait bon quand le monde se laissait, lui, gagner par une sorte d’hystérie.
Deux nouvelles introuvables de celui qui vitupérait contre la presse, agacé qu’on le prît pour un bon samaritain bourré et qui, quoi qu’il arrive, par-delà la culpabilité, l’alcool et les signes divers, tenait bon quand le monde se laissait, lui, gagner par une sorte d’hystérie. Corps et âme, lisez Lowry, suez en lui ces gouttes qui montent au visage de l’agonie. Mâchez ses mots, si matériels qu’ils en percutent les corps et laissez-vous porter par le rythme de sa phrase, à bout de souffle logeant l’homme dans sa démesure.
Corps et âme, lisez Lowry, suez en lui ces gouttes qui montent au visage de l’agonie. Mâchez ses mots, si matériels qu’ils en percutent les corps et laissez-vous porter par le rythme de sa phrase, à bout de souffle logeant l’homme dans sa démesure. "Nous avons réussi !", s’exclamaient au petit jour les militants d’Heathrow.
"Nous avons réussi !", s’exclamaient au petit jour les militants d’Heathrow.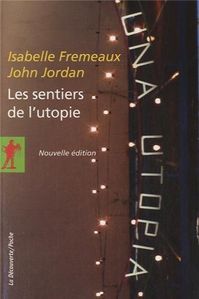 Une poignée de militants ont décidé d’investir les lieux pour y dresser un camp temporaire. L’info a percé jusqu’aux oreilles de la police bien évidemment. Qui est sur les dents. Un camp doit donc être dressé, dans la nuit, et pour dix jours. Un éco-village autogéré. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Pendant dix jours, il sera transformé en lieu de formation, de fête, de débats. Un autre monde est possible. Nous pouvons désobéir. Refuser leur monde. Trois personnes seulement savent exactement où ce camp sera monté. La police enquête, fouine, sans succès. Cent cinquante autres militants attendent l’info. Ils forment le "groupe terrain" et sont prêts à investir les lieux à partir de dix endroits différents. Ils attendent le signal et la localisation du lieu, qui leur sera envoyé par sms. Des camions attendent également loin d’Heatrow, leurs soutes pleines des chapiteaux qu’il faudra monter en un temps record, des cuisines, des sanitaires, des centaines de tentes qui vont recouvrir tout l’espace proposé à la destruction . Et chacun des cent cinquante militants du groupe terrain a en charge de prévenir des dizaines d’autres activistes disséminés dans Londres. Ceux-là sont regroupés par paires. Beaucoup patientent dans le métro. Chaque trajet est différent, les consignes sont claires : il faut partir dans la mauvaise direction, prendre la mauvais quai, monter au dernier moment dans la bonne rame. La police est sur les dents, partout, mais partout elle ne sait où donner de la tête. Des centaines d’activistes marchent déjà. L’opération Singe rugissant est déclenchée. Les barnums sont déchargés. La police reste sur les dents. Elle est partie dans la mauvaise direction dans une belle pagaille, tandis que les militants du groupe terrain montent déjà les chapiteaux. A l’aube, tout est en place. L’équipe média au centre, qui expédie déjà ses communiqués à la presse mondiale. Trois immenses chapiteaux sont en place, les cuisines fonctionnent, bientôt des centaines de tentes se dressent. Les militants d’Heathrow ont quatre objectifs : démontrer que l’empreinte écologique d’un tel camp est dérisoire, se former théoriquement et pratiquement, construire un mouvement radical pour la justice climatique. Un système de quartiers forme la structure du camp. Au centre de chaque quartier, une cuisine, des sanitaires. Ils vont tenir leur pari et dix jours durant, sous les yeux de la police médusée, ils vont argumenter sur cet autre monde que nous pouvons construire.
Une poignée de militants ont décidé d’investir les lieux pour y dresser un camp temporaire. L’info a percé jusqu’aux oreilles de la police bien évidemment. Qui est sur les dents. Un camp doit donc être dressé, dans la nuit, et pour dix jours. Un éco-village autogéré. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Pendant dix jours, il sera transformé en lieu de formation, de fête, de débats. Un autre monde est possible. Nous pouvons désobéir. Refuser leur monde. Trois personnes seulement savent exactement où ce camp sera monté. La police enquête, fouine, sans succès. Cent cinquante autres militants attendent l’info. Ils forment le "groupe terrain" et sont prêts à investir les lieux à partir de dix endroits différents. Ils attendent le signal et la localisation du lieu, qui leur sera envoyé par sms. Des camions attendent également loin d’Heatrow, leurs soutes pleines des chapiteaux qu’il faudra monter en un temps record, des cuisines, des sanitaires, des centaines de tentes qui vont recouvrir tout l’espace proposé à la destruction . Et chacun des cent cinquante militants du groupe terrain a en charge de prévenir des dizaines d’autres activistes disséminés dans Londres. Ceux-là sont regroupés par paires. Beaucoup patientent dans le métro. Chaque trajet est différent, les consignes sont claires : il faut partir dans la mauvaise direction, prendre la mauvais quai, monter au dernier moment dans la bonne rame. La police est sur les dents, partout, mais partout elle ne sait où donner de la tête. Des centaines d’activistes marchent déjà. L’opération Singe rugissant est déclenchée. Les barnums sont déchargés. La police reste sur les dents. Elle est partie dans la mauvaise direction dans une belle pagaille, tandis que les militants du groupe terrain montent déjà les chapiteaux. A l’aube, tout est en place. L’équipe média au centre, qui expédie déjà ses communiqués à la presse mondiale. Trois immenses chapiteaux sont en place, les cuisines fonctionnent, bientôt des centaines de tentes se dressent. Les militants d’Heathrow ont quatre objectifs : démontrer que l’empreinte écologique d’un tel camp est dérisoire, se former théoriquement et pratiquement, construire un mouvement radical pour la justice climatique. Un système de quartiers forme la structure du camp. Au centre de chaque quartier, une cuisine, des sanitaires. Ils vont tenir leur pari et dix jours durant, sous les yeux de la police médusée, ils vont argumenter sur cet autre monde que nous pouvons construire. Ailleurs, des collectifs rachètent des terres cultivables, mettent en culture des champs, des potagers autogérés, comme à Vitry-sur-Seine, au beau milieu du parc régional. C’est possible. Les utopies ont beau avoir été refoulées dans un monde invisible, elles existent et se développent, ici et maintenant. Partout ces pratiques se démultiplient. Partout on tente de repenser un nouvel ordre mondial. La sécurité ? On la repense ici dans un cadre coopératif. Isabelle Fremeaux et John Jordan ont suivi ces groupes, ces militants d’un autre monde, et nous donnent au passage pour feuille de route de relire l’histoire de la Révolution espagnole de 1936 - 1939, une révolution sociale sans équivalent dans l’histoire contemporaine, brutalement interrompue par les chars et les avions d’une réaction abjecte. Des milliers de villes, de villages, des millions d’espagnols gouvernés par des assemblées réellement populaires. Des grande surfaces agricoles, des pans entiers de l’industrie administrés en autogestion. L’anarchie, ce formidable mouvement populaire gérant alors la vie de millions d’espagnols qui avaient trouvé la force de se gouverner eux-mêmes. Une force enracinée dans une culture réellement populaire, parachevée par trois générations d’éducation et de construction d’un mouvement populaire de libération. Pour des millions de paysans, ce n’était pas une chimère utopiste mais une réalité de leur vie. La mémoire vivante des traditions du village, une longue histoire d’autogestion des communautés rurales, magnifique brèche dans l’histoire du monde contemporain.
Ailleurs, des collectifs rachètent des terres cultivables, mettent en culture des champs, des potagers autogérés, comme à Vitry-sur-Seine, au beau milieu du parc régional. C’est possible. Les utopies ont beau avoir été refoulées dans un monde invisible, elles existent et se développent, ici et maintenant. Partout ces pratiques se démultiplient. Partout on tente de repenser un nouvel ordre mondial. La sécurité ? On la repense ici dans un cadre coopératif. Isabelle Fremeaux et John Jordan ont suivi ces groupes, ces militants d’un autre monde, et nous donnent au passage pour feuille de route de relire l’histoire de la Révolution espagnole de 1936 - 1939, une révolution sociale sans équivalent dans l’histoire contemporaine, brutalement interrompue par les chars et les avions d’une réaction abjecte. Des milliers de villes, de villages, des millions d’espagnols gouvernés par des assemblées réellement populaires. Des grande surfaces agricoles, des pans entiers de l’industrie administrés en autogestion. L’anarchie, ce formidable mouvement populaire gérant alors la vie de millions d’espagnols qui avaient trouvé la force de se gouverner eux-mêmes. Une force enracinée dans une culture réellement populaire, parachevée par trois générations d’éducation et de construction d’un mouvement populaire de libération. Pour des millions de paysans, ce n’était pas une chimère utopiste mais une réalité de leur vie. La mémoire vivante des traditions du village, une longue histoire d’autogestion des communautés rurales, magnifique brèche dans l’histoire du monde contemporain. Dès les années 30, la France se mit en tête d’importer massivement des travailleurs issus de l’Empire colonial. Préférant les surveiller plutôt que les protéger, les ficher plutôt que de les aider à s’insérer dans la métropole. On créa ainsi immédiatement une police chargée de leur surveillance, la Brigade Nord-Africaine, qui opérait des rafles régulières pour alimenter ses fichiers.
Dès les années 30, la France se mit en tête d’importer massivement des travailleurs issus de l’Empire colonial. Préférant les surveiller plutôt que les protéger, les ficher plutôt que de les aider à s’insérer dans la métropole. On créa ainsi immédiatement une police chargée de leur surveillance, la Brigade Nord-Africaine, qui opérait des rafles régulières pour alimenter ses fichiers. Le sociologue Abdelmalek Sayad a étudié tout particulièrement les méthodes déployées par ces unités dans le bidonville de Nanterre, une colonie de près de 14 000 habitants en 1960 !
Le sociologue Abdelmalek Sayad a étudié tout particulièrement les méthodes déployées par ces unités dans le bidonville de Nanterre, une colonie de près de 14 000 habitants en 1960 ! "
"