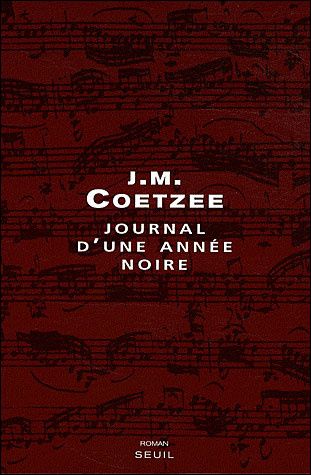 Avec Disgrâce, on devinait un Coetzee à l’étroit dans sa narration. Et pas uniquement parce que le sujet l’embarquait sur les lisières d’une langue exténuée. L’exténuation était profonde, rejoignant les thèmes affrontés, celui du vieillissement en particulier. Or voici que dans ce Journal, le même thème revient, plus insistant, plus obsédant, empoignant le statut de l’auteur jusqu’à voir dans la forme physique la condition même de l’exercice narratif.
Avec Disgrâce, on devinait un Coetzee à l’étroit dans sa narration. Et pas uniquement parce que le sujet l’embarquait sur les lisières d’une langue exténuée. L’exténuation était profonde, rejoignant les thèmes affrontés, celui du vieillissement en particulier. Or voici que dans ce Journal, le même thème revient, plus insistant, plus obsédant, empoignant le statut de l’auteur jusqu’à voir dans la forme physique la condition même de l’exercice narratif.
Qui sait ce que l’art peut devoir au solde d’une force physique déclinante ? Coetzee ne cesse d’en sonder la profondeur, jusque dans le régime auctorial qui fonde cette réflexion, à douter de sa propre autorité quand déjà le texte - ces trois portées offertes à notre lecture unique -, se brouille et nous dévoile l’ampleur de l’incertitude qui l'assigne.
Le personnage dont il est question ici, vieillit. Se sent vieillir plus qu’il ne vieillit vraiment - au bout d’un moment, on ne vieillit plus : on est vieux.
Son éditeur lui a passé commande, mais il besogne son travail, poursuivi avec trop de métier. Il peut écrire pourtant sur les sujets de son choix, des réflexions graves ou précieuses mais malade, sa méditation n’ose affronter ce qui monte en lui. Jusqu’au jour où il croise une jeune voisine aux formes généreuses. Elle ne fait rien, il lui propose de devenir sa secrétaire. Elle accepte. Il lui dicte ses pensées, qu’elle enregistre et retranscrit. Des opinions. Tranchées. Trop sans doute, comme ce texte injuste sur Machiavel. Des opinions sur ce qui ne va pas dans le monde, mais rien de décisif sur lui, qui ne va plus au monde.
Sur la page éditée, Coetzee reporte : ces opinions, son journal et le récit de ces journées par Anya, la secrétaire. Les strates s’accumulent tout d’abord, avant de se répondre et de s’interpénétrer bientôt. C’est que le vieil homme ne fait pas que penser le monde depuis son expérience passée : il recommence à le vivre, observant jour après jour cette Anya qui l’émoustille. Elle voit bien ce qu’il regarde d'elle, dont elle aime lui offrir le spectacle. Jusqu’à ce long texte sur la pédophilie qu’elle doit retranscrire, ambigu au possible et qui la fait réagir. Il fantasme sur elle et si elle l’accepte volontiers, pour autant, elle ne supporte pas la complaisance de sa rhétorique. Mais c’est aussi qu’elle le voit comme un vieux, penché sur elle. Moins libidineux toutefois que sans défense, lige d’un corps éreinté.
Alors d’un coup la narration embraye. Sur cette question de déshonneur que le vieil homme soulève. Anya se met à raconter, à faire le récit de sa propre expérience du déshonneur, qu’il rapporte dans son journal et l’on se surprend, lecteur, à se laisser aller à cette lecture, laissant en plan les autres strates du texte pour suivre le fil d’un récit enfin « juste ». Ça y est, Coetzee a trouvé le ressort.
Le second journal s’ouvre sur ce protocole compassionnel qui peu à peu se met en place. Entre lui et elle, entre le texte et son lecteur. Pure rhétorique ? Peut-être pas.
Il s’ouvre dans la vêture de la tombe qui se profile, cet Autre monde froid, gris et sans éclat des grecs, que Coetzee a peur de faire sien. Le journal devient plus intime. Sous le texte « Du vieillir », il raconte comment notre vieil homme a effleuré un jour de ses lèvres la peau douce d’Anya, avant qu’ils ne tombent l’un dans les bras de l’autre pour une étreinte chaste. Ultime consolation ? Non. Car il y a cette force de Coetzee à affronter l’obscénité de la mort du désir. Tout l’art du roman en somme, s’engouffrant brusquement dans ce qui lui résiste.
Ajoutons à cela de superbes méditations sur ces parties du corps (les dents) dont nous faisons peu cas, comme si elles ne semblaient pas nous appartenir mais nous avaient simplement été confiées, alors qu’elles seules survivront à notre fin. Comme si ce qui était le plus périssable en nous, au fond, était vraiment nous.
Ou bien encore cette réflexion sur l’usage contemporain de l’anglais : nous allons vers une grammaire d’où est absente la notion de sujet grammatical. Dans l’attente, peut-être, de son orgueilleuse extinction… -- Joël Jégouzo --
Journal d’une année noire, de J.M. Coetzee, éd. du seuil, oct 2008, traduit de l’anglais (australien) par Catherine Lauga du Plessis, 296p, 21,80 euros, code ISBN : 978-2-02-096625-2



 Disgrâce (Booker Price 99, le second qu’obtenait Coetzee) est paru en français au moment où ce dernier quittait l’Afrique du Sud pour l’Australie. Remarque qui n’est pas anodine, mais qui pourrait induire en erreur, car il serait navrant de réduire ce roman à celui de l'après apartheid. Mais certes, il l’est aussi, avec une vigueur et une audace incroyables qui plus est : Coetzee n’hésite pas à y pointer, sans la condamner (il n’en a plus la force), la violence aveugle du ressentiment noir à l’égard des blancs, qui transforme parfois les anciens esclaves en bourreaux. La grande campagne de réparation des préjudices s’achève ici dans le viol de la fille du héros, viol que nul ne songe à dénoncer, pas même elle, qui s’imagine qu’il s’agit du prix à payer pour continuer de vivre en Afrique du Sud quand on est « blanche »… Combien auraient osé pareil thème ?
Disgrâce (Booker Price 99, le second qu’obtenait Coetzee) est paru en français au moment où ce dernier quittait l’Afrique du Sud pour l’Australie. Remarque qui n’est pas anodine, mais qui pourrait induire en erreur, car il serait navrant de réduire ce roman à celui de l'après apartheid. Mais certes, il l’est aussi, avec une vigueur et une audace incroyables qui plus est : Coetzee n’hésite pas à y pointer, sans la condamner (il n’en a plus la force), la violence aveugle du ressentiment noir à l’égard des blancs, qui transforme parfois les anciens esclaves en bourreaux. La grande campagne de réparation des préjudices s’achève ici dans le viol de la fille du héros, viol que nul ne songe à dénoncer, pas même elle, qui s’imagine qu’il s’agit du prix à payer pour continuer de vivre en Afrique du Sud quand on est « blanche »… Combien auraient osé pareil thème ? Inventé en 1874, et bien qu'expression malingre du génie mécanique, le barbelé a conservé jusqu’à aujourd’hui sa redoutable efficacité pour délimiter les espaces.
Inventé en 1874, et bien qu'expression malingre du génie mécanique, le barbelé a conservé jusqu’à aujourd’hui sa redoutable efficacité pour délimiter les espaces.


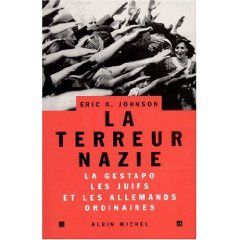 Pendant plus de dix ans, l’auteur a enquêté sur le fonctionnement de la terreur nazie dans la région de Cologne. Il s’agissait pour lui de comprendre quel écho la société allemande avait recueilli du massacre des juifs, et d’en déterminer le degré d’implication. Mais aussi d’expliquer le fonctionnement d’un Etat que les historiens qualifiaient de totalitaire.
Pendant plus de dix ans, l’auteur a enquêté sur le fonctionnement de la terreur nazie dans la région de Cologne. Il s’agissait pour lui de comprendre quel écho la société allemande avait recueilli du massacre des juifs, et d’en déterminer le degré d’implication. Mais aussi d’expliquer le fonctionnement d’un Etat que les historiens qualifiaient de totalitaire.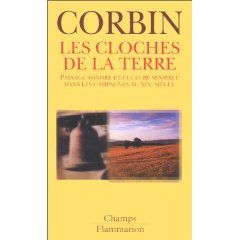
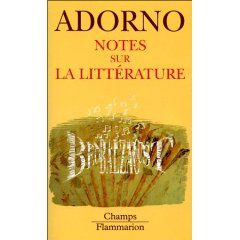 Réédition d'une série d'articles et d'essais, dont certains ouvrirent de salutaires polémiques dans le champ de la théorie de la littérature. Ce fut le cas en particulier de l'étude de 1958 : L'essai comme forme, qui prenait pour cible le redoutable théoricien marxiste G. Lukàcs. A la base de la conception d'Adorno, l'idée d'un hiatus entre les mots et les choses. Ce hiatus se manifeste spectaculairement entre l'oeuvre d'art et le discours qui prétend en saisir la réalité. Du coup, il ne s'agit plus, pour le théoricien, de chercher à comprendre l'oeuvre, mais bien plutôt son caractère incompréhensible. Le malentendu, l'erreur, la mauvaise compréhension constituent désormais l'état naturel dans lequel se trouve le critique au moment de commencer sa recherche. La méthode qu'il va employer, dès lors qu'il s'agit pour lui de saisir un terme non conceptuel qui reste caché à lui-même, ne pourra être que paradoxale et relevant d'une intention utopique. Dans cette conception, l'essai représente un défi à l'idéal de la claire conscience, de la perception distincte, tout comme à la certitude intellectuelle. De fait, la théorie de la connaissance sur laquelle s'appuie Adorno, s'élabore depuis une critique radicale des règles cartésiennes qui fondent le Discours de la méthode.
Réédition d'une série d'articles et d'essais, dont certains ouvrirent de salutaires polémiques dans le champ de la théorie de la littérature. Ce fut le cas en particulier de l'étude de 1958 : L'essai comme forme, qui prenait pour cible le redoutable théoricien marxiste G. Lukàcs. A la base de la conception d'Adorno, l'idée d'un hiatus entre les mots et les choses. Ce hiatus se manifeste spectaculairement entre l'oeuvre d'art et le discours qui prétend en saisir la réalité. Du coup, il ne s'agit plus, pour le théoricien, de chercher à comprendre l'oeuvre, mais bien plutôt son caractère incompréhensible. Le malentendu, l'erreur, la mauvaise compréhension constituent désormais l'état naturel dans lequel se trouve le critique au moment de commencer sa recherche. La méthode qu'il va employer, dès lors qu'il s'agit pour lui de saisir un terme non conceptuel qui reste caché à lui-même, ne pourra être que paradoxale et relevant d'une intention utopique. Dans cette conception, l'essai représente un défi à l'idéal de la claire conscience, de la perception distincte, tout comme à la certitude intellectuelle. De fait, la théorie de la connaissance sur laquelle s'appuie Adorno, s'élabore depuis une critique radicale des règles cartésiennes qui fondent le Discours de la méthode.