 L’ordre social est une économie de la menace.
L’ordre social est une économie de la menace.
Que désigne la violence dans nos sociétés ? On se rappelle les leçons de Max Weber sur la violence et son usage légitime dès lors que seul l’Etat en détient le monopole. Il faudrait peut-être partir de là pour comprendre qu’au fond, si le projet d’égalité dans les démocraties occidentales est resté formel, c’est peut-être parce que l’ordre social y était resté une économie de la menace, construisant la citoyenneté comme l’accès au pouvoir de violence –on le voit assez dans la figure du politique, qui ne se soucie d’abord jamais rient tant que des conditions de l’accès au pouvoir politique maintenu comme l’une des formes primitives de la violence sociale, qui n’aura ensuite de cesse de s’affranchir de la volonté populaire pour la dominer et penser accessoirement un mode d’accès au pouvoir politique interdisant aux femmes d’entrer en politique.
Notre ordre social est ainsi toujours fondé sur la distribution asymétrique des pouvoirs (aux élites le pouvoir, au Peuple souverain la soumission, aux hommes, etc.), qui a essentiellement besoin de construire socialement l’existence d’un sexe menaçant et d’un autre supposé inoffensif pour fonctionner.
L’état civil se charge de fabriquer ces deux groupes distincts dont cet ordre a besoin, pierre angulaire des discours sociaux qui vont ensuite conférer un sens à cette partition et distribuer les éléments de langage qui en consolideront le bienfondé a posteriori, à travers une mise en récits typiques établis sur des corrélations fallacieuses, ainsi que le démontrait avec brio l’ouvrage collectif Penser la violence des femmes, premier du genre en France à avoir tenté de saisir le sens de cette violence, réfléchie dans nos sociétés occidentales comme un événement minoritaire, quand en réalité elle est socialement organisée pour le rester.
A travers cette violence, déniée mais pas moins "fondatrice" que ne le prétend celle des hommes, l’ouvrage montrait qu’au fond les mauvaises raisons de la taire s’inscrivaient à l’intérieur d’un discours sur les genres dont la société se nourrissait. Pourquoi ? Parce que notre ordre social est fondé sur la distribution asymétrique des pouvoirs et des vulnérabilités supposées, distribution commode, effarante car destinée entre autres à interdire l’irruption de la jouissance dans la sphère du social.
 A quoi ressemblerait donc une société sans genre et sans sexe ?
A quoi ressemblerait donc une société sans genre et sans sexe ?
L’ouvrage auquel je fais référence ne tranche pas, mais soulève mille interrogations passionnantes à ce sujet.
Ce serait une société qui aurait dévalué la violence.
Ce serait une société au sein de laquelle l’autonomie sociale n’aurait rien à voir avec l’anatomie sexuelle. Imaginez à quoi ressemblerait le social des êtres qui ne serait plus dominé par le recours à l’explication biologique, celle-là même qui, dans l’Histoire, n’a cessé d’enfermer, de maltraiter, d’exterminer les êtres…
Imaginez-en les conséquences sur le plan politique : il nous faudrait repenser les modes d’accès au pouvoir en sortant du cadre de la violence pensée comme fondatrice des rapports humains… Imaginez même à quoi ressemblerait la géographie de la discipline sociale dans une société sans genre, et à ce qu’elle pourrait enfin devenir en terme d’égalité non plus seulement formelle mais réelle, et ce à quoi cela nous obligerait : le dépassement de cette économie de la menace qui a fondé jusque là l’ordre social des sociétés humaines. L’heure est toujours aux vœux. Qu’il soit le nôtre en 2013 !
Penser la violence des femmes, collectif sous la direction de Coline Cardi et Geneviève Pruvost, éd. La Découverte, août 2012, 440 pages, 32 euros, isbn 13 : 978-2707172969.
Voir lien sur le site k-libre, à propos de cet ouvrage : http://www.k-libre.fr/klibre-ve/index.php?page=livre&id=2504
image : Godard, masculin féminin.



 A l’heure où l’Agence Française de sécurité sanitaire vient de remettre son rapport sur l’impact de la pollution atmosphérique, révélant que toutes les villes étudiées en France présentaient des valeurs de particules et d’ozone supérieures aux valeurs guides recommandées par l’Organisation Mondiale de la santé, peut-être serait-il temps de prendre enfin en compte le problème au sommet de l’Etat, d’autant qu’il se révèle particulièrement dramatique au regard des menaces qui pèsent sur la santé des enfants.
A l’heure où l’Agence Française de sécurité sanitaire vient de remettre son rapport sur l’impact de la pollution atmosphérique, révélant que toutes les villes étudiées en France présentaient des valeurs de particules et d’ozone supérieures aux valeurs guides recommandées par l’Organisation Mondiale de la santé, peut-être serait-il temps de prendre enfin en compte le problème au sommet de l’Etat, d’autant qu’il se révèle particulièrement dramatique au regard des menaces qui pèsent sur la santé des enfants. Plutôt que de rester les corps souffrants de l’antique rébellion, devenons des corps opaques à cette lecture triviale de notre être que le capitalisme, dans sa mouture néolibérale, propose : entrepreneurs de désirs lisibles en termes d’une dépense économique qui seule déterminerait la valeur de leur être…
Plutôt que de rester les corps souffrants de l’antique rébellion, devenons des corps opaques à cette lecture triviale de notre être que le capitalisme, dans sa mouture néolibérale, propose : entrepreneurs de désirs lisibles en termes d’une dépense économique qui seule déterminerait la valeur de leur être… L’expérience nouvelle, c’est déserter l’espace marchand, y compris celui de la culture, pour rendre nos événements publics, illimités, in-assignables. C’est inventer des modèles économiques précaires, incertains, où tenter néanmoins de tisser des résonances et prendre le risque de les déployer le plus largement possible.
L’expérience nouvelle, c’est déserter l’espace marchand, y compris celui de la culture, pour rendre nos événements publics, illimités, in-assignables. C’est inventer des modèles économiques précaires, incertains, où tenter néanmoins de tisser des résonances et prendre le risque de les déployer le plus largement possible. "Pour que l’économie fonctionne, (…) il faut qu’il y ait des humains qui acceptent de voir leurs vies conduites par les règles de l’économie", affirment les auteurs du Collectif pour l’intervention.
"Pour que l’économie fonctionne, (…) il faut qu’il y ait des humains qui acceptent de voir leurs vies conduites par les règles de l’économie", affirment les auteurs du Collectif pour l’intervention. Le soit-disant système économique dont on nous rebat les oreilles, loin d’être autonome, n’existe donc que parce que nos conduites le perpétuent. Tout autant qu’il n’existe pas de système capitaliste : il y a des gens à l’origine du capitalisme financier qui nous étrangle.
Le soit-disant système économique dont on nous rebat les oreilles, loin d’être autonome, n’existe donc que parce que nos conduites le perpétuent. Tout autant qu’il n’existe pas de système capitaliste : il y a des gens à l’origine du capitalisme financier qui nous étrangle. «Je t’apporte l’enfant d’une nuit d’Idumée !», s’exclame Mallarmé dans ce poème qu’il vient d’écrire : Le don du poème. Mallarmé a veillé toute la nuit, toute la nuit il a tenté d’écrire son poème en songeant à une œuvre plus grande qu’il ne parvient pas à finir. Sa femme vient de se lever et s’occupe de leur enfant, une fille. L’entend-on pleurer dans le poème, que ses cris ne sont que barbares, hostiles, tourments infligés à la création poétique. Car cette enfant lui confisque la seule naissance attendue, celle du grand œuvre poétique. Mallarmé travaille à Hérodiade. Toute la nuit. Mais au petit jour, il n’a pas avancé d’une ligne. Il vient tout de même d’écrire ce curieux poème, jeté à la figure de sa femme qui lui a certes fait le don d’une fille, mais qui est incapable de lui donner un meilleur enfant, celui qu’il attend et qui n’est pas de chair et qui n’est pas de bosses, de cris ou de succion. Elle s’est recouchée, l’enfant dort. Mallarmé sait que bientôt, tout ce monde se réveillera de nouveau, fera du bruit, balbutiera, l’interrompra et que lui-même devra se lever, se laver, s’habiller et se rendre à l’école, où il enseigne. A Tournon. Avec sa vue plastronnée sur le Rhône — «fuir, là-bas fuir, je sens que les oiseaux sont ivres d’être parmi l’écume inconnue et les cieux… », etc.
«Je t’apporte l’enfant d’une nuit d’Idumée !», s’exclame Mallarmé dans ce poème qu’il vient d’écrire : Le don du poème. Mallarmé a veillé toute la nuit, toute la nuit il a tenté d’écrire son poème en songeant à une œuvre plus grande qu’il ne parvient pas à finir. Sa femme vient de se lever et s’occupe de leur enfant, une fille. L’entend-on pleurer dans le poème, que ses cris ne sont que barbares, hostiles, tourments infligés à la création poétique. Car cette enfant lui confisque la seule naissance attendue, celle du grand œuvre poétique. Mallarmé travaille à Hérodiade. Toute la nuit. Mais au petit jour, il n’a pas avancé d’une ligne. Il vient tout de même d’écrire ce curieux poème, jeté à la figure de sa femme qui lui a certes fait le don d’une fille, mais qui est incapable de lui donner un meilleur enfant, celui qu’il attend et qui n’est pas de chair et qui n’est pas de bosses, de cris ou de succion. Elle s’est recouchée, l’enfant dort. Mallarmé sait que bientôt, tout ce monde se réveillera de nouveau, fera du bruit, balbutiera, l’interrompra et que lui-même devra se lever, se laver, s’habiller et se rendre à l’école, où il enseigne. A Tournon. Avec sa vue plastronnée sur le Rhône — «fuir, là-bas fuir, je sens que les oiseaux sont ivres d’être parmi l’écume inconnue et les cieux… », etc.
 Octobre 2008, une poignée de militants d’un genre nouveau, gauche radicale et ménagères excédées par le comportement des banques et de leurs dirigeants politiques, descend dans la rue, s’empare des réseaux sociaux et lance une pétition nationale exigeant la démission des politiques au pouvoir. Manifs à la louche –de cuisine. La ménagère de plus de cinquante ans, raillée par les médias occidentaux, n’en démordra pas, faisant le siège du Parlement jour après jour. Par deux fois, le peuple islandais va tout d’abord refuser de payer les dettes des banques privées et dans la foulée, réalisant combien il est vain de demander aux politiques d’accéder à ses vœux, va changer le monde, refuser que l’on touche aux acquis sociaux et contraindre ses élus à la démission. Mieux : les islandais vont concevoir -vous avez bien lu : «les» islandais- une sortie de crise démocratique qui tournera résolument le dos aux recettes néolibérales !
Octobre 2008, une poignée de militants d’un genre nouveau, gauche radicale et ménagères excédées par le comportement des banques et de leurs dirigeants politiques, descend dans la rue, s’empare des réseaux sociaux et lance une pétition nationale exigeant la démission des politiques au pouvoir. Manifs à la louche –de cuisine. La ménagère de plus de cinquante ans, raillée par les médias occidentaux, n’en démordra pas, faisant le siège du Parlement jour après jour. Par deux fois, le peuple islandais va tout d’abord refuser de payer les dettes des banques privées et dans la foulée, réalisant combien il est vain de demander aux politiques d’accéder à ses vœux, va changer le monde, refuser que l’on touche aux acquis sociaux et contraindre ses élus à la démission. Mieux : les islandais vont concevoir -vous avez bien lu : «les» islandais- une sortie de crise démocratique qui tournera résolument le dos aux recettes néolibérales ! L’Homme surgi des méditations cartésiennes est solitaire, inachevé.
L’Homme surgi des méditations cartésiennes est solitaire, inachevé. Le petit anthropos est comme ça : il danse, bouge. Il remue et place toute son attention dans le montage de ce qu’il met en scène : des gesticulations d’abord imprécises, inadéquates, et puis des gestes qui finissent par dessiner un mouvement.
Le petit anthropos est comme ça : il danse, bouge. Il remue et place toute son attention dans le montage de ce qu’il met en scène : des gesticulations d’abord imprécises, inadéquates, et puis des gestes qui finissent par dessiner un mouvement.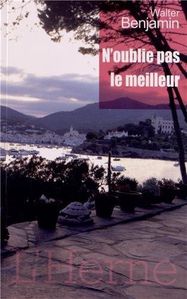 Des récits, des histoires, des contes, rédigés en même temps que Sens unique (1928), et Enfance Berlinoise (1932-1938). Des aphorismes, de très courts textes en fait la plupart du temps, quelques lignes, quelques pages. Walter Benjamin entendait apporter sa contribution à un débat initié par Adorno. Hors du concept, hors de toute cohérence théorique, s’exposant, se risquant, risquant dans ces formes fugitives une réconciliation qu’Adorno affirmait "prématurée", illusoire : celle que l’art propose.
Des récits, des histoires, des contes, rédigés en même temps que Sens unique (1928), et Enfance Berlinoise (1932-1938). Des aphorismes, de très courts textes en fait la plupart du temps, quelques lignes, quelques pages. Walter Benjamin entendait apporter sa contribution à un débat initié par Adorno. Hors du concept, hors de toute cohérence théorique, s’exposant, se risquant, risquant dans ces formes fugitives une réconciliation qu’Adorno affirmait "prématurée", illusoire : celle que l’art propose.