 Il n’existe qu’un seul héros : le Peuple. C’est aux gens ordinaires, qui savent inaugurer de ces grands moments de l’Histoire, qu’Eric Hobsbawn rend justice.
Il n’existe qu’un seul héros : le Peuple. C’est aux gens ordinaires, qui savent inaugurer de ces grands moments de l’Histoire, qu’Eric Hobsbawn rend justice.
Des anonymes, connus des seuls services de police, de ceux qui font les époques et défont les régimes. Une série d’articles magnifiques, ouvrant à des réflexions hors du commun bien souvent et remettant les pendules à l’heure. Un livre trop riche pour que l’on puisse en rendre pleinement compte, mais dont l’on retiendra, à titre d’exemple de la probité du chercheur, de sa ténacité à déconstruire les préjugés et de son attachement aux causes des peuples, le chapitre consacré aux "briseurs de machine", tant son étude est révélatrice de la manière dont les élites ont traité et traitent encore l’histoire des luttes populaires.
Rappelez-vous vos propres manuels scolaires, qui n’en finissent pas de colporter leurs préjugés à propos d’une révolte décrite comme une vaste jacquerie ouvrière rétrograde, obscurantiste, allant à contresens de l’Histoire. Hobsbawn en reconstruit minutieusement les fondements, pour retracer la généalogie de la construction d’un préjugé commode, destiné à discrédité les pratiques ouvrières, à réduire l’intelligence des classes populaires à de piètres pantomimes réactionnaires. Un préjugé qui plus est construit a posteriori, après falsification des données historiques, dissimulation des archives par des idéologues peu scrupuleux de vérité historique.
Qu’en fut-il en fait ? S’agissait-il réellement du mouvement désespéré d’hommes craintifs et sans avenir ? Etait-ce réellement le combat d’arrière-garde que l’on nous dépeint à longueur de colonnes comme un combat pathétique et absurde ?
Il vaut la peine de prêter attention à l’argumentation serrée d’ Hobsbawn, bâtie sur la lecture des archives de police et des tracts collationnés dès le XVIIIème siècle, oui, bien avant l’ère industrielle, pour comprendre ce que fut le mouvement des luddites –le vrai nom des briseurs de machines.
Les destructions de machines avaient donc commencé dès le XVIIIème siècle et se poursuivirent jusque vers la moitié du XIXème. L’exemple du Lancashire, en 1811, est particulièrement étudié par Hobsbawn : on dispose pour le faire d’archives importantes, de polices et autres, à la lecture desquelles il apparaît que la destruction des machines étaient le seul moyen de pression dont pouvaient disposer les ouvriers pour contraindre leurs employeurs à négocier, en un temps où ceux-ci n’hésitaient pas à baisser drastiquement les salaires du jour au lendemain, ou à payer des briseurs de grève pour prendre le relais des grévistes s’il s’en présentait –et faire donner l’armée, bien évidemment, pour réprimer sauvagement leur mouvement.
Or toutes les archives concordent sur un point : les machines n’étaient en rien visées en tant que telles, les ouvriers cherchant uniquement des moyens de pression adéquats ! Lesquels, selon la brutalité des patrons, allaient de la destruction des matières premières à celle des produits manufacturés, en passant par les biens mobiliers. Car à quoi s’attaquer pour faire céder un patron ? Les tondeurs de mouton, les brûleurs de foin, de granges, d’entrepôts, de stocks de tissus pour les drapiers, avaient-ils seulement le choix, quand la négociation par l’émeute demeurait la seule porte laissée vacante par la classe dirigeante ?
Et ce que découvre Hobsbawn, c’est que dans nombre de luttes, la destruction des machines s’est montrée être l’arme appropriée, qui fit céder nombre de patrons. Au XVIIIème siècle, la destruction des machines pouvait même être considérée comme l'arme décisive dans tout conflit. Ces destructions, plus fréquentes en Angleterre qu’en France, avaient en outre l’avantage de faire entrer la solidarité dans le code éthique des luttes ouvrières (une poignée de résistants s’en occupaient, les autres restant à leur poste de travail), ce que les ouvriers comprirent vite, qui accessoirement aidait aussi à la formation d’une vraie conscience de classe.
Collatéralement, et parce que ce qui préoccupait les ouvriers n’était pas le progrès technique, mais de trouver une solution au chômage et à la misère, en obligeant les Pouvoirs, par le biais du chantage aux machines, à engager une réflexion sur ces questions, ils firent œuvre de la plus parfaite intelligence sociale et politique, si ce n’est économique, ouvrant la voie à une société de progrès capable de prendre en charge la question de l’emploi et des salaires pour la placer au cœur même du procès économique à peine inauguré. On trouve même trace, dans ces archives, de la satisfaction des ouvriers face à l’introduction des machines dans les rapports de production : grâce à elles, l’emploi allait s’améliorer, et par la productivité naissante en tant que raisonnement économique, ouvrir de nouveaux horizons au développement humain ! --joël jégouzo--.
Eric Hobsbawn, Rébellions. La résistance des gens ordinaires, jazz, paysans et prolétaires, éditions Aden, traduit de l'anglais par Stéphane Ginsburgh et Hélène Hiessler, janv. 2011, 550 pages, 30 euros, 978-2-805-900198.



 Les historiens de la culture connaissaient l’histoire. Mais le texte restait introuvable. Durant son internement dans un camp soviétique,
Les historiens de la culture connaissaient l’histoire. Mais le texte restait introuvable. Durant son internement dans un camp soviétique, Un dimanche matin. Pour la première fois depuis bien longtemps, aucune queue ne s’étire des ruelles jusqu’au quai. Personne dans le musée non plus, ou presque, les œuvres accessibles, enfin disponibles au regard. Des tableaux, à profusion, de salle en salle, plongés dans un silence contemplatif. L’immense couloir Vasari et bientôt sous le pas, de grandes salles désertes aux murs tendus de bannes rouges, sombres sous leur éclairage blafard. Des salles en enfilade, laides, esseulées, si inquiétantes dans la pénombre que personne ne s’y aventure. Vidées de leurs œuvres, de leurs foules, elles sont les antichambres d’un deuil empesé. J’avance seul, les pas étouffés par la moquette, tournant un angle, longeant des séjours vides pour déboucher enfin où je voulais parvenir : les salles du Caravage -ses tableaux pour la plupart absents, prêtés. Et c’est le choc : se faisant presque face, Le sacrifice d’Isaac
Un dimanche matin. Pour la première fois depuis bien longtemps, aucune queue ne s’étire des ruelles jusqu’au quai. Personne dans le musée non plus, ou presque, les œuvres accessibles, enfin disponibles au regard. Des tableaux, à profusion, de salle en salle, plongés dans un silence contemplatif. L’immense couloir Vasari et bientôt sous le pas, de grandes salles désertes aux murs tendus de bannes rouges, sombres sous leur éclairage blafard. Des salles en enfilade, laides, esseulées, si inquiétantes dans la pénombre que personne ne s’y aventure. Vidées de leurs œuvres, de leurs foules, elles sont les antichambres d’un deuil empesé. J’avance seul, les pas étouffés par la moquette, tournant un angle, longeant des séjours vides pour déboucher enfin où je voulais parvenir : les salles du Caravage -ses tableaux pour la plupart absents, prêtés. Et c’est le choc : se faisant presque face, Le sacrifice d’Isaac Comment tirer partie de ce rapprochement ?
Comment tirer partie de ce rapprochement ? Il n’est tout de même pas indifférent que Caravage ait peint ces deux tableaux. Narcisse et Abraham. Que faire, ici, du regard de Narcisse, infiniment désirant ? Le confier à Abraham, qui en paraît tellement exclu ? Que faire de l’un, désirant sans pudeur, et de l’autre, mort au désir de voir et peut-être bien mort à tout désir, tout court ? Abraham exécutant sa propre mort au désir, là, sous la pression de l’ange. Abraham y consentant dans le suspens de son geste, pathétique et absurde dans l’expression même de son interrogation, pas même soulagé, pas même hébété, juste stupide…
Il n’est tout de même pas indifférent que Caravage ait peint ces deux tableaux. Narcisse et Abraham. Que faire, ici, du regard de Narcisse, infiniment désirant ? Le confier à Abraham, qui en paraît tellement exclu ? Que faire de l’un, désirant sans pudeur, et de l’autre, mort au désir de voir et peut-être bien mort à tout désir, tout court ? Abraham exécutant sa propre mort au désir, là, sous la pression de l’ange. Abraham y consentant dans le suspens de son geste, pathétique et absurde dans l’expression même de son interrogation, pas même soulagé, pas même hébété, juste stupide… Contemplant le tableau, je m’assurai que rien ne fonctionnait plus pour nous dans cette scène. Je ne dirai rien du style, de la peinture elle-même, au fond sa vraie prégnance, car à ce moment, seule la circularité des regards me retenait. Voir sans être vu. Le Sacrifice d’Isaac, il me le semblait du moins, ne servait même plus à visualiser ce qui n’était pas à l’image mais qui la fondait pourtant : Dieu. Dieu faisant arrêter le bras au tout dernier moment, sans parvenir à exorciser la menace qu’il faisait planer sur le Moi des êtres humains. Car Dieu avait disparu, de mon côté du tableau, là où initialement le Caravage l’avait logé. Il ne restait que mon regard et celui du peintre, de ce côté-ci du tableau. Ce qui avait poussé au voir, cet encombrant inquisiteur, placé au centre conceptuel mais non visuel de l’œuvre, n’était plus nulle part désormais. Le dispositif du peintre, qui avait scintillé autour de ce personnage absent, relevait désormais d’une autre disposition. Restaient les regards, disparates et nombreux : celui d ‘Abraham, celui d’Isaac, celui de l’ange, celui du bélier, le mien, et le fantôme de l’Autre perdu, égaré dans les limbes d’une histoire qui nous était étrangère désormais. Restait aussi le regard du peintre, pas si absent qu’on voudrait bien le croire, et qui avait fini par se loger à la place laissée vacante par Dieu.
Contemplant le tableau, je m’assurai que rien ne fonctionnait plus pour nous dans cette scène. Je ne dirai rien du style, de la peinture elle-même, au fond sa vraie prégnance, car à ce moment, seule la circularité des regards me retenait. Voir sans être vu. Le Sacrifice d’Isaac, il me le semblait du moins, ne servait même plus à visualiser ce qui n’était pas à l’image mais qui la fondait pourtant : Dieu. Dieu faisant arrêter le bras au tout dernier moment, sans parvenir à exorciser la menace qu’il faisait planer sur le Moi des êtres humains. Car Dieu avait disparu, de mon côté du tableau, là où initialement le Caravage l’avait logé. Il ne restait que mon regard et celui du peintre, de ce côté-ci du tableau. Ce qui avait poussé au voir, cet encombrant inquisiteur, placé au centre conceptuel mais non visuel de l’œuvre, n’était plus nulle part désormais. Le dispositif du peintre, qui avait scintillé autour de ce personnage absent, relevait désormais d’une autre disposition. Restaient les regards, disparates et nombreux : celui d ‘Abraham, celui d’Isaac, celui de l’ange, celui du bélier, le mien, et le fantôme de l’Autre perdu, égaré dans les limbes d’une histoire qui nous était étrangère désormais. Restait aussi le regard du peintre, pas si absent qu’on voudrait bien le croire, et qui avait fini par se loger à la place laissée vacante par Dieu. Il va d’un pas nonchalant.
Il va d’un pas nonchalant. Je le suis volontiers, joueur d’accordéon ébahi par le spectacle des lapins qui s’ébattent sur les berges de l’Arno.
Je le suis volontiers, joueur d’accordéon ébahi par le spectacle des lapins qui s’ébattent sur les berges de l’Arno. «L’homme est un poème que l’Être a commencé.»
«L’homme est un poème que l’Être a commencé.» Le jour montait, je renaissais au spectacle pourtant très anodin qui s’offrait, saisi d’étonnement sans parvenir à comprendre ce que ces berges ébouriffées ouvraient en moi. Qu’on s’imagine l’Arno, ses berges veloutées. Qu’on s’imagine un fleuve sans majesté, une rivière presque, s’en allant porter les rumeurs couvertes de toits de tuile des innombrables œuvres dressées dans les rues de la ville, immortelles, apaisées au jour qui se levait, le doux sommeil des hommes achevé dans le pressentiment des choses sensibles : la nature, divinement présente sous le corridor de Vasari et se passant de tout discours, jusqu’à suspendre le mien dans cette énigme du pur jaillissement d’une motte de terre accrochée par un rai de soleil et de ces quelques chemins durcis par le givre à deux pas du courant. J’étais dehors, à l’affût de l’aube tel un Thoreau, au guet de la nature dans cette ville infiniment érudite. Abasourdi, inspectant la bruine qui tombait à présent, arpentant ces layons au ras des berges, sur la piste d’un chat, d’une tourterelle empressée dans le ciel de Toscane, me tenant sur la ligne de rencontre de ces éternités fragiles, dans ce lieu presque originel des berges de l’Arno où rôde en secret l’être que les villes ont oublié, et qui se promène sans nom dans l’éclaircie des rencontres qui le font advenir.
Le jour montait, je renaissais au spectacle pourtant très anodin qui s’offrait, saisi d’étonnement sans parvenir à comprendre ce que ces berges ébouriffées ouvraient en moi. Qu’on s’imagine l’Arno, ses berges veloutées. Qu’on s’imagine un fleuve sans majesté, une rivière presque, s’en allant porter les rumeurs couvertes de toits de tuile des innombrables œuvres dressées dans les rues de la ville, immortelles, apaisées au jour qui se levait, le doux sommeil des hommes achevé dans le pressentiment des choses sensibles : la nature, divinement présente sous le corridor de Vasari et se passant de tout discours, jusqu’à suspendre le mien dans cette énigme du pur jaillissement d’une motte de terre accrochée par un rai de soleil et de ces quelques chemins durcis par le givre à deux pas du courant. J’étais dehors, à l’affût de l’aube tel un Thoreau, au guet de la nature dans cette ville infiniment érudite. Abasourdi, inspectant la bruine qui tombait à présent, arpentant ces layons au ras des berges, sur la piste d’un chat, d’une tourterelle empressée dans le ciel de Toscane, me tenant sur la ligne de rencontre de ces éternités fragiles, dans ce lieu presque originel des berges de l’Arno où rôde en secret l’être que les villes ont oublié, et qui se promène sans nom dans l’éclaircie des rencontres qui le font advenir. Qu’est-ce donc, ce que le promeneur florentin croit pouvoir recouvrer ? Des poètes, des peintres, qu’attendre dans le silence de l’aube éclairé d’un ciel peu à peu descendu, comme on le dit au théâtre des cintres où les machineries usent les textes jusqu’à leur corde ? Elle abordait, l’heure marquée de l’énigmatique dialogue avec soi, exposée aux variations chaotiques du flux de l’Arno redessinant sans cesse les rives et les fonds de son lit. Tout le Paradis de Dante est hanté par l’impossibilité d’écrire le Paradis. Mais la concorde qui régit les âmes sauvées exhale de désir, du tourbillon dans cet ailleurs du monde que les berges de l’Arno circonscrivent comme l’essence même de la beauté.Les berges de l'Arno, où commencer à l’Être.
Qu’est-ce donc, ce que le promeneur florentin croit pouvoir recouvrer ? Des poètes, des peintres, qu’attendre dans le silence de l’aube éclairé d’un ciel peu à peu descendu, comme on le dit au théâtre des cintres où les machineries usent les textes jusqu’à leur corde ? Elle abordait, l’heure marquée de l’énigmatique dialogue avec soi, exposée aux variations chaotiques du flux de l’Arno redessinant sans cesse les rives et les fonds de son lit. Tout le Paradis de Dante est hanté par l’impossibilité d’écrire le Paradis. Mais la concorde qui régit les âmes sauvées exhale de désir, du tourbillon dans cet ailleurs du monde que les berges de l’Arno circonscrivent comme l’essence même de la beauté.Les berges de l'Arno, où commencer à l’Être. Un court essai, percutent, pertinent, passionnant et d’une richesse intellectuelle peu commune. Pierrandrea Amato s’empare ici d’un sujet plus difficile qu’il n’y paraît, qu’il thématise en virtuose, multipliant ses lectures pour en féconder l’événement et nous inciter à en poursuivre la route, débusquant des textes incroyables pour nourrir cette réflexion, comme celui du jeune Lévinas croisant déjà le fer dans les années 30 avec Heidegger, ou ceux du dernier Foucault, magistral. Un sujet qu’il thématise plus qu’il ne théorise : une théorie de la révolte serait aussi stupide que factice. Le tout dans une écriture volontiers aphoristique plutôt qu’analytique, serrant ainsi au plus près le sens qu’elle ose débusquer. Car il ne s’agit pas de penser la révolte dans une quelconque limpidité conceptuelle, mais bien au contraire dans l’impureté d’une praxis qu’aucune théorie ne saurait réduire.
Un court essai, percutent, pertinent, passionnant et d’une richesse intellectuelle peu commune. Pierrandrea Amato s’empare ici d’un sujet plus difficile qu’il n’y paraît, qu’il thématise en virtuose, multipliant ses lectures pour en féconder l’événement et nous inciter à en poursuivre la route, débusquant des textes incroyables pour nourrir cette réflexion, comme celui du jeune Lévinas croisant déjà le fer dans les années 30 avec Heidegger, ou ceux du dernier Foucault, magistral. Un sujet qu’il thématise plus qu’il ne théorise : une théorie de la révolte serait aussi stupide que factice. Le tout dans une écriture volontiers aphoristique plutôt qu’analytique, serrant ainsi au plus près le sens qu’elle ose débusquer. Car il ne s’agit pas de penser la révolte dans une quelconque limpidité conceptuelle, mais bien au contraire dans l’impureté d’une praxis qu’aucune théorie ne saurait réduire.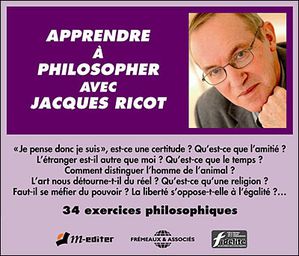 S’étonner. La philosophie n’a point d’autre origine. Non pas qu’il faille demeurer stupéfait devant l’incompréhensible ou s‘émerveiller de ce que le monde soit et se tenir là, bouche bée, dans l’attente d’une révélation qu’il est peut-être bien incapable de nous fournir. Non, s’étonner, au sens où les grecs l’entendaient, d’un fracas qui nous mettrait en mouvement et nous convierait à voir les choses autrement qu’elles ne paraissent. S’interroger à nouveau frais encore et encore et pousser dans la chair même du monde le mouvement de cet étonnement.
S’étonner. La philosophie n’a point d’autre origine. Non pas qu’il faille demeurer stupéfait devant l’incompréhensible ou s‘émerveiller de ce que le monde soit et se tenir là, bouche bée, dans l’attente d’une révélation qu’il est peut-être bien incapable de nous fournir. Non, s’étonner, au sens où les grecs l’entendaient, d’un fracas qui nous mettrait en mouvement et nous convierait à voir les choses autrement qu’elles ne paraissent. S’interroger à nouveau frais encore et encore et pousser dans la chair même du monde le mouvement de cet étonnement. Commence-t-on à, ou commence-t-on de ?
Commence-t-on à, ou commence-t-on de ? Ce livre est un monument.
Ce livre est un monument. L’Occident s’était inventé un bel objet: la pensée noire était au mieux une gnose doublée d’une raison orale hasardeuse, incapable d’organiser correctement le raisonnement sur le modèle de notre logique. Si elle avait produit des savoirs, ils émargeaient volontiers aux "recettes de bonnes femmes".
L’Occident s’était inventé un bel objet: la pensée noire était au mieux une gnose doublée d’une raison orale hasardeuse, incapable d’organiser correctement le raisonnement sur le modèle de notre logique. Si elle avait produit des savoirs, ils émargeaient volontiers aux "recettes de bonnes femmes".