 Cette sorte de chef-d’œuvre littéraire d’un ancien militaire français converti après dix ans de coloniale à la littérature s’ouvre sur le bonheur d’écrire, au plus près d’une vision sensuellement reconstruite d’un ventre de femme délicatement rebondi, à la langueur toute charnelle, fascinant de blancheur et offert autant à la vue du narrateur qu’à celle du lecteur. Le ventre nu d’une femme. Algérienne. Et le couteau qui l’ouvre. Un coup, l’autre, dans cet assassinat exécuté comme l’un des beaux arts de l’armée coloniale, tandis que notre narrateur songe aux grandes tueries humaines pleines de cette grandeur sombre qui sied tellement aux récits de guerre, quand il n’a, lui, rien de plus grand à offrir que ce ventre pénétré, dépecé, perforé. Tuez les arabes ! Les hommes, les femmes. Ses chefs le lui en ont donné l’ordre. Il s’exécute. Il tue. Rien de plus normal, puisque tout le monde tue autour de lui. Les arabes. Un sport. Une activité de loisir presque. Nous offrant au passage la vision d’une Algérie étouffée, d’un peuple soudain enfermé dans nos vices, bafoué, exécuté. Nous sommes en 1886. Le narrateur vit en Algérie depuis dix ans. Il parle l’arabe, aime s’habiller en arabe, aime ce pays et ses femmes voluptueuses, ne nous épargnant aucun des clichés de l’orientalisme falot qui anime la grande épopée coloniale française pour mieux les travailler au corps si l’on peut dire, en jouer avec habileté pour construire la seule chose qui lui importe : son œuvre, son écriture, ces phrases belles, intelligentes et fortes, admirablement travaillées, admirablement rythmées. Il raconte. Une histoire, un conte, une fable qui lui vaudra enfin la renommée dans les salons littéraires. Il raconte les arabes, par "fournées", envoyés au bagne (Cayenne), ou au "Bureau arabe", vrai centre de torture. Il raconte les marches forcées dans le désert des villageois raflés, les cadavres jalonnant leur chemin, les exécutions sommaires. Il raconte le mépris des troupes françaises à l’égard des populations autochtones, l’indifférence quant à leur traitement, inhumain cela va de soi, ils sont si peu des hommes. Il raconte encore l’ennui dans les régions pacifiées, moins du fait d’une quelconque réussite de la politique coloniale française, que de la volonté des indigènes à vivre en bonne intelligence avec l’envahisseur pour tenter de préserver leurs familles. Autant qu’ils le peuvent. C’est-à-dire jamais bien longtemps, car rien ne peut venir à bout de la volonté de guerre des militaires français : ils savent, eux, que leur avancement se fait au sabre, qu’on ne gagne du galon qu’en tranchant les têtes, qu’en brûlant les villages. Alors ils s’emploient à provoquer continuellement les populations. Ou bien à inventer n’importe quel prétexte pour fomenter un désordre. Ici une poule volée à un colon, dont un capitaine en mal de promotion exige réparation. Qu’on lui livre un coupable. N’importe quel homme fera l’affaire, pourvu qu’il puisse l’exécuter sommairement devant tout le village rassemblé, avec l’espoir que ce meurtre poussera les villageois à l’indignation, à quelque remous de foule qui légitimera que l’on charge et rédige ensuite un rapport à l’Administration pour dénoncer une rébellion plus ample. Alors débute la chasse à l’homme. On traque l’arabe comme une bête, avec pour seule consigne "pas de quartier". On brûle les villages, on sabre les femmes, les enfants, on cerne les survivants, ici 200 à 300, poussés dans les montagnes, au creux des rochers, exténués de fatigue, mourant de faim et de soif, tandis que deux milles hommes en armes les encerclent et les mitraillent… Les Einsatzgruppen avant l’heure. On songe aux premières expérimentations de la Solution Finale conçues par Hitler, au 101ème bataillon de réserve de la gendarmerie allemande, parcourant les campagnes polonaises pour exécuter systématiquement les populations juives raflées. Des méthodes directement importées des colonies semble-t-il.
Cette sorte de chef-d’œuvre littéraire d’un ancien militaire français converti après dix ans de coloniale à la littérature s’ouvre sur le bonheur d’écrire, au plus près d’une vision sensuellement reconstruite d’un ventre de femme délicatement rebondi, à la langueur toute charnelle, fascinant de blancheur et offert autant à la vue du narrateur qu’à celle du lecteur. Le ventre nu d’une femme. Algérienne. Et le couteau qui l’ouvre. Un coup, l’autre, dans cet assassinat exécuté comme l’un des beaux arts de l’armée coloniale, tandis que notre narrateur songe aux grandes tueries humaines pleines de cette grandeur sombre qui sied tellement aux récits de guerre, quand il n’a, lui, rien de plus grand à offrir que ce ventre pénétré, dépecé, perforé. Tuez les arabes ! Les hommes, les femmes. Ses chefs le lui en ont donné l’ordre. Il s’exécute. Il tue. Rien de plus normal, puisque tout le monde tue autour de lui. Les arabes. Un sport. Une activité de loisir presque. Nous offrant au passage la vision d’une Algérie étouffée, d’un peuple soudain enfermé dans nos vices, bafoué, exécuté. Nous sommes en 1886. Le narrateur vit en Algérie depuis dix ans. Il parle l’arabe, aime s’habiller en arabe, aime ce pays et ses femmes voluptueuses, ne nous épargnant aucun des clichés de l’orientalisme falot qui anime la grande épopée coloniale française pour mieux les travailler au corps si l’on peut dire, en jouer avec habileté pour construire la seule chose qui lui importe : son œuvre, son écriture, ces phrases belles, intelligentes et fortes, admirablement travaillées, admirablement rythmées. Il raconte. Une histoire, un conte, une fable qui lui vaudra enfin la renommée dans les salons littéraires. Il raconte les arabes, par "fournées", envoyés au bagne (Cayenne), ou au "Bureau arabe", vrai centre de torture. Il raconte les marches forcées dans le désert des villageois raflés, les cadavres jalonnant leur chemin, les exécutions sommaires. Il raconte le mépris des troupes françaises à l’égard des populations autochtones, l’indifférence quant à leur traitement, inhumain cela va de soi, ils sont si peu des hommes. Il raconte encore l’ennui dans les régions pacifiées, moins du fait d’une quelconque réussite de la politique coloniale française, que de la volonté des indigènes à vivre en bonne intelligence avec l’envahisseur pour tenter de préserver leurs familles. Autant qu’ils le peuvent. C’est-à-dire jamais bien longtemps, car rien ne peut venir à bout de la volonté de guerre des militaires français : ils savent, eux, que leur avancement se fait au sabre, qu’on ne gagne du galon qu’en tranchant les têtes, qu’en brûlant les villages. Alors ils s’emploient à provoquer continuellement les populations. Ou bien à inventer n’importe quel prétexte pour fomenter un désordre. Ici une poule volée à un colon, dont un capitaine en mal de promotion exige réparation. Qu’on lui livre un coupable. N’importe quel homme fera l’affaire, pourvu qu’il puisse l’exécuter sommairement devant tout le village rassemblé, avec l’espoir que ce meurtre poussera les villageois à l’indignation, à quelque remous de foule qui légitimera que l’on charge et rédige ensuite un rapport à l’Administration pour dénoncer une rébellion plus ample. Alors débute la chasse à l’homme. On traque l’arabe comme une bête, avec pour seule consigne "pas de quartier". On brûle les villages, on sabre les femmes, les enfants, on cerne les survivants, ici 200 à 300, poussés dans les montagnes, au creux des rochers, exténués de fatigue, mourant de faim et de soif, tandis que deux milles hommes en armes les encerclent et les mitraillent… Les Einsatzgruppen avant l’heure. On songe aux premières expérimentations de la Solution Finale conçues par Hitler, au 101ème bataillon de réserve de la gendarmerie allemande, parcourant les campagnes polonaises pour exécuter systématiquement les populations juives raflées. Des méthodes directement importées des colonies semble-t-il.
Il faut lire ce récit enfin réédité, qui ouvre grand les yeux sur ce que fut la colonisation de l’Algérie racontée de l’intérieur par un militaire français. Un témoignage ahurissant sur le peu de moralité de cette armée et sa prétendue mission civilisatrice. Un témoignage ahurissant sur le lyrisme du viol, de la razzia, du meurtre de masse qui traversait alors ses rangs. Un témoignage… S’il n’était plutôt un récit tout entier traversé par ce curieux bonheur de la chose racontée, tournant autour de son objet avec ravissement, animant ce goût commun aux hommes de lettres, un delectare insupportable en fin de compte, faisant un conte de ces atrocités. Le meurtre de masse en Algérie, dont on aurait tort de n’en faire qu’un genre littéraire virtuose. --joël jégouzo--.
Sous le burnous, de hector France, préface d’Eric Dussert, éd. Anacharsis, avril 2011, 202 pages, 17 euros, ean : 978-2-914777-759.
 Superbe analyse de Nacira Guenif dans le numéro d’été de la revue Ravages, qui étudie la généalogie et les déplacements d’usage du terme "beur", vieux de quarante ans déjà, sans que personne ne se soit vraiment interrogé sur la validité de ce qu’il fondait. Un terme promu dans les années Mitterrand, euphémisant la charge ethnique, édulcorant la charge coloniale pour amortir l’origine immigrée de ceux qu’il englobait, des jeunes gens que l’on voulait alors avenants, malléables. Un terme destiné à supplanter dans l’imaginaire national celui de bougnoule, ou de raton, bien que leur usage n’ait pas vraiment cessé dans cette France tout en rose qui offrait à l’arabe de prendre place dans le périmètre national sous un nouveau vocable lénifiant. Une place qu’on lui offrait, certes, mais non sans condition. Beur, c’est-à-dire qu’il lui restait à devenir français -alors qu’il l’était depuis deux générations déjà… Beur, c’est-à-dire qu’il avait à se soumettre, gentiment, à la domestication qu’on lui avait réservée, rien que pour lui, en vue de son assimilation définitive. Une période probatoire en somme, s’ouvrait devant lui, toujours inachevée vers la fin des années 90, et dont on pouvait soupçonner à la longue qu’elle avait essentiellement été conçue pour n’être pas achevée, en ce sens que peu désiraient la voir prendre fin sinon par sa disparition pure et simple, tant le vernis de la double culture que l’on avait un temps encensé (le rap, le slam, le langage des tecis) ne paraissait acceptable que dissout dans la culture française dite de souche, récupérant in extremis ces excroissances désordonnées pour les passer à la moulinette de ses prétendues normes : le tag entrait dans les musées, mais au terme d’un sérieux nettoyage esthétique rejetant loin du musée ses surcharges ethniques.
Superbe analyse de Nacira Guenif dans le numéro d’été de la revue Ravages, qui étudie la généalogie et les déplacements d’usage du terme "beur", vieux de quarante ans déjà, sans que personne ne se soit vraiment interrogé sur la validité de ce qu’il fondait. Un terme promu dans les années Mitterrand, euphémisant la charge ethnique, édulcorant la charge coloniale pour amortir l’origine immigrée de ceux qu’il englobait, des jeunes gens que l’on voulait alors avenants, malléables. Un terme destiné à supplanter dans l’imaginaire national celui de bougnoule, ou de raton, bien que leur usage n’ait pas vraiment cessé dans cette France tout en rose qui offrait à l’arabe de prendre place dans le périmètre national sous un nouveau vocable lénifiant. Une place qu’on lui offrait, certes, mais non sans condition. Beur, c’est-à-dire qu’il lui restait à devenir français -alors qu’il l’était depuis deux générations déjà… Beur, c’est-à-dire qu’il avait à se soumettre, gentiment, à la domestication qu’on lui avait réservée, rien que pour lui, en vue de son assimilation définitive. Une période probatoire en somme, s’ouvrait devant lui, toujours inachevée vers la fin des années 90, et dont on pouvait soupçonner à la longue qu’elle avait essentiellement été conçue pour n’être pas achevée, en ce sens que peu désiraient la voir prendre fin sinon par sa disparition pure et simple, tant le vernis de la double culture que l’on avait un temps encensé (le rap, le slam, le langage des tecis) ne paraissait acceptable que dissout dans la culture française dite de souche, récupérant in extremis ces excroissances désordonnées pour les passer à la moulinette de ses prétendues normes : le tag entrait dans les musées, mais au terme d’un sérieux nettoyage esthétique rejetant loin du musée ses surcharges ethniques.  L’emploi du mot, analyse encore Nacira Guenif, traduisait aussi un embarras en fin de compte, témoignant de la nécessité de revoir la fable coloniale pour construire un récit post-colonial que l’on sentait partout en gestation, mais que l’on ne s’empressait pas d’accompagner. Car bien que censé incarner les jeunes issus de l’immigration maghrébine, le terme de beur en faisait des êtres sans filiation, sans passé ni avenir –voire sans âge, d’une jeunesse éternellement prescrite, où les enfermer commodément. Être beur, c’était au fond "abolir la part de soi jugée incompatible avec l’entrée en citoyenneté républicaine", à savoir : la part maghrébine.
L’emploi du mot, analyse encore Nacira Guenif, traduisait aussi un embarras en fin de compte, témoignant de la nécessité de revoir la fable coloniale pour construire un récit post-colonial que l’on sentait partout en gestation, mais que l’on ne s’empressait pas d’accompagner. Car bien que censé incarner les jeunes issus de l’immigration maghrébine, le terme de beur en faisait des êtres sans filiation, sans passé ni avenir –voire sans âge, d’une jeunesse éternellement prescrite, où les enfermer commodément. Être beur, c’était au fond "abolir la part de soi jugée incompatible avec l’entrée en citoyenneté républicaine", à savoir : la part maghrébine. 


 Cette sorte de chef-d’œuvre littéraire d’un ancien militaire français converti après dix ans de coloniale à la littérature s’ouvre sur le bonheur d’écrire, au plus près d’une vision sensuellement reconstruite d’un ventre de femme délicatement rebondi, à la langueur toute charnelle, fascinant de blancheur et offert autant à la vue du narrateur qu’à celle du lecteur. Le ventre nu d’une femme. Algérienne. Et le couteau qui l’ouvre. Un coup, l’autre, dans cet assassinat exécuté comme l’un des beaux arts de l’armée coloniale, tandis que notre narrateur songe aux grandes tueries humaines pleines de cette grandeur sombre qui sied tellement aux récits de guerre, quand il n’a, lui, rien de plus grand à offrir que ce ventre pénétré, dépecé, perforé. Tuez les arabes ! Les hommes, les femmes. Ses chefs le lui en ont donné l’ordre. Il s’exécute. Il tue. Rien de plus normal, puisque tout le monde tue autour de lui. Les arabes. Un sport. Une activité de loisir presque. Nous offrant au passage la vision d’une Algérie étouffée, d’un peuple soudain enfermé dans nos vices, bafoué, exécuté. Nous sommes en 1886. Le narrateur vit en Algérie depuis dix ans. Il parle l’arabe, aime s’habiller en arabe, aime ce pays et ses femmes voluptueuses, ne nous épargnant aucun des clichés de l’orientalisme falot qui anime la grande épopée coloniale française pour mieux les travailler au corps si l’on peut dire, en jouer avec habileté pour construire la seule chose qui lui importe : son œuvre, son écriture, ces phrases belles, intelligentes et fortes, admirablement travaillées, admirablement rythmées. Il raconte. Une histoire, un conte, une fable qui lui vaudra enfin la renommée dans les salons littéraires. Il raconte les arabes, par "fournées", envoyés au bagne (Cayenne), ou au "Bureau arabe", vrai centre de torture. Il raconte les marches forcées dans le désert des villageois raflés, les cadavres jalonnant leur chemin, les exécutions sommaires. Il raconte le mépris des troupes françaises à l’égard des populations autochtones, l’indifférence quant à leur traitement, inhumain cela va de soi, ils sont si peu des hommes. Il raconte encore l’ennui dans les régions pacifiées, moins du fait d’une quelconque réussite de la politique coloniale française, que de la volonté des indigènes à vivre en bonne intelligence avec l’envahisseur pour tenter de préserver leurs familles. Autant qu’ils le peuvent. C’est-à-dire jamais bien longtemps, car rien ne peut venir à bout de la volonté de guerre des militaires français : ils savent, eux, que leur avancement se fait au sabre, qu’on ne gagne du galon qu’en tranchant les têtes, qu’en brûlant les villages. Alors ils s’emploient à provoquer continuellement les populations. Ou bien à inventer n’importe quel prétexte pour fomenter un désordre. Ici une poule volée à un colon, dont un capitaine en mal de promotion exige réparation. Qu’on lui livre un coupable. N’importe quel homme fera l’affaire, pourvu qu’il puisse l’exécuter sommairement devant tout le village rassemblé, avec l’espoir que ce meurtre poussera les villageois à l’indignation, à quelque remous de foule qui légitimera que l’on charge et rédige ensuite un rapport à l’Administration pour dénoncer une rébellion plus ample. Alors débute la chasse à l’homme. On traque l’arabe comme une bête, avec pour seule consigne "pas de quartier". On brûle les villages, on sabre les femmes, les enfants, on cerne les survivants, ici 200 à 300, poussés dans les montagnes, au creux des rochers, exténués de fatigue, mourant de faim et de soif, tandis que deux milles hommes en armes les encerclent et les mitraillent… Les Einsatzgruppen avant l’heure. On songe aux premières expérimentations de la Solution Finale conçues par Hitler, au 101ème bataillon de réserve de la gendarmerie allemande, parcourant les campagnes polonaises pour exécuter systématiquement les populations juives raflées. Des méthodes directement importées des colonies semble-t-il.
Cette sorte de chef-d’œuvre littéraire d’un ancien militaire français converti après dix ans de coloniale à la littérature s’ouvre sur le bonheur d’écrire, au plus près d’une vision sensuellement reconstruite d’un ventre de femme délicatement rebondi, à la langueur toute charnelle, fascinant de blancheur et offert autant à la vue du narrateur qu’à celle du lecteur. Le ventre nu d’une femme. Algérienne. Et le couteau qui l’ouvre. Un coup, l’autre, dans cet assassinat exécuté comme l’un des beaux arts de l’armée coloniale, tandis que notre narrateur songe aux grandes tueries humaines pleines de cette grandeur sombre qui sied tellement aux récits de guerre, quand il n’a, lui, rien de plus grand à offrir que ce ventre pénétré, dépecé, perforé. Tuez les arabes ! Les hommes, les femmes. Ses chefs le lui en ont donné l’ordre. Il s’exécute. Il tue. Rien de plus normal, puisque tout le monde tue autour de lui. Les arabes. Un sport. Une activité de loisir presque. Nous offrant au passage la vision d’une Algérie étouffée, d’un peuple soudain enfermé dans nos vices, bafoué, exécuté. Nous sommes en 1886. Le narrateur vit en Algérie depuis dix ans. Il parle l’arabe, aime s’habiller en arabe, aime ce pays et ses femmes voluptueuses, ne nous épargnant aucun des clichés de l’orientalisme falot qui anime la grande épopée coloniale française pour mieux les travailler au corps si l’on peut dire, en jouer avec habileté pour construire la seule chose qui lui importe : son œuvre, son écriture, ces phrases belles, intelligentes et fortes, admirablement travaillées, admirablement rythmées. Il raconte. Une histoire, un conte, une fable qui lui vaudra enfin la renommée dans les salons littéraires. Il raconte les arabes, par "fournées", envoyés au bagne (Cayenne), ou au "Bureau arabe", vrai centre de torture. Il raconte les marches forcées dans le désert des villageois raflés, les cadavres jalonnant leur chemin, les exécutions sommaires. Il raconte le mépris des troupes françaises à l’égard des populations autochtones, l’indifférence quant à leur traitement, inhumain cela va de soi, ils sont si peu des hommes. Il raconte encore l’ennui dans les régions pacifiées, moins du fait d’une quelconque réussite de la politique coloniale française, que de la volonté des indigènes à vivre en bonne intelligence avec l’envahisseur pour tenter de préserver leurs familles. Autant qu’ils le peuvent. C’est-à-dire jamais bien longtemps, car rien ne peut venir à bout de la volonté de guerre des militaires français : ils savent, eux, que leur avancement se fait au sabre, qu’on ne gagne du galon qu’en tranchant les têtes, qu’en brûlant les villages. Alors ils s’emploient à provoquer continuellement les populations. Ou bien à inventer n’importe quel prétexte pour fomenter un désordre. Ici une poule volée à un colon, dont un capitaine en mal de promotion exige réparation. Qu’on lui livre un coupable. N’importe quel homme fera l’affaire, pourvu qu’il puisse l’exécuter sommairement devant tout le village rassemblé, avec l’espoir que ce meurtre poussera les villageois à l’indignation, à quelque remous de foule qui légitimera que l’on charge et rédige ensuite un rapport à l’Administration pour dénoncer une rébellion plus ample. Alors débute la chasse à l’homme. On traque l’arabe comme une bête, avec pour seule consigne "pas de quartier". On brûle les villages, on sabre les femmes, les enfants, on cerne les survivants, ici 200 à 300, poussés dans les montagnes, au creux des rochers, exténués de fatigue, mourant de faim et de soif, tandis que deux milles hommes en armes les encerclent et les mitraillent… Les Einsatzgruppen avant l’heure. On songe aux premières expérimentations de la Solution Finale conçues par Hitler, au 101ème bataillon de réserve de la gendarmerie allemande, parcourant les campagnes polonaises pour exécuter systématiquement les populations juives raflées. Des méthodes directement importées des colonies semble-t-il. La revue Agone publie pour son numéro de printemps un dossier tout entier consacré à Orwell –en fait la publication des minutes d’un colloque qui s’est tenu à Lille les 19 et 20 mars 2010 : "G. Orwell, une conscience politique du XXème siècle").
La revue Agone publie pour son numéro de printemps un dossier tout entier consacré à Orwell –en fait la publication des minutes d’un colloque qui s’est tenu à Lille les 19 et 20 mars 2010 : "G. Orwell, une conscience politique du XXème siècle").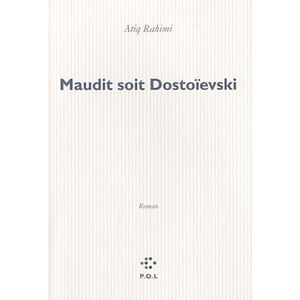 Bouge, Rassoul, bouge ! La hache fend le crâne, Rassoul est foudroyé par le souvenir d’une lecture russe. Bouge Rassoul, Raskolnikov ne peut rien pour toi ! Il a tué la vieille. Prendre son fric. Ses bijoux. Fuir. Bouge Rassoul. Mais il ne bouge pas. Le sang, un mince filet inique, dégouline du bras vers le sol. Une voix s’élève dans la maison. La tuer aussi ? Bouge Rassoul. Il décolle enfin, s’enfuit, saute du toit, se blesse, court, oublie les traces, l’argent, les bijoux. Bouge Rassoul. N’importe où. Raskolnikov à ses trousses, qui l’a arrêté net au moment de tuer une seconde fois. Maudit Dosto qui a fait de lui un criminel idiot ! Rassoul, et l’argent ? Rassoul retourne sur les lieux du crime, croise le regard d’une femme en tchadori bleu, la suit, la perd dans la foule. Kaboul. Une roquette explose. Une seconde. Le chaos. Et Rassoul pitoyable au milieu de ce chaos, un billet de cinq afghanis en main pour tout salaire de son crime -le meurtre de l’usurière, pour rien. Il donne même le billet à une pauvre. Quel rachat ! Une tache de sang sur la chemise : le sien, celui de l’usurière ou bien un autre encore ? Tout se mélange. Feedback : l’Armée Rouge vient de quitter l’Afghanistan. Rassoul rentre de Leningrad. Un cahier sous le bras, notes d’un amoureux transi, timide, incapable de déclarer sa flamme. Il rentre avec ses bouquins de Dosto. En russe. Ici, à Kaboul, où la ville se terre, oublie la vie, l’amour, l’amitié. Alors son meurtre, piètre Raskolnikov cherchant un châtiment quand, à Kaboul, le flic qui l’interroge s’intéresse davantage à son passé soviétique qu’à ce meurtre sans importance –d’ailleurs le cadavre a disparu, il n’y a plus ni meurtre ni coupable, à peine cette culpabilité confuse dont Rassoul ne sait rien faire. Le meurtre d’une vieille usurière, et après ? Si bien qu’il ne peut exister de rédemption possible pour un meurtre dont tout le monde se fiche. Par pitié, un châtiment ! Tout disparaît, le corps de la victime, le témoin, cette ombre en tchadori bleu qui erre comme un fantôme, qui tourne et qui revient, la hache aussi bien, qui s’élève et s’abat, ce coup qu’il n’a pu donner, qu’il a donné, la hache peut-être, seule, a poursuivi sa course jusqu’au crâne de la défunte. Bouge Rassoul ! Il ne bouge plus. Le récit s’arrime au centre de ce foyer, mort, tourbillonne autour, valse, tourne et retourne les possibilités du crime, cette femme en tchadori bleu obsédante enroulée à son ombre, évidant le monde tandis que le récit s’évide lui-même pour que le monde ne soit plus qu’un volume sans matière, sans poids, sans justice possible. Coupable, mais de quoi donc ? Rassoul s’endort, se réveille, s’endort de nouveau, passe son temps à sombrer dans le sommeil, à s’évanouir, à revenir à lui pour sombrer de nouveau dans le dormant du récit, Kaboul, le souffle de la guerre, terreur et braises où les morts et les vivants se confondent dans un décompte que nul ne peut tenir –de quoi donc mourrons-nous quand aucune culpabilité n’est possible ? --
Bouge, Rassoul, bouge ! La hache fend le crâne, Rassoul est foudroyé par le souvenir d’une lecture russe. Bouge Rassoul, Raskolnikov ne peut rien pour toi ! Il a tué la vieille. Prendre son fric. Ses bijoux. Fuir. Bouge Rassoul. Mais il ne bouge pas. Le sang, un mince filet inique, dégouline du bras vers le sol. Une voix s’élève dans la maison. La tuer aussi ? Bouge Rassoul. Il décolle enfin, s’enfuit, saute du toit, se blesse, court, oublie les traces, l’argent, les bijoux. Bouge Rassoul. N’importe où. Raskolnikov à ses trousses, qui l’a arrêté net au moment de tuer une seconde fois. Maudit Dosto qui a fait de lui un criminel idiot ! Rassoul, et l’argent ? Rassoul retourne sur les lieux du crime, croise le regard d’une femme en tchadori bleu, la suit, la perd dans la foule. Kaboul. Une roquette explose. Une seconde. Le chaos. Et Rassoul pitoyable au milieu de ce chaos, un billet de cinq afghanis en main pour tout salaire de son crime -le meurtre de l’usurière, pour rien. Il donne même le billet à une pauvre. Quel rachat ! Une tache de sang sur la chemise : le sien, celui de l’usurière ou bien un autre encore ? Tout se mélange. Feedback : l’Armée Rouge vient de quitter l’Afghanistan. Rassoul rentre de Leningrad. Un cahier sous le bras, notes d’un amoureux transi, timide, incapable de déclarer sa flamme. Il rentre avec ses bouquins de Dosto. En russe. Ici, à Kaboul, où la ville se terre, oublie la vie, l’amour, l’amitié. Alors son meurtre, piètre Raskolnikov cherchant un châtiment quand, à Kaboul, le flic qui l’interroge s’intéresse davantage à son passé soviétique qu’à ce meurtre sans importance –d’ailleurs le cadavre a disparu, il n’y a plus ni meurtre ni coupable, à peine cette culpabilité confuse dont Rassoul ne sait rien faire. Le meurtre d’une vieille usurière, et après ? Si bien qu’il ne peut exister de rédemption possible pour un meurtre dont tout le monde se fiche. Par pitié, un châtiment ! Tout disparaît, le corps de la victime, le témoin, cette ombre en tchadori bleu qui erre comme un fantôme, qui tourne et qui revient, la hache aussi bien, qui s’élève et s’abat, ce coup qu’il n’a pu donner, qu’il a donné, la hache peut-être, seule, a poursuivi sa course jusqu’au crâne de la défunte. Bouge Rassoul ! Il ne bouge plus. Le récit s’arrime au centre de ce foyer, mort, tourbillonne autour, valse, tourne et retourne les possibilités du crime, cette femme en tchadori bleu obsédante enroulée à son ombre, évidant le monde tandis que le récit s’évide lui-même pour que le monde ne soit plus qu’un volume sans matière, sans poids, sans justice possible. Coupable, mais de quoi donc ? Rassoul s’endort, se réveille, s’endort de nouveau, passe son temps à sombrer dans le sommeil, à s’évanouir, à revenir à lui pour sombrer de nouveau dans le dormant du récit, Kaboul, le souffle de la guerre, terreur et braises où les morts et les vivants se confondent dans un décompte que nul ne peut tenir –de quoi donc mourrons-nous quand aucune culpabilité n’est possible ? --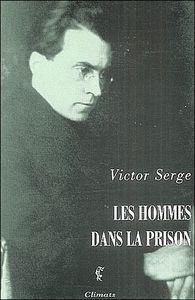
 Dernier texte de Cioran écrit en roumain, confectionné pendant la Guerre, dans le Paris occupé. Cioran vit alors en foyers universitaires, voire dans ces chambres d’hôtels insalubres qu’il affectionne. Il a été pendant trois ans professeur de philosophie, a publié cinq livres, affirmé avec force que l’éthique n’existait pas, mais il demeure un parfait inconnu en France. Cioran se cherche, ne sait pas que son exil sera définitif et qu’il endossera à la perfection une nouvelle identité de métèque. Il dresse le bilan de sa vie, amer. Il n’a pas d’avenir, juste un passé trop encombrant : son identité roumaine non seulement lui pèse et, il le pressent, elle est un obstacle à sa réalisation. Cioran aspire à quelque chose de plus ample, qui refuserait toute limite, celle de la raison comme celle des sentiments. Quelque chose d’excessif. Qui ait la saveur de l’irréparable. l’ouvrage qu’il conçoit en porte la marque, débraillé, inaccompli, refusant la clôture des textes trop bien pensés, trop bien écrits. Mais il ne le publiera pas. Il l’oubliera même, pendant près de quarante ans pour le premier volume, totalement pour le second qui ne sera retrouvé qu’après sa mort, en 1995. Mais même pour le premier, Cioran voudra d’abord le détruire, avant de consentir à l’éditer en lui apportant malheureusement quelques retouches qui en gâteront la spontanéité. C’est que l’ouvrage ne lui plaît pas. Pas assez affirmé. Il y a pourtant déjà tout Cioran là. Mais peut-être en effet, est-il encore trop occupé à renoncer à son identité roumaine qu’il déconstruit vigoureusement, tout comme aux valeurs qui fondent encore cette Europe haineuse et qu’il a en partage.
Dernier texte de Cioran écrit en roumain, confectionné pendant la Guerre, dans le Paris occupé. Cioran vit alors en foyers universitaires, voire dans ces chambres d’hôtels insalubres qu’il affectionne. Il a été pendant trois ans professeur de philosophie, a publié cinq livres, affirmé avec force que l’éthique n’existait pas, mais il demeure un parfait inconnu en France. Cioran se cherche, ne sait pas que son exil sera définitif et qu’il endossera à la perfection une nouvelle identité de métèque. Il dresse le bilan de sa vie, amer. Il n’a pas d’avenir, juste un passé trop encombrant : son identité roumaine non seulement lui pèse et, il le pressent, elle est un obstacle à sa réalisation. Cioran aspire à quelque chose de plus ample, qui refuserait toute limite, celle de la raison comme celle des sentiments. Quelque chose d’excessif. Qui ait la saveur de l’irréparable. l’ouvrage qu’il conçoit en porte la marque, débraillé, inaccompli, refusant la clôture des textes trop bien pensés, trop bien écrits. Mais il ne le publiera pas. Il l’oubliera même, pendant près de quarante ans pour le premier volume, totalement pour le second qui ne sera retrouvé qu’après sa mort, en 1995. Mais même pour le premier, Cioran voudra d’abord le détruire, avant de consentir à l’éditer en lui apportant malheureusement quelques retouches qui en gâteront la spontanéité. C’est que l’ouvrage ne lui plaît pas. Pas assez affirmé. Il y a pourtant déjà tout Cioran là. Mais peut-être en effet, est-il encore trop occupé à renoncer à son identité roumaine qu’il déconstruit vigoureusement, tout comme aux valeurs qui fondent encore cette Europe haineuse et qu’il a en partage.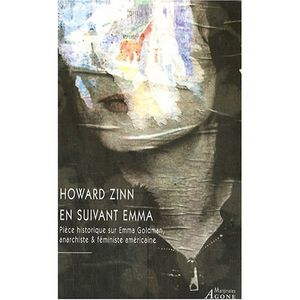 Hommage d’Howard Zinn à une anarchiste que l’Histoire officielle s’est empressée d’écarter de son champ. Sans doute n’était-elle pas digne d’être étudiée, ainsi qu’il en va avec les militants ordinaires que les honneurs n’intéressent pas, ni moins un quelconque accomplissement social. Une vie passionnante cela dit, que celle d’Emma Goldman, native de Kovno (Lituanie russe, 1869), juive, émigrée enfant avec ses parents dans l’Etat de New York, plongée dans le monde du travail à la chaîne dès sa seizième année. Mariée contre son gré par un père tyrannique, la lecture la sauva : à 17 ans Emma fuit sa famille, rallie Chicago, alors place forte de la contestation ouvrière américaine. Elle y vit ses premières luttes, y rode son discours révolutionnaire avant de s’établir à New York, pour y organiser les travailleurs immigrés. La famine sévit, leurs enfants, plus frappés par la misère que n’importe quelle autre catégorie de population, crèvent littéralement de faim. Lors d’un meeting, Emma appelle la foule à piller les magasins. Condamnée à deux ans de prison, sa réputation est faite. Infatigable, elle ne cessera de sillonner l’Amérique de conférences en meetings pour soulever les consciences. Déportée en URSS en 1918 à cause de ses prises de position contre l’entrée en guerre des Etats-Unis, elle s’enfuira d’URSS juste après la répression sanglante des marins de Kronstadt,
Hommage d’Howard Zinn à une anarchiste que l’Histoire officielle s’est empressée d’écarter de son champ. Sans doute n’était-elle pas digne d’être étudiée, ainsi qu’il en va avec les militants ordinaires que les honneurs n’intéressent pas, ni moins un quelconque accomplissement social. Une vie passionnante cela dit, que celle d’Emma Goldman, native de Kovno (Lituanie russe, 1869), juive, émigrée enfant avec ses parents dans l’Etat de New York, plongée dans le monde du travail à la chaîne dès sa seizième année. Mariée contre son gré par un père tyrannique, la lecture la sauva : à 17 ans Emma fuit sa famille, rallie Chicago, alors place forte de la contestation ouvrière américaine. Elle y vit ses premières luttes, y rode son discours révolutionnaire avant de s’établir à New York, pour y organiser les travailleurs immigrés. La famine sévit, leurs enfants, plus frappés par la misère que n’importe quelle autre catégorie de population, crèvent littéralement de faim. Lors d’un meeting, Emma appelle la foule à piller les magasins. Condamnée à deux ans de prison, sa réputation est faite. Infatigable, elle ne cessera de sillonner l’Amérique de conférences en meetings pour soulever les consciences. Déportée en URSS en 1918 à cause de ses prises de position contre l’entrée en guerre des Etats-Unis, elle s’enfuira d’URSS juste après la répression sanglante des marins de Kronstadt,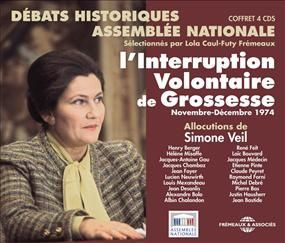 Un débat que ne referma pourtant pas la Loi votée en 1974, tant il paraissait aux participants de l’époque qu’il ne pouvait que rester ouvert au sein d’une société qui ne savait pas trouver les bonnes réponses aux questions qui lui étaient posées. Tout a été dit à ce sujet. Reste, à l’écoute des interventions, un malaise.
Un débat que ne referma pourtant pas la Loi votée en 1974, tant il paraissait aux participants de l’époque qu’il ne pouvait que rester ouvert au sein d’une société qui ne savait pas trouver les bonnes réponses aux questions qui lui étaient posées. Tout a été dit à ce sujet. Reste, à l’écoute des interventions, un malaise. Le petit anthropos est comme ça : il danse, bouge. Il remue et place toute son attention dans le montage de ce qu’il met en scène : des gesticulations d’abord imprécises, inadéquates, et puis des gestes qui finissent par dessiner un mouvement.
Le petit anthropos est comme ça : il danse, bouge. Il remue et place toute son attention dans le montage de ce qu’il met en scène : des gesticulations d’abord imprécises, inadéquates, et puis des gestes qui finissent par dessiner un mouvement.