
KAMEL LAGHOUAT,
LA GLANEUSE
(Ils veulent diminuer le nombre des morts pour faire grimper celui des vivants…)
"Encombrée de ballots elle avançait vêtue de noir les étoiles du matin annihilées.
Elle avançait sur la place du marché, un lourd sac au bout de chaque bras rempli de sa récolte, des choux, des pommes, les légumes que les marchands jetaient à terre.
La foule des pauvres, peuple en souffrance, fugitif,
Nos voix pour le soutenir, béquille tandis que des ombres agonisent contre les murs des parkings.
Elle avançait les épaules fléchies le soleil de juin nu comme un tombeau.
Cris rauques, huées, on déblayait la place, déjà les machines poussaient les fruits que les pauvres disputaient aux chiens.
Elle veillait à son bien, quatre gros sacs.
Je la voyais, un sac l’autre, les éléments épars d’une violente cruauté,
A côté d’elle nos ruines, la misère, quelle affaire.
Elle s’est couchée plus loin, lasse.
Nous avons dû mourir ensemble déjà.
Nos corps doivent êtres là-bas.
Son voile couvre la colline
Son voile couvre le pays.
Je vous écris depuis sa mort bordée d’épaves,
naufragée vacante où la question sociale est devenue celle de l’utopie ou de la mort, les uns se couchent les autres sont morts déjà,
baiser aux fronts des mères calleuses."
A la fin, la démocratie était seulement le moyen pour les politiques de laisser crever les gens sans faire de vagues. La convention UMP vient de valider les aménagements au dispositif imaginé par l'ancien Haut Commissaire aux solidarités actives, Martin Hirsch -qui n’a pas osé s’y opposer au delà de quelques propos reflétant son amertume. Faisant fi de l’engagement du Président de la République, décidément devenu plus que jamais celui des riches, l’UMP projette de contraindre les bénéficiaires du RSA aux travaux forcés, 5 heures hebdomadaires –sur les marchés, sans rire, commentait l’un d’entre eux- en échange de leur maintien en survie… Le poème de Kamel Laghouat, 19 ans, évoque au fond mieux qu’aucun commentaire la situation dont on parle. --jJ--
Image : Denis Bourges, qui présenta pour les 20 ans de Tendance Floue une série intitulée "Border life", dont les images résument son regard sur le cloisonnement et la frontière. Ici, une glaneuse au marché Aligre, à Paris, en 2010.




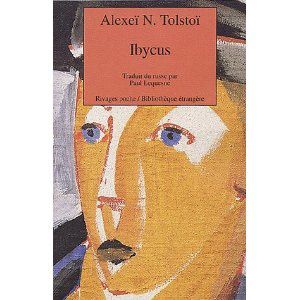 Nevzorov vit dans un quartier de Pétersbourg qui empeste le pâté bon marché. Seule lecture : les potins consacrés aux aristocrates. Au détour d’une ruelle, une diseuse lui prédit l’avenir. Un destin ! Il sera riche et célèbre. De fait, voici que le hasard lui tombe dessus sous la forme d’un gros meuble écrasant un ami, antiquaire… Des bandits viennent de dévaliser sa boutique. L’antiquaire agonise sous son meuble. Par chance, Nevzorov sait où est caché le magot, que les bandits n’ont su trouver. Il s’en empare, jette sur le mourant un regard indifférent et s’enfuit. Le voilà riche ! Il se fait aristocrate, mais tombe aussitôt sur une vraie grue qui le plume, tandis que la révolution gronde dans les rues. Il ne cessera dès lors de fuir, de monter des plans plus foireux les uns que les autres et d’être le jouet d’aventures qu’il n’a pas voulues. Le voici comptable d’une bande de brigands. En 1919, il atteint Odessa, fait par hasard main basse sur leur trésor, fuit de nouveau. Rêveur impulsif, il ne cesse de marcher "la tête en l’air à la rencontre du danger", imprimant au roman sa structure picaresque emboîtant les aventures, structure appliquée à un personnage qui, au fond, ne rêve que de mettre fin au récit de ses aventures. Le type même de la personnalité contemporaine des gens de pouvoir, riche, jamais mieux engagée qu’auprès d’elle seule malgré les détours démagogiques, se prétendant libérale quand elle n’est qu’ordurièrement lige du bon vouloir des nantis, ou socialiste quand elle n’est occupée qu’à créditer leur encours, sans morale, sans autre ambition que la sienne ni meilleure espérance, centrée sur un moi minuscule et veule. A croire qu’Ibycus ne vaut rien, même comme héros de roman, ainsi que l’affirme son auteur. Il finira tout de même riche, bookmaker de courses de cafards dressés. Ecrit en 1924, ce roman picaresque féroce, dessinant sans complexe les traits de la personnalité moderne de l’homme occidental de pouvoir, passerait aujourd’hui pour une gentille fable, tant ces gens là ont su parachever le destin d’Ybicus et nous faire prendre leurs trahisons pour des lampions de fêtes. --
Nevzorov vit dans un quartier de Pétersbourg qui empeste le pâté bon marché. Seule lecture : les potins consacrés aux aristocrates. Au détour d’une ruelle, une diseuse lui prédit l’avenir. Un destin ! Il sera riche et célèbre. De fait, voici que le hasard lui tombe dessus sous la forme d’un gros meuble écrasant un ami, antiquaire… Des bandits viennent de dévaliser sa boutique. L’antiquaire agonise sous son meuble. Par chance, Nevzorov sait où est caché le magot, que les bandits n’ont su trouver. Il s’en empare, jette sur le mourant un regard indifférent et s’enfuit. Le voilà riche ! Il se fait aristocrate, mais tombe aussitôt sur une vraie grue qui le plume, tandis que la révolution gronde dans les rues. Il ne cessera dès lors de fuir, de monter des plans plus foireux les uns que les autres et d’être le jouet d’aventures qu’il n’a pas voulues. Le voici comptable d’une bande de brigands. En 1919, il atteint Odessa, fait par hasard main basse sur leur trésor, fuit de nouveau. Rêveur impulsif, il ne cesse de marcher "la tête en l’air à la rencontre du danger", imprimant au roman sa structure picaresque emboîtant les aventures, structure appliquée à un personnage qui, au fond, ne rêve que de mettre fin au récit de ses aventures. Le type même de la personnalité contemporaine des gens de pouvoir, riche, jamais mieux engagée qu’auprès d’elle seule malgré les détours démagogiques, se prétendant libérale quand elle n’est qu’ordurièrement lige du bon vouloir des nantis, ou socialiste quand elle n’est occupée qu’à créditer leur encours, sans morale, sans autre ambition que la sienne ni meilleure espérance, centrée sur un moi minuscule et veule. A croire qu’Ibycus ne vaut rien, même comme héros de roman, ainsi que l’affirme son auteur. Il finira tout de même riche, bookmaker de courses de cafards dressés. Ecrit en 1924, ce roman picaresque féroce, dessinant sans complexe les traits de la personnalité moderne de l’homme occidental de pouvoir, passerait aujourd’hui pour une gentille fable, tant ces gens là ont su parachever le destin d’Ybicus et nous faire prendre leurs trahisons pour des lampions de fêtes. --
 Il est invraisemblable que le mot puisse atteindre quoi que ce soit de vrai. L’ironie de Flaubert tient précisément à ce que, l’ayant compris, il ne cesse d’en mimer l’illusion : déroulant l’inventaire des signes à travers lesquels le monde nous est offert, le texte qu’il écrit n’atteint que lui-même. Mais sans doute n’était-il destiné qu’à cela : non l’amertume mallarméenne d’Igitur mais le désir du texte. Ironie de la réalité défunte aussi bien, où le verbe s’épuise dans l’inventaire roboratif du mot juste, le mot contre le souffle au fond, celui du comédien, à bien des égards.
Il est invraisemblable que le mot puisse atteindre quoi que ce soit de vrai. L’ironie de Flaubert tient précisément à ce que, l’ayant compris, il ne cesse d’en mimer l’illusion : déroulant l’inventaire des signes à travers lesquels le monde nous est offert, le texte qu’il écrit n’atteint que lui-même. Mais sans doute n’était-il destiné qu’à cela : non l’amertume mallarméenne d’Igitur mais le désir du texte. Ironie de la réalité défunte aussi bien, où le verbe s’épuise dans l’inventaire roboratif du mot juste, le mot contre le souffle au fond, celui du comédien, à bien des égards. Voyager à pied. Un genre au Japon. Un genre philosophique même. A l’époque d’Edo s’entend. Par millions, jetés sur les routes, les japonais voyageaient. Un genre littéraire aussi bien, celui du récit de voyage, sur la route d’Ise en particulier, celle du fameux monastère. Des routes noires de monde, femmes, enfants, vieillards, gens d’armes, de maison, journaliers. En 1793, Jippennsha décide de descendre à Edo. Le long de la côte pacifique, il clopine sur le Tôkaido. Trois serviettes, un grand foulard sur la tête, un éventail pliant, quelques pinceaux, de l’encre, du papier de soie, Jipennsha part à l’assaut des cinquante trois relais de la route. Ecrit en forme de guide touristique à l’adresse des amateurs de spécialités régionales, il moque en fait ce Japon traditionnel que tous portent aux nues, transformant l’épopée en cavale littéraire, égrenant les bourdes, les calembredaines, les quatre cent coups en somme, accompagné d’un ami plus fantasque encore, dans l’absolu non-sens de leur virée. Très vite, le voici qui rompt de fait avec la philosophie du voyage, qui se fait égrillarde sous sa plume. Rétif au labeur littéraire, bâclé pour couvrir ses dépenses, il s’adonne plus volontiers au pétrissage frénétique de la pâte à nouilles pour mettre un peu de beurre dans ses épinards, laissant la phrase s’étirer à l’envi, diverger et nous égarer. Fuyant cocher de porche en porche, une voile plantée au milieu des fesses pour courir plus vite, il sème partout sa joyeuse pagaille et vide les fonds de ses poches sur des comptoirs de fortune, impécunieux, toujours, cultivant même cette impécuniosité constitutive de la liberté qu’il s’offre de pouvoir toujours se tenir dans le dire le plus loufoque qui soit et de n’être jamais que là, dans la désinvolture d’une langue à tout jamais déliée, inventant au passage mille expressions picaresques toutes plus hilarantes les unes que les autres, des expressions qui durent imposer à ses traducteurs le plus réjouissant labeur qui se puisse imaginer ! --
Voyager à pied. Un genre au Japon. Un genre philosophique même. A l’époque d’Edo s’entend. Par millions, jetés sur les routes, les japonais voyageaient. Un genre littéraire aussi bien, celui du récit de voyage, sur la route d’Ise en particulier, celle du fameux monastère. Des routes noires de monde, femmes, enfants, vieillards, gens d’armes, de maison, journaliers. En 1793, Jippennsha décide de descendre à Edo. Le long de la côte pacifique, il clopine sur le Tôkaido. Trois serviettes, un grand foulard sur la tête, un éventail pliant, quelques pinceaux, de l’encre, du papier de soie, Jipennsha part à l’assaut des cinquante trois relais de la route. Ecrit en forme de guide touristique à l’adresse des amateurs de spécialités régionales, il moque en fait ce Japon traditionnel que tous portent aux nues, transformant l’épopée en cavale littéraire, égrenant les bourdes, les calembredaines, les quatre cent coups en somme, accompagné d’un ami plus fantasque encore, dans l’absolu non-sens de leur virée. Très vite, le voici qui rompt de fait avec la philosophie du voyage, qui se fait égrillarde sous sa plume. Rétif au labeur littéraire, bâclé pour couvrir ses dépenses, il s’adonne plus volontiers au pétrissage frénétique de la pâte à nouilles pour mettre un peu de beurre dans ses épinards, laissant la phrase s’étirer à l’envi, diverger et nous égarer. Fuyant cocher de porche en porche, une voile plantée au milieu des fesses pour courir plus vite, il sème partout sa joyeuse pagaille et vide les fonds de ses poches sur des comptoirs de fortune, impécunieux, toujours, cultivant même cette impécuniosité constitutive de la liberté qu’il s’offre de pouvoir toujours se tenir dans le dire le plus loufoque qui soit et de n’être jamais que là, dans la désinvolture d’une langue à tout jamais déliée, inventant au passage mille expressions picaresques toutes plus hilarantes les unes que les autres, des expressions qui durent imposer à ses traducteurs le plus réjouissant labeur qui se puisse imaginer ! -- Le barbelé est destiné aux êtres vivants. Pas la palissade par exemple, qui ferme les enclos. Ni la clôture, destinée aux animaux. Le barbelé, lui, est même spécifiquement destiné aux êtres humains. Il ne sépare pas : il veut les atteindre. Dans leur chair. Leur donner une leçon. Les atteindre dans leur sensibilité. Pour produire de l’animalité, qui justifiera bientôt les moyens barbares employés pour la réduire. Déchirer, littéralement, tel est son sens. Porter un coup décisif à la capacité de souffrir de ce qui fut un être humain. Que son corps devienne celui d’une bête sauvage. Le barbelé est fait pour animaliser l’humain, prélude à l’exercice d’une violence sans frein.
Le barbelé est destiné aux êtres vivants. Pas la palissade par exemple, qui ferme les enclos. Ni la clôture, destinée aux animaux. Le barbelé, lui, est même spécifiquement destiné aux êtres humains. Il ne sépare pas : il veut les atteindre. Dans leur chair. Leur donner une leçon. Les atteindre dans leur sensibilité. Pour produire de l’animalité, qui justifiera bientôt les moyens barbares employés pour la réduire. Déchirer, littéralement, tel est son sens. Porter un coup décisif à la capacité de souffrir de ce qui fut un être humain. Que son corps devienne celui d’une bête sauvage. Le barbelé est fait pour animaliser l’humain, prélude à l’exercice d’une violence sans frein. C’est pourquoi il fonctionne comme un opérateur visuel superposant l’image de l’animal à celle de l’homme. Moins une prévention qu’une menace. Hic sunt leones. Il ébranle le statut de celui qui s’y aventure. Et s’il se dresse aux frontières de certaines unités étatiques, c’est pour produire une distinction entre ceux qui restent des hommes et ceux qui n’en sont plus, s’affirmant l’instrument d’une gestion barbare de l’espace politique. Car la clôture qu’il désigne est définitive qui, produisant une différence dans l’espace, exclue celui qui se trouve de l’autre côté de toute condition civique et politique, voire de toute condition métaphysique : il n’est plus rien. Une bête vouée à mourir. Le barbelé, qui refoule l’extérieur, s’affirme comme un opérateur de sélection, de ségrégation entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir, où l’étranger passe de la figure classique de la simple altérité à la figure du monstre, ou de l’ennemi absolu, fut-il désarmé, fut-il un civil en quête d’une vieille revendication légitime. Et pour l’y préparer, entre deux champs de frises de fil de fer barbelé, le no man’s land, qui est ce lieu du passage des hommes qui deviennent des morts en sursis quand ils s’y aventurent. L’invention d’un lieu de non-droit, international d’abord, national ensuite, où l’homme n’est plus qu’une matière survivante déshumanisée.
C’est pourquoi il fonctionne comme un opérateur visuel superposant l’image de l’animal à celle de l’homme. Moins une prévention qu’une menace. Hic sunt leones. Il ébranle le statut de celui qui s’y aventure. Et s’il se dresse aux frontières de certaines unités étatiques, c’est pour produire une distinction entre ceux qui restent des hommes et ceux qui n’en sont plus, s’affirmant l’instrument d’une gestion barbare de l’espace politique. Car la clôture qu’il désigne est définitive qui, produisant une différence dans l’espace, exclue celui qui se trouve de l’autre côté de toute condition civique et politique, voire de toute condition métaphysique : il n’est plus rien. Une bête vouée à mourir. Le barbelé, qui refoule l’extérieur, s’affirme comme un opérateur de sélection, de ségrégation entre ce qui doit vivre et ce qui doit mourir, où l’étranger passe de la figure classique de la simple altérité à la figure du monstre, ou de l’ennemi absolu, fut-il désarmé, fut-il un civil en quête d’une vieille revendication légitime. Et pour l’y préparer, entre deux champs de frises de fil de fer barbelé, le no man’s land, qui est ce lieu du passage des hommes qui deviennent des morts en sursis quand ils s’y aventurent. L’invention d’un lieu de non-droit, international d’abord, national ensuite, où l’homme n’est plus qu’une matière survivante déshumanisée. “Take a page of text and trace a medial line vertically and horizontally.
“Take a page of text and trace a medial line vertically and horizontally.
 Main basse sur tous les secteurs de l’activité économique et sociale, de l’Education à la Défense, en passant par l’industrie et l’immobilier, comme de juste. Ben Ali ne faisait pas dans la dentelle, on le sait, et sa dictature camouflée en modèle de (presque) démocratie ne gênait en rien les autorités françaises, mieux : nos élites, patrons de presse, industriels et politiques tout disposés à lui prêter main forte aux pires heures de péripéties peu glorieuses pour la diplomatie française.
Main basse sur tous les secteurs de l’activité économique et sociale, de l’Education à la Défense, en passant par l’industrie et l’immobilier, comme de juste. Ben Ali ne faisait pas dans la dentelle, on le sait, et sa dictature camouflée en modèle de (presque) démocratie ne gênait en rien les autorités françaises, mieux : nos élites, patrons de presse, industriels et politiques tout disposés à lui prêter main forte aux pires heures de péripéties peu glorieuses pour la diplomatie française. Que reste-t-il d’une présidence ? Des Lois, des monuments, des discours. Ramassés dans le temps, ces discours offrent la vision d’un état d’esprit, sinon d’un mandat, et mieux encore, dans le cas de ceux de Jacques Chirac, nous offrent en filigrane l’écho d’une inquiétude qui traversait souterrainement le pays –j’y reviendrai.
Que reste-t-il d’une présidence ? Des Lois, des monuments, des discours. Ramassés dans le temps, ces discours offrent la vision d’un état d’esprit, sinon d’un mandat, et mieux encore, dans le cas de ceux de Jacques Chirac, nous offrent en filigrane l’écho d’une inquiétude qui traversait souterrainement le pays –j’y reviendrai.