 On se rappelle les propos de Hannah Arendt sur la banalité du Mal. Mais déjà moins la Palme d'or de 2009, attribuée à l'Autrichien Michael Haneke pour Le Ruban blanc.
On se rappelle les propos de Hannah Arendt sur la banalité du Mal. Mais déjà moins la Palme d'or de 2009, attribuée à l'Autrichien Michael Haneke pour Le Ruban blanc.
Un film dont tout le monde s’accordait à vanter la photographie somptueuse - en noir et blanc-, et la gravité du sujet : les dégâts de l’éducation autoritaire qui avait la faveur de la vieille Europe Réformée du début du XXe siècle. Education rigoriste, conforme à l’idéal culturel des pays protestants, si méfiants à l’égard de l’individu, voire à l’égard de la nature humaine tout court.
Rappelez-vous : il s’agissait d’un film sur la naissance de la terreur civique. Le film de Haneke, nous assurait Toubiana, le grand essayiste contemporain du cinéma, "(était) splendide, profond, filmé à la bonne distance". Mais à quoi tenait sa force ? A ce qu’il portait un regard implacable sur une conception de l’éducation qui n’était plus la nôtre ? Non, à l’universalité du sujet abordé, répondait Toubiana, à savoir : la question du Mal, "et comment il s’installe et se distille à travers les mailles les plus infimes d’une communauté villageoise allemande, à l’aube de la Première Guerre mondiale ".
Tous les poncifs resurgirent du coup, dès lors que l’on songeait au Mal sans en expliciter l’infortune : qu’il ne parvienne pas à s’élever au rang de substance et qu’il ne soit au fond justiciable que des seules catégories du Bien. Bien commode alors d’en supposer nos âmes pleines, indéfectiblement, pour éviter d’avoir à le dénoncer. Bien commode, parce que cela permettait l’amalgame : le mal était en nous, indubitablement, assurément partagé, peut-être le sentiment le mieux partagé au monde.
Rien n’a fondamentalement changé aujourd’hui, nous continuons de penser que le mal tient pleinement dans son évidence, alors qu’il est possible de le nommer, de le dénoncer plutôt que de le chérir vriller au fond des âmes, tapi dans quelque repli obscur d’une peur qui a, en réalité, beaucoup d’autres noms que celui du Mal.
Voilà qui n’est pas sans rappeler d’autres succès de l’époque, la nôtre, comme celui des Bienveillantes, explorant cette même prétendue banalité du Mal et autorisant tous les amalgames, puisque, au fond, le Mal est partout. Que cache donc cet expression de banalité du Mal, abusivement confisquée à Hanna Arendt ? De quoi nous parle-t-on quand on l’évoque ?
 Dans le film de Haneke, on ne voyait que cette "grande beauté plastique, (en) noir et blanc (déployant) toutes ses nuances et (faisant) de chaque image une gravure", comme l’écrivait Toubiana.
Dans le film de Haneke, on ne voyait que cette "grande beauté plastique, (en) noir et blanc (déployant) toutes ses nuances et (faisant) de chaque image une gravure", comme l’écrivait Toubiana.
Qu’est-ce qu’un beau film ?…
Peut-être ce que Mallarmé affirmait, désappointé : un pur jeu formel…
Dans le même festival on projetait Inglourious basterds, de Tarantino. L’Autrichien Christoph Waltz recevait le Prix d'interprétation masculine pour son rôle d’officier SS, dans un film dont on ne cessait de saluer la beauté. Mais là encore, de quoi parlait ce film, sinon de la virtuosité de son metteur en scène ?
Loin des rumeurs de Cannes et dans un autre registre, un livre m'est revenu en mémoire : La Peau du Loup, de Hans Lebert. J’ai gardé le souvenir de sa beauté formelle bien sûr, de l’intelligence de sa construction et de l’énigme à laquelle il ouvre, qui vous saisit et vous jette, lecteur, dans les affres d’un questionnement inévitablement personnel, vous engageant singulièrement dans votre lecture, ce pour quoi le verbe est fait.
Il s’agit toujours de l’Autriche, de l’héritage nazi, de la mémoire de ces événements que l’on veut reconstruire à l’usage des temps présents et des raisons qui nous y poussent. Car : que faisons-nous de ces beaux films, tout comme de ces romans si forts, si convaincants ?
 Didier Eribon, dans son dernier essai, évoque cet horizon que je pointe et qui se fait jour face à l'orientation que prend le mot de Culture dans nos sociétés néo-libérales. Il parle de la Culture comme d'une ruse suprême de la Domination. Une ruse qui impose sa faconde et son style. Le bon goût... Condition même de la culture, cette arme qui ne se définitit que dans le périmètre étroit édicté par la classe dominante. Il en parle comme d'une ruse imparable qui opère avec la complicité de ses cooptés, rejetant tout ce qui pourrait troubler son ordre esthétique, sélectionnant les oeuvres qu'il convient d'admirer dans les termes qui définissent son convenable en demeurant à tout jamais étrangers à toute vraie contestation artisitique. Didier Eribon rappelle Nizan, cette voix forte, réellement forte quand nombre d'artistes d'aujourd'hui ne font qu'y prétendent. La Bourgeoisie, affirmait Nizan, ne coïncide pas avec l'humain. Il nous faut, contre elle, inventer une autre manière d'être humain, une autre culture donc, construire des "temporalités inattendues". Et puisque nous écrivons encore dans la langue de l'ennemi, nous poser la question de savoir ce que cela change d'écrire dans sa langue notre radicale opposition à ce qui la fonde.
Didier Eribon, dans son dernier essai, évoque cet horizon que je pointe et qui se fait jour face à l'orientation que prend le mot de Culture dans nos sociétés néo-libérales. Il parle de la Culture comme d'une ruse suprême de la Domination. Une ruse qui impose sa faconde et son style. Le bon goût... Condition même de la culture, cette arme qui ne se définitit que dans le périmètre étroit édicté par la classe dominante. Il en parle comme d'une ruse imparable qui opère avec la complicité de ses cooptés, rejetant tout ce qui pourrait troubler son ordre esthétique, sélectionnant les oeuvres qu'il convient d'admirer dans les termes qui définissent son convenable en demeurant à tout jamais étrangers à toute vraie contestation artisitique. Didier Eribon rappelle Nizan, cette voix forte, réellement forte quand nombre d'artistes d'aujourd'hui ne font qu'y prétendent. La Bourgeoisie, affirmait Nizan, ne coïncide pas avec l'humain. Il nous faut, contre elle, inventer une autre manière d'être humain, une autre culture donc, construire des "temporalités inattendues". Et puisque nous écrivons encore dans la langue de l'ennemi, nous poser la question de savoir ce que cela change d'écrire dans sa langue notre radicale opposition à ce qui la fonde.
 Il y a donc un "travail de la culture" à faire face à cette survivance inavouée du nazisme, qui pointe déjà la faillitte d'une nation, la nôtre. Les meurtriers politiques ne tombent pas du ciel.
Il y a donc un "travail de la culture" à faire face à cette survivance inavouée du nazisme, qui pointe déjà la faillitte d'une nation, la nôtre. Les meurtriers politiques ne tombent pas du ciel.
Dans les propos officiels que l'on a entendu ici et là autour de la mort du jeune Clément, il y avait comme un refus d'affronter ce moment de transformation que cette mort pointe. A défaut d'en faire une crise, on a vu des politiques tenter d'en faire un spectacle (de rue, à Paris, pour ne désigner personne). Solennel. En bleu et blanc. Et rose. Mais ni les uns ni les autres n'ont cherché à scruter ce qui, dans leur propre camp, avait contribué à libérer ce Mal. Ce n'est pourtant qu'à cette condition qu'il sera possible d'éclairer le rapport au crime politique que la société française vient de prendre.
On aura vu ainsi les Médias inquiéter la victime, et la Droite s'enfermer dans le paradoxe philosophique de l'inhumaine humanité, excluant l'idée d'une quelconque responsabilité dans le Mal accompli.
On aura entendu encore répéter l'excuse du café du commerce : l'homme est un loup pour lui-même (Hobbes), et nos élites oublier la réponse de Spinoza à Hobbes : "Il n’y a rien de plus utile à l’homme que l’homme".
 On aura vu la Gauche se payer cette fois encore de vains mots dans l'oubli du sens profond de cette phrase : le défaut de secours que l'on voit se faire jour en France à l'égard des plus démunis, à l'égard des classes populaires, à l'égard des petits-enfants d'immigrés, à l'égard des précaires, à l'égard des salariés pauvres, à l'égard des retraités pauvres, à l'égard des enseignants démonétisés, des enseignés méprisés, etc., l'on pourrait démultiplier à l'infini, est la cause de ce Mal qui finira bientôt par révéler son nom sinistre.
On aura vu la Gauche se payer cette fois encore de vains mots dans l'oubli du sens profond de cette phrase : le défaut de secours que l'on voit se faire jour en France à l'égard des plus démunis, à l'égard des classes populaires, à l'égard des petits-enfants d'immigrés, à l'égard des précaires, à l'égard des salariés pauvres, à l'égard des retraités pauvres, à l'égard des enseignants démonétisés, des enseignés méprisés, etc., l'on pourrait démultiplier à l'infini, est la cause de ce Mal qui finira bientôt par révéler son nom sinistre.
La privation des besoins économiques élémentaires relève pourtant d'une décision politique qu'il n'est pas si difficile de prendre, alors qu'en refusant ce genre d'ambition, on crée les conditions d'une dévastation sauvage des sociétés humaines.
"Il n’y a rien de plus utile à l’homme que l’homme".
Sans ce souci, sans cette socialité séminale, il ne reste en effet que la violence pour seul dénominateur commun. Celle qui humilie, celle qui méprise, celle qui sépare et finit par tuer.
«Le fascisme nous gagne sans même que nous le sachions», écrivait Haneke il me semble. Un fascisme rampant du trop plein d‘amertume et de misère, de rancœur et de rancune qui pourraient bien tout emporter sur son passage.
image Leni Riefenstahl, self-portrait...
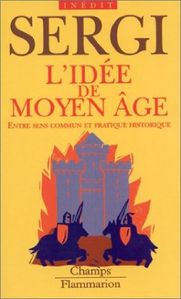 Un travail érudit mais clair sur la construction de l'idée de Moyen Age et sa fortune. Fabriquée par les humanistes des XVe et XVIe siècles comme âge intermédiaire (moyen), sa fonction aura été de constituer un ailleurs, négatif (pauvreté, famine, désordre), ou positif (les tournois, la vie de cour), et de nous fournir les prémices… de tout ce que l'on voulait bien admettre pour moderne dans nos sociétés. Une sorte d'espace idéal où situer les origines de nos traditions, aussi bien que l'éclosion des identités ethniques. Plus de dix siècles tout de même... Etudiés à travers une rationalisation fort simple : on observait un modèle assez proche dans le temps, que l'on supposait être l'aboutissement logique d'une longue période historique, et l'on projetait ensuite les résultats de cette "observation" sur tout le passé envisagé. Vasari, plus familier des arts que de la chronique historique, avait posé les règles de cette périodisation. Son triptyque : antique, médiéval et moderne, a connu le succès que l'on sait, jusqu'à ce que les historiens professionnels s'inquiètent de sa validité. Mais en fait il s'agissait avant tout pour Vasari de constituer cet âge en âge de transition entre deux périodes immenses de l'humanité : celle de l'Antiquité, et celle qu'il construisait avec d'autres, "Moderne" et dont la grandeur revêtait celle de toute l'Histoire de l'humanité à ses yeux.
Un travail érudit mais clair sur la construction de l'idée de Moyen Age et sa fortune. Fabriquée par les humanistes des XVe et XVIe siècles comme âge intermédiaire (moyen), sa fonction aura été de constituer un ailleurs, négatif (pauvreté, famine, désordre), ou positif (les tournois, la vie de cour), et de nous fournir les prémices… de tout ce que l'on voulait bien admettre pour moderne dans nos sociétés. Une sorte d'espace idéal où situer les origines de nos traditions, aussi bien que l'éclosion des identités ethniques. Plus de dix siècles tout de même... Etudiés à travers une rationalisation fort simple : on observait un modèle assez proche dans le temps, que l'on supposait être l'aboutissement logique d'une longue période historique, et l'on projetait ensuite les résultats de cette "observation" sur tout le passé envisagé. Vasari, plus familier des arts que de la chronique historique, avait posé les règles de cette périodisation. Son triptyque : antique, médiéval et moderne, a connu le succès que l'on sait, jusqu'à ce que les historiens professionnels s'inquiètent de sa validité. Mais en fait il s'agissait avant tout pour Vasari de constituer cet âge en âge de transition entre deux périodes immenses de l'humanité : celle de l'Antiquité, et celle qu'il construisait avec d'autres, "Moderne" et dont la grandeur revêtait celle de toute l'Histoire de l'humanité à ses yeux. 


 La Guerre avons. Le frais, le froid, le chaud nous minent… La faim aussi, la Peste enfin… Un temps de rose et de sang s’épanouit.
La Guerre avons. Le frais, le froid, le chaud nous minent… La faim aussi, la Peste enfin… Un temps de rose et de sang s’épanouit. Le peuple émigre massivement vers les villes, croyant pouvoir y survivre –mais ce sera pour y mourir. Les premières grandes émeutes de la faim éclatent partout dans les villes européennes.
Le peuple émigre massivement vers les villes, croyant pouvoir y survivre –mais ce sera pour y mourir. Les premières grandes émeutes de la faim éclatent partout dans les villes européennes. Partout les villes se révoltent. Les revendications sont claires : partout on diffuse des textes aux idées égalitaires. Partout on prend la parole pour redéfinir le Bien Commun, et le défendre. Et face à cette situation de jacquerie et de soulèvements urbains, la répression sera sanglante, féroce, meurtrière. Que minimise l’auteure. On envoie la chevalerie en armes contre un peuple armé de bâtons. Partout on assiste à de vrais massacres de populations. A Paris, en 1148, 2000 contestataires sont exterminés – le massacre des Armagnacs. Si bien que toutes les révoltes échoueront. Et non parce que les émeutiers étaient ivres de bière et de vin et auraient fini par préférer leurs agapes à leurs revendications. Ce topos mainte fois mis en avant par les historiens, cette anthropologie carnavalesque bien commode demeure des plus suspectes, sinon intolérable pour ce qu’elle énonce du sentiment populaire de justice. Organisés, il manquait aux émeutiers une structure de combat capable de défaire la chevalerie en arme ainsi que toutes les officines déployées sur le territoire pour assassiner l’opposition politique.
Partout les villes se révoltent. Les revendications sont claires : partout on diffuse des textes aux idées égalitaires. Partout on prend la parole pour redéfinir le Bien Commun, et le défendre. Et face à cette situation de jacquerie et de soulèvements urbains, la répression sera sanglante, féroce, meurtrière. Que minimise l’auteure. On envoie la chevalerie en armes contre un peuple armé de bâtons. Partout on assiste à de vrais massacres de populations. A Paris, en 1148, 2000 contestataires sont exterminés – le massacre des Armagnacs. Si bien que toutes les révoltes échoueront. Et non parce que les émeutiers étaient ivres de bière et de vin et auraient fini par préférer leurs agapes à leurs revendications. Ce topos mainte fois mis en avant par les historiens, cette anthropologie carnavalesque bien commode demeure des plus suspectes, sinon intolérable pour ce qu’elle énonce du sentiment populaire de justice. Organisés, il manquait aux émeutiers une structure de combat capable de défaire la chevalerie en arme ainsi que toutes les officines déployées sur le territoire pour assassiner l’opposition politique. On se rappelle les propos de Hannah Arendt sur la banalité du Mal. Mais déjà moins la Palme d'or de 2009, attribuée à l'Autrichien Michael Haneke pour Le Ruban blanc.
On se rappelle les propos de Hannah Arendt sur la banalité du Mal. Mais déjà moins la Palme d'or de 2009, attribuée à l'Autrichien Michael Haneke pour Le Ruban blanc. Dans le film de Haneke, on ne voyait que cette "grande beauté plastique, (en) noir et blanc (déployant) toutes ses nuances et (faisant) de chaque image une gravure", comme l’écrivait Toubiana.
Dans le film de Haneke, on ne voyait que cette "grande beauté plastique, (en) noir et blanc (déployant) toutes ses nuances et (faisant) de chaque image une gravure", comme l’écrivait Toubiana. Didier Eribon, dans son dernier essai, évoque cet horizon que je pointe et qui se fait jour face à l'orientation que prend le mot de Culture dans nos sociétés néo-libérales. Il parle de la Culture comme d'une ruse suprême de la Domination. Une ruse qui impose sa faconde et son style. Le bon goût... Condition même de la culture, cette arme qui ne se définitit que dans le périmètre étroit édicté par la classe dominante. Il en parle comme d'une ruse imparable qui opère avec la complicité de ses cooptés, rejetant tout ce qui pourrait troubler son ordre esthétique, sélectionnant les oeuvres qu'il convient d'admirer dans les termes qui définissent son convenable en demeurant à tout jamais étrangers à toute vraie contestation artisitique. Didier Eribon rappelle Nizan, cette voix forte, réellement forte quand nombre d'artistes d'aujourd'hui ne font qu'y prétendent. La Bourgeoisie, affirmait Nizan, ne coïncide pas avec l'humain. Il nous faut, contre elle, inventer une autre manière d'être humain, une autre culture donc, construire des "temporalités inattendues". Et puisque nous écrivons encore dans la langue de l'ennemi, nous poser la question de savoir ce que cela change d'écrire dans sa langue notre radicale opposition à ce qui la fonde.
Didier Eribon, dans son dernier essai, évoque cet horizon que je pointe et qui se fait jour face à l'orientation que prend le mot de Culture dans nos sociétés néo-libérales. Il parle de la Culture comme d'une ruse suprême de la Domination. Une ruse qui impose sa faconde et son style. Le bon goût... Condition même de la culture, cette arme qui ne se définitit que dans le périmètre étroit édicté par la classe dominante. Il en parle comme d'une ruse imparable qui opère avec la complicité de ses cooptés, rejetant tout ce qui pourrait troubler son ordre esthétique, sélectionnant les oeuvres qu'il convient d'admirer dans les termes qui définissent son convenable en demeurant à tout jamais étrangers à toute vraie contestation artisitique. Didier Eribon rappelle Nizan, cette voix forte, réellement forte quand nombre d'artistes d'aujourd'hui ne font qu'y prétendent. La Bourgeoisie, affirmait Nizan, ne coïncide pas avec l'humain. Il nous faut, contre elle, inventer une autre manière d'être humain, une autre culture donc, construire des "temporalités inattendues". Et puisque nous écrivons encore dans la langue de l'ennemi, nous poser la question de savoir ce que cela change d'écrire dans sa langue notre radicale opposition à ce qui la fonde. Il y a donc un "travail de la culture" à faire face à cette survivance inavouée du nazisme, qui pointe déjà la faillitte d'une nation, la nôtre. L
Il y a donc un "travail de la culture" à faire face à cette survivance inavouée du nazisme, qui pointe déjà la faillitte d'une nation, la nôtre. L On aura vu la Gauche se payer cette fois encore de vains mots dans l'oubli du sens profond de cette phrase : le défaut de secours que l'on voit se faire jour en France à l'égard des plus démunis, à l'égard des classes populaires, à l'égard des petits-enfants d'immigrés, à l'égard des précaires, à l'égard des salariés pauvres, à l'égard des retraités pauvres, à l'égard des enseignants démonétisés, des enseignés méprisés, etc., l'on pourrait démultiplier à l'infini, est la cause de ce Mal qui finira bientôt par révéler son nom sinistre.
On aura vu la Gauche se payer cette fois encore de vains mots dans l'oubli du sens profond de cette phrase : le défaut de secours que l'on voit se faire jour en France à l'égard des plus démunis, à l'égard des classes populaires, à l'égard des petits-enfants d'immigrés, à l'égard des précaires, à l'égard des salariés pauvres, à l'égard des retraités pauvres, à l'égard des enseignants démonétisés, des enseignés méprisés, etc., l'on pourrait démultiplier à l'infini, est la cause de ce Mal qui finira bientôt par révéler son nom sinistre. Serge Tisseron évoque son psychanalyste, Didier Anzieu, à qui un jour lui prit l’envie de parler en cours de séance, s’étonnant de ce qu’il lui répondit si volontiers, rompant avec la sacro-sainte loi de distance, de neutralité, pour peu à peu tisser avec son patient quelque chose comme un espace de symbolisation partagée.
Serge Tisseron évoque son psychanalyste, Didier Anzieu, à qui un jour lui prit l’envie de parler en cours de séance, s’étonnant de ce qu’il lui répondit si volontiers, rompant avec la sacro-sainte loi de distance, de neutralité, pour peu à peu tisser avec son patient quelque chose comme un espace de symbolisation partagée. A l’heure où de sinistres ligues sont lâchées dans les rues, où le retour de l’extrémisme assassin s’accomplit au grand jour, où l’ambiance délétère de la société française, pleine d’effroi pour ce Dernier Virage à Droite qui la tente tellement désormais, éclate au grand jour, il y a tout à la fois quelque chose comme une sourde angoisse qui perce de cet essai de Didier Eribon, et l’espoir, immense, que nous avons peut-être la maturité de ne pas nous laisser enfermer dans les plis nauséeux d’on ne sait quelles annales typiquement françaises.
A l’heure où de sinistres ligues sont lâchées dans les rues, où le retour de l’extrémisme assassin s’accomplit au grand jour, où l’ambiance délétère de la société française, pleine d’effroi pour ce Dernier Virage à Droite qui la tente tellement désormais, éclate au grand jour, il y a tout à la fois quelque chose comme une sourde angoisse qui perce de cet essai de Didier Eribon, et l’espoir, immense, que nous avons peut-être la maturité de ne pas nous laisser enfermer dans les plis nauséeux d’on ne sait quelles annales typiquement françaises. Les Dioscures, Castor et Pollux, mais aussi, on les oublie souvent, Hélène et Clytemnestre, plus mystérieuses encore. Les Tyndarides… Tous enfants du roi de Sparte, Tyndare, selon Homère. Porteur du nom. Les Tyndarides… Mais Pollux serait le fils de Zeus. Léda, femme de Tyndare, violentée par Zeus ayant pris l’apparence d’un cygne, aurait pondu ses œufs. Aux dires de certains, à l'origine, chaque oeuf contenait un garçon et une fille. Castor et Clytemnestre, Hélène et Pollux. Léda elle-même n’en sait trop rien, le culte des Dioscures enfuit de la mémoire hellénistique.
Les Dioscures, Castor et Pollux, mais aussi, on les oublie souvent, Hélène et Clytemnestre, plus mystérieuses encore. Les Tyndarides… Tous enfants du roi de Sparte, Tyndare, selon Homère. Porteur du nom. Les Tyndarides… Mais Pollux serait le fils de Zeus. Léda, femme de Tyndare, violentée par Zeus ayant pris l’apparence d’un cygne, aurait pondu ses œufs. Aux dires de certains, à l'origine, chaque oeuf contenait un garçon et une fille. Castor et Clytemnestre, Hélène et Pollux. Léda elle-même n’en sait trop rien, le culte des Dioscures enfuit de la mémoire hellénistique.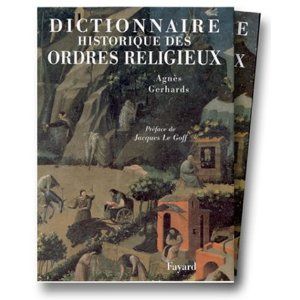 Qui saurait encore, aujourd'hui, définir avec précision ce que fut l'ascèse monastique, les enjeux théologiques mais aussi intellectuels, entre la règle de Saint Benoît et celle de Saint Augustin ? Qui saurait évaluer ce que fut la formidable aventure des Ordres Mendiants et ses conséquences sur la société médiévale ? Qui saurait expliquer comment les moines ont créé l'emploi du temps et quelles en furent les conséquences pour l'homme du monde occidental ? Le Dictionnaire d'Agnès Gerhards, déjà auteur d'un remarquable Dictionnaire de la société médiévale, situe avec précision les enjeux de connaissance qui nous permettent de mieux comprendre les fondements de notre civilisation, tout en rappelant la vocation spirituelle mais aussi la force d'entraînement de la société monachique, favorisant largement l'évolution économique de la société médiévale.
Qui saurait encore, aujourd'hui, définir avec précision ce que fut l'ascèse monastique, les enjeux théologiques mais aussi intellectuels, entre la règle de Saint Benoît et celle de Saint Augustin ? Qui saurait évaluer ce que fut la formidable aventure des Ordres Mendiants et ses conséquences sur la société médiévale ? Qui saurait expliquer comment les moines ont créé l'emploi du temps et quelles en furent les conséquences pour l'homme du monde occidental ? Le Dictionnaire d'Agnès Gerhards, déjà auteur d'un remarquable Dictionnaire de la société médiévale, situe avec précision les enjeux de connaissance qui nous permettent de mieux comprendre les fondements de notre civilisation, tout en rappelant la vocation spirituelle mais aussi la force d'entraînement de la société monachique, favorisant largement l'évolution économique de la société médiévale. Dix-sept rencontres au total, longues de plusieurs jours la plupart du temps, en présence des militaires de haut rang des deux Etats, de Ribbentrop, du comte Ciano et de l’interprète Paul Otto Schmidt : Hitler ne parlait qu’allemand (et quel allemand !), tandis que Mussolini, sans le parler couramment, parvenait à se débrouiller dans la langue de son homologue. Dix-sept rencontres qui montrent à quel point les deux hommes auront été liés, d’une amitié bien réelle, même si elle peina à démarrer.
Dix-sept rencontres au total, longues de plusieurs jours la plupart du temps, en présence des militaires de haut rang des deux Etats, de Ribbentrop, du comte Ciano et de l’interprète Paul Otto Schmidt : Hitler ne parlait qu’allemand (et quel allemand !), tandis que Mussolini, sans le parler couramment, parvenait à se débrouiller dans la langue de son homologue. Dix-sept rencontres qui montrent à quel point les deux hommes auront été liés, d’une amitié bien réelle, même si elle peina à démarrer. L’enjeu géopolitique de cette rencontre, c’est bien sûr la question de l’Autriche que Mussolini veut placer au cœur de leurs causeries. Il redoute son annexion et fait savoir sans détour qu’il n’en veut pas. Hitler rassure, ment, s’en tire par des pirouettes.
L’enjeu géopolitique de cette rencontre, c’est bien sûr la question de l’Autriche que Mussolini veut placer au cœur de leurs causeries. Il redoute son annexion et fait savoir sans détour qu’il n’en veut pas. Hitler rassure, ment, s’en tire par des pirouettes. Mussolini voudra lui rendre la pareille l’année suivante à Rome, mais il sait qu’il ne peut rivaliser avec lui. Il est inquiet, humilié, doublement parce que le protocole veut que ce soit le petit roi italien qui reçoive Hitler et non lui, et parce ce que le colonel Horsbach, maître idéologue de l’espace vital allemand, vient de poser la date de 1940 comme celle de la réalisation du rêve allemand. Mussolini sait désormais que la question autrichienne est scellée : les instruments de la politique d’agression de Hitler sont en place, au grand jour.
Mussolini voudra lui rendre la pareille l’année suivante à Rome, mais il sait qu’il ne peut rivaliser avec lui. Il est inquiet, humilié, doublement parce que le protocole veut que ce soit le petit roi italien qui reçoive Hitler et non lui, et parce ce que le colonel Horsbach, maître idéologue de l’espace vital allemand, vient de poser la date de 1940 comme celle de la réalisation du rêve allemand. Mussolini sait désormais que la question autrichienne est scellée : les instruments de la politique d’agression de Hitler sont en place, au grand jour. Munich, 1929. Edgar a cinq ans. L’oncle Lion Feuchtwanger est célèbre. Ecrivain, essayiste, il vient de faire paraître La vraie histoire du juif Süss, qui caracole en tête des ventes de librairie, à égalité avec Mein Kampf, de Hitler, un petit homme irascible qui vit dans l’immeuble juste en face de la famille d’Edgar.
Munich, 1929. Edgar a cinq ans. L’oncle Lion Feuchtwanger est célèbre. Ecrivain, essayiste, il vient de faire paraître La vraie histoire du juif Süss, qui caracole en tête des ventes de librairie, à égalité avec Mein Kampf, de Hitler, un petit homme irascible qui vit dans l’immeuble juste en face de la famille d’Edgar. A quoi pouvait bien ressembler le ciel quand il n’était pas bleu, la mer, plongée dans sa nuit de houle grise ?
A quoi pouvait bien ressembler le ciel quand il n’était pas bleu, la mer, plongée dans sa nuit de houle grise ? Le grec, tout comme l’hébreu, ne renvoyait pas à des colorations mais à des idées de richesse, de force, de prestige, de beauté, d’amour, de mort. Et dans ce vocabulaire, le bleu n’avait pas sa place. Chez Homère par exemple, seuls trois adjectifs de couleur qualifient les colorations, dont celui de glaukos, intégrant tout à la fois le vert, le bleu, le gris, le jaune, le brun, dans une même idée de pâleur. La mer homérique est glauque, tout comme le ciel…
Le grec, tout comme l’hébreu, ne renvoyait pas à des colorations mais à des idées de richesse, de force, de prestige, de beauté, d’amour, de mort. Et dans ce vocabulaire, le bleu n’avait pas sa place. Chez Homère par exemple, seuls trois adjectifs de couleur qualifient les colorations, dont celui de glaukos, intégrant tout à la fois le vert, le bleu, le gris, le jaune, le brun, dans une même idée de pâleur. La mer homérique est glauque, tout comme le ciel…