 Êtes-vous heureux ? Comment pourriez-vous ne pas l’être ?... Bien que ce ne soit pas véritablement le propos de Pascal Bruckner dans cette conférence, qui ne se soucie pas des conditions de possibilité sociales ou économiques par exemple, du bonheur, pour n’en retenir que l’injonction sociétale, formulée à son sens assez récemment comme un devoir. Assez récemment, c’est-à-dire au fond à ses yeux dans le sillage de Mai 68 et de ses revendications épicuriennes, nous faisant passer d’un monde qui interdisait la jouissance à un monde qui la rendait obligatoire.
Êtes-vous heureux ? Comment pourriez-vous ne pas l’être ?... Bien que ce ne soit pas véritablement le propos de Pascal Bruckner dans cette conférence, qui ne se soucie pas des conditions de possibilité sociales ou économiques par exemple, du bonheur, pour n’en retenir que l’injonction sociétale, formulée à son sens assez récemment comme un devoir. Assez récemment, c’est-à-dire au fond à ses yeux dans le sillage de Mai 68 et de ses revendications épicuriennes, nous faisant passer d’un monde qui interdisait la jouissance à un monde qui la rendait obligatoire.
La première partie de l’exposé est consacrée à la France de l’Ancien Régime, profondément enracinée pour lui dans l’idée d’un salut post-terrien, répudiant l’idée du bonheur et invitant au renoncement. Avec des nuances bien évidemment, introduites par le fil des améliorations des conditions matérielles de vie (justement, ce paramètre tant délaissé dans son approche par la suite), l’être souffreteux de l’Ancien Régime, au fil de ces améliorations, finissant par trouver de plus en plus de plaisir au confort qui s’offrait à lui. Curieuse histoire au demeurant que celle que Bruckner écrit là, subsumant les mentalités et les comportements sous le seul discours chrétien dont on sait qu’il dut longtemps ferrailler pour imposer ses normes à des populations plus bambocheuses qu’on a voulu les voir, et que le dolorisme chrétien n’excitait guère… Mais passons. Une sérieuse brèche aurait donc fini par emporter la planche du Salut chrétien pour laisser entrevoir aux humains une autre vocation : celle d’être heureux sur terre, sans attendre la mort après tout. Jusqu’à la vraie grande « révolution », que Bruckner situe donc dans les années 60. Cela ne surprendra pas : il y a consacré toute sa vie. En paradigme des appétits au bonheur qui se firent jour alors, la société de consommation, décryptée ici à travers sa machine économique, mise soudain au service de nos désirs les plus immédiats. Le bât blesse là encore, à trop vouloir rendre Mai 68 responsable de tous nos maux. C’est oublier que l’intimidation des désirs égotistes aura été d’abord le fait des nouvelles classes dominantes, tandis que les classes laborieuses menaient de leur côté un autre projet d’émancipation. Mais qu’importe, voyons où pourrait bien nous mener cette réflexion sur le bonheur forcené d’aujourd’hui. Il inquiète, à l’évidence. Du moins son injonction. L’anxiété s’épelle jusque dans les jeux du lit, où ce bonheur est devenu performance. Le bonheur serait ainsi devenu un souci, sinon une corvée. Aux yeux de Bruckner, la faute en est d’avoir voulu l’annexer au domaine de la volonté. Assujetti à notre bon vouloir, il a perdu tout sens et surtout, toute saveur. Bruckner invite alors à en reprendre l’énonciation. Le bonheur serait ce visiteur du soir qui débarque sur la pointe du pied pour un moment furtif, avant de filer à l’anglaise et nous laisser de nouveau disponible à son éventuel retour. Mais en prendre conscience serait se convertir en comédien de son propre bonheur. Et plutôt que d’en faire un projet, il conviendrait de n’en rien faire du tout. Lui laisser son caractère de «visitation». Le mot est fort, religieux. Nous reliant du reste à on ne sait trop quoi. Mais pour qu’il s’actualise en pure visitation, Il faudrait accepter ces moments pauvres de l’existence où nous pensons succomber à la banalité de vivre. Accueillir l’insouciance, l’innocence, l’inconscience d’être au monde. L’abandon d’accepter l’aventure d’un moment qui vous arrache tout de même à vous-même et vous sort du monde, affairé –à sa perte ?
Le devoir de bonheur, Pascal Bruckner, LES PARADOXES DE L’INJONCTION AU BONHEUR, UNE RÉFLEXION PHILOSOPHIQUE, Label : FREMEAUX & ASSOCIES, Réf. : FA5420, ÉDITION : GRASSET - PRODUCTION : CLAUDE COLOMBINI FRÉMEAUX, 2 Cd-rom, 19,99 euros.



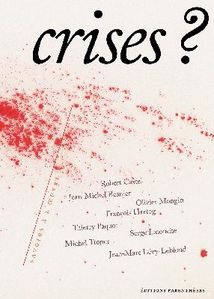 Robert Castel, Olivier Mangin et j’en passe, convoqués par une association pour disserter sur le concept de crise à l’occasion de celle que nous vivons toujours, inaugurée en 2008 par les milieux de la Finance. Approche pluridisciplinaire, beaucoup de philosophie, un peu de sociologie, l’incongruité d’un éclairage de physicien pour parler de la notion de crise là où, à tout le moins, les mathématiques appliquées à l’économie auraient été plus décapantes… Et in fine, quasiment pas d’économie (!), contrairement à ce que l’on était en droit d’attendre… Le tout pour un résultat ahurissant de mièvreries oiseuses, le livre le plus inutile qu’il m’ait été donné de lire sur pareille question depuis des lustres –ceux du tournant du siècle au demeurant, où l’on débattit beaucoup de civilisation, d’une crise du sens sur laquelle nous devions réfléchir sans trop nous focaliser sur la montée en puissance de la domination financière qui déstructurait le capitalisme contemporain… Beaucoup de métaphysique donc, et d’approche existentielle, très loin du niveau d’un René Guénon tout de même, et de son essai
Robert Castel, Olivier Mangin et j’en passe, convoqués par une association pour disserter sur le concept de crise à l’occasion de celle que nous vivons toujours, inaugurée en 2008 par les milieux de la Finance. Approche pluridisciplinaire, beaucoup de philosophie, un peu de sociologie, l’incongruité d’un éclairage de physicien pour parler de la notion de crise là où, à tout le moins, les mathématiques appliquées à l’économie auraient été plus décapantes… Et in fine, quasiment pas d’économie (!), contrairement à ce que l’on était en droit d’attendre… Le tout pour un résultat ahurissant de mièvreries oiseuses, le livre le plus inutile qu’il m’ait été donné de lire sur pareille question depuis des lustres –ceux du tournant du siècle au demeurant, où l’on débattit beaucoup de civilisation, d’une crise du sens sur laquelle nous devions réfléchir sans trop nous focaliser sur la montée en puissance de la domination financière qui déstructurait le capitalisme contemporain… Beaucoup de métaphysique donc, et d’approche existentielle, très loin du niveau d’un René Guénon tout de même, et de son essai  Une guerre de retard… L’essai est signé par un saint-cyrien bardé de diplôme, enseignant à l’Ecole de Guerre. Histoire, outils, méthodes, on pouvait s’attendre à découvrir la fine fleur de la pensée française en matière de géopolitique. Mais non, rien de tel… La partie historique est bien sûr parfaite. Braudel en médaillon, notre saint-cyrien maîtrise son sujet et donne en quelques paragraphes rondement exécutés un aperçu des plus complets sur la fondation d’un art de penser (la géopolitique n’est pas une science, elle le prouve encore dans cet essai), particulièrement subtil, qui engage des sommes de connaissances et de savoirs qu’aucun géopoliticien ne peut à lui seul posséder –d’où les erreurs à répétition qui ont jalonné le discours géopolitique. Sur les outils, l’essai est déjà plus vague. De quoi faudrait-il disposer pour poser un jugement géopolitique ? L’analyse de la géographie physique semble ici dominer la pensée de notre chef de guerre. On comprend mieux alors la référence à Braudel : l’analyse des régularités physiques relève d’un temps long qui lui était cher, qui autorise le géopoliticien à s’enfermer dans une vision paresseuse du monde, construite pour l’éternité ou peu s’en faut… L’analyse des voies fluviales, aériennes, terrestres nous ramène ainsi à la géographie de Vidal-Lablache, certes précurseur,
Une guerre de retard… L’essai est signé par un saint-cyrien bardé de diplôme, enseignant à l’Ecole de Guerre. Histoire, outils, méthodes, on pouvait s’attendre à découvrir la fine fleur de la pensée française en matière de géopolitique. Mais non, rien de tel… La partie historique est bien sûr parfaite. Braudel en médaillon, notre saint-cyrien maîtrise son sujet et donne en quelques paragraphes rondement exécutés un aperçu des plus complets sur la fondation d’un art de penser (la géopolitique n’est pas une science, elle le prouve encore dans cet essai), particulièrement subtil, qui engage des sommes de connaissances et de savoirs qu’aucun géopoliticien ne peut à lui seul posséder –d’où les erreurs à répétition qui ont jalonné le discours géopolitique. Sur les outils, l’essai est déjà plus vague. De quoi faudrait-il disposer pour poser un jugement géopolitique ? L’analyse de la géographie physique semble ici dominer la pensée de notre chef de guerre. On comprend mieux alors la référence à Braudel : l’analyse des régularités physiques relève d’un temps long qui lui était cher, qui autorise le géopoliticien à s’enfermer dans une vision paresseuse du monde, construite pour l’éternité ou peu s’en faut… L’analyse des voies fluviales, aériennes, terrestres nous ramène ainsi à la géographie de Vidal-Lablache, certes précurseur, 
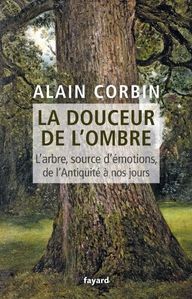 Alain Corbin a suivi à la trace (littéraire) et depuis l’Antiquité gréco-romaine, "ceux qui ont su voir l’ombre". Non le côté obscur de la vie mais cette douceur propre aux ombrages que Virgile, Horace, Ronsard ou Goethe, voire Senancour, ce grand philosophe oublié, ont choyée. Aux mots de ces écrivains, Corbin a relié les siens, les enrichissants des lettres des peintres sidérés eux aussi par cette présence de l’arbre, souverain passeur temporel.
Alain Corbin a suivi à la trace (littéraire) et depuis l’Antiquité gréco-romaine, "ceux qui ont su voir l’ombre". Non le côté obscur de la vie mais cette douceur propre aux ombrages que Virgile, Horace, Ronsard ou Goethe, voire Senancour, ce grand philosophe oublié, ont choyée. Aux mots de ces écrivains, Corbin a relié les siens, les enrichissants des lettres des peintres sidérés eux aussi par cette présence de l’arbre, souverain passeur temporel.


 Alors partout se leva face à cette violence protestante la grande violence catholique, encouragée par la monarchie. Les catholiques étaient alors traversés par l’idée de l’imminence de la fin du monde. Le combat contre les réformés résonnèrent dans leurs esprits comme celui du combat final du Bien contre le Mal… Leur violence devint sanctifiante, rituelle, de «purification», libérant des tréfonds de leur vie les frustrations les plus redoutables. Dès lors, tous les hérétiques devaient être exterminés. Sans discernement. Une violence archétypale fut déchaînée, avec la bénédiction des plus hautes autorités, tant religieuses que laïcs. Une violence punitive tournée contre les hommes, les femmes, les enfants : il s’agissait de débarrasser l’humanité de la souillure des corps protestants… Violence de possession divine, aveugle, qui conduisit non pas à un massacre, celui de la fameuse nuit, mais à d’innombrables massacres que la mémoire collective n’a pas voulu retenir. Une violence telle, qu’elle devint rapidement pénitentielle, faisant retour contre les catholiques eux-mêmes, pour distinguer parmi eux les bons des hésitants… Une violence qui se retourna bientôt contre les politiques, qui brusquement voyaient leur échapper l’aveuglement de tout un peuple et croyait pouvoir y mettre un terme. Une violence qui déborda de toute part, s’en prenant bientôt à toutes les formes de tolérance civique qui risquaient de se faire jour dans ces discours de plus en plus nombreux qui en dénonçaient les excès. Il faut aussi, ici, rappeler le poids des grandes rivalités seigneuriales, profitant de l’aubaine d’un pays déstabilisé pour alimenter ces haines et fomenter leurs règlements de compte sordides, les Montmorency, les Guise, les Bourbons, mettant à feu et à sang le pays pour s’éliminer les unes les autres, à la plus grande joie du roi de France qui y vit l’occasion de les voir s’affaiblir assez pour leur ravir ce Pouvoir Absolu qu’il convoitait tant. Il faut comprendre ce rôle joué par ce pouvoir de plus en plus central, qui compris très vite l’intérêt de criminaliser le délit d’opinion religieuse. Le mauvais croyant devenait un mauvais sujet. Toute prédiction devenait un crime et les tribunaux royaux, non la juridiction de l’Eglise, procédèrent eux-mêmes aux persécutions des réformés, multipliant les exécutions publiques et pratiquant ce que l’on nommait alors le Coup d’Etat : l’exécution précédent la sentence ! Des tribunaux d’exception en quelque sorte, que l’on ouvrit partout. Allant même, la nuit qui précéda la Saint Barthélémy, jusqu’à donner l’ordre d’exécuter les leaders réformés ! Le roi devenait un tyran, l’absolutisme français prenait forme, l’arbitraire était sa règle. A un point tel que dans l’Eglise catholique elle-même des voix se firent entendre. Celles des jésuites, celles des dominicains, que cet arbitraire inquiétait. Les régicides de l’époque furent du reste catholiques. La répression achevée, la fronde menaçant, les rois cherchèrent une sortie laissant indemne la nature de cette nouvelle domination qu’ils avaient su mettre en place. Avant l’Edit de Nantes, de nombreux autres édits furent tentés, tout comme des actes de Concorde. Le roi assujettit d’abord la noblesse en instituant un système de cour compliqué pour la diviser efficacement. Aux réformés, il finit par proposer une entente articulée par l’idée de tolérance civile. L’idée était belle, qui reconnaissait la liberté de conscience et de culte. L’heure vint de signer le fameux Edit de Nantes, conçu par la Monarchie comme provisoire, comme une machine faite pour restaurer son ordre et permettre à l’Eglise de reconquérir les âmes égarées. Une tolérance, on le voit, provisoire, quant aux yeux des réformés elle passait pour définitive…
Alors partout se leva face à cette violence protestante la grande violence catholique, encouragée par la monarchie. Les catholiques étaient alors traversés par l’idée de l’imminence de la fin du monde. Le combat contre les réformés résonnèrent dans leurs esprits comme celui du combat final du Bien contre le Mal… Leur violence devint sanctifiante, rituelle, de «purification», libérant des tréfonds de leur vie les frustrations les plus redoutables. Dès lors, tous les hérétiques devaient être exterminés. Sans discernement. Une violence archétypale fut déchaînée, avec la bénédiction des plus hautes autorités, tant religieuses que laïcs. Une violence punitive tournée contre les hommes, les femmes, les enfants : il s’agissait de débarrasser l’humanité de la souillure des corps protestants… Violence de possession divine, aveugle, qui conduisit non pas à un massacre, celui de la fameuse nuit, mais à d’innombrables massacres que la mémoire collective n’a pas voulu retenir. Une violence telle, qu’elle devint rapidement pénitentielle, faisant retour contre les catholiques eux-mêmes, pour distinguer parmi eux les bons des hésitants… Une violence qui se retourna bientôt contre les politiques, qui brusquement voyaient leur échapper l’aveuglement de tout un peuple et croyait pouvoir y mettre un terme. Une violence qui déborda de toute part, s’en prenant bientôt à toutes les formes de tolérance civique qui risquaient de se faire jour dans ces discours de plus en plus nombreux qui en dénonçaient les excès. Il faut aussi, ici, rappeler le poids des grandes rivalités seigneuriales, profitant de l’aubaine d’un pays déstabilisé pour alimenter ces haines et fomenter leurs règlements de compte sordides, les Montmorency, les Guise, les Bourbons, mettant à feu et à sang le pays pour s’éliminer les unes les autres, à la plus grande joie du roi de France qui y vit l’occasion de les voir s’affaiblir assez pour leur ravir ce Pouvoir Absolu qu’il convoitait tant. Il faut comprendre ce rôle joué par ce pouvoir de plus en plus central, qui compris très vite l’intérêt de criminaliser le délit d’opinion religieuse. Le mauvais croyant devenait un mauvais sujet. Toute prédiction devenait un crime et les tribunaux royaux, non la juridiction de l’Eglise, procédèrent eux-mêmes aux persécutions des réformés, multipliant les exécutions publiques et pratiquant ce que l’on nommait alors le Coup d’Etat : l’exécution précédent la sentence ! Des tribunaux d’exception en quelque sorte, que l’on ouvrit partout. Allant même, la nuit qui précéda la Saint Barthélémy, jusqu’à donner l’ordre d’exécuter les leaders réformés ! Le roi devenait un tyran, l’absolutisme français prenait forme, l’arbitraire était sa règle. A un point tel que dans l’Eglise catholique elle-même des voix se firent entendre. Celles des jésuites, celles des dominicains, que cet arbitraire inquiétait. Les régicides de l’époque furent du reste catholiques. La répression achevée, la fronde menaçant, les rois cherchèrent une sortie laissant indemne la nature de cette nouvelle domination qu’ils avaient su mettre en place. Avant l’Edit de Nantes, de nombreux autres édits furent tentés, tout comme des actes de Concorde. Le roi assujettit d’abord la noblesse en instituant un système de cour compliqué pour la diviser efficacement. Aux réformés, il finit par proposer une entente articulée par l’idée de tolérance civile. L’idée était belle, qui reconnaissait la liberté de conscience et de culte. L’heure vint de signer le fameux Edit de Nantes, conçu par la Monarchie comme provisoire, comme une machine faite pour restaurer son ordre et permettre à l’Eglise de reconquérir les âmes égarées. Une tolérance, on le voit, provisoire, quant aux yeux des réformés elle passait pour définitive… Première traduction en français d'un texte resté inédit du vivant de son auteur. Texte tardif, récapitulant dans sa construction même la trajectoire intellectuelle de Giordano Bruno, sinon son œuvre. L'ouvrage emprunte en effet beaucoup aux arts de la mémoire, pour construire son exposition sur le modèle de la visite d'un palais démultipliant jusqu'à l'obsession ses objets de pensée. Le tout avec désinvolture, voire négligence, comme s'il s'était agi de cheminer parmi les objets pensés, plutôt que de les enfermer dans des notions jalouses de leur signification théorique. Mais voulant éclairer la théorie par la pratique, le texte ne comprend aucune réelle visée pratique. La magie dont il est question ouvre moins à la manipulation de formules qu'à l'exigence d'éclairer de manière raisonnée la nature de l'univers. Et le mage dont il fait mention est plutôt un sage oeuvrant à la réconciliation du savoir et de l'action. Le lecteur curieux d'incantations ne trouvera donc ici aucune nourriture ; la thèse nonchalante que Bruno expose est celle de l'unité du monde, de sa solidarité et de sa continuité spirituelle. S'il est vrai que le sens est partout dans l'univers, alors il doit bien exister " une voie d'accès de toutes choses vers toutes choses ". Louons les éditions Allia de nous offrir ce texte assorti de notes qui ne dissimulent pas les difficultés de la traduction.
Première traduction en français d'un texte resté inédit du vivant de son auteur. Texte tardif, récapitulant dans sa construction même la trajectoire intellectuelle de Giordano Bruno, sinon son œuvre. L'ouvrage emprunte en effet beaucoup aux arts de la mémoire, pour construire son exposition sur le modèle de la visite d'un palais démultipliant jusqu'à l'obsession ses objets de pensée. Le tout avec désinvolture, voire négligence, comme s'il s'était agi de cheminer parmi les objets pensés, plutôt que de les enfermer dans des notions jalouses de leur signification théorique. Mais voulant éclairer la théorie par la pratique, le texte ne comprend aucune réelle visée pratique. La magie dont il est question ouvre moins à la manipulation de formules qu'à l'exigence d'éclairer de manière raisonnée la nature de l'univers. Et le mage dont il fait mention est plutôt un sage oeuvrant à la réconciliation du savoir et de l'action. Le lecteur curieux d'incantations ne trouvera donc ici aucune nourriture ; la thèse nonchalante que Bruno expose est celle de l'unité du monde, de sa solidarité et de sa continuité spirituelle. S'il est vrai que le sens est partout dans l'univers, alors il doit bien exister " une voie d'accès de toutes choses vers toutes choses ". Louons les éditions Allia de nous offrir ce texte assorti de notes qui ne dissimulent pas les difficultés de la traduction. Avec plus d'une centaine d'ouvrages publiés, cette collection s'est affirmée comme une référence en matière de vulgarisation scientifique. Dans un langage clair et simple, l'auteur réussit la prouesse de fixer en peu de pages toute la genèse de l'idée d'infini. Erudit sans être rébarbatif, il cadre, avec une concision conceptuelle peu commune, les débats théologiques et philosophiques qui ont bouleversé l'Europe des XVIe et XVIIe siècles.
Avec plus d'une centaine d'ouvrages publiés, cette collection s'est affirmée comme une référence en matière de vulgarisation scientifique. Dans un langage clair et simple, l'auteur réussit la prouesse de fixer en peu de pages toute la genèse de l'idée d'infini. Erudit sans être rébarbatif, il cadre, avec une concision conceptuelle peu commune, les débats théologiques et philosophiques qui ont bouleversé l'Europe des XVIe et XVIIe siècles. Une Histoire politique.
Une Histoire politique. A quoi ressemble donc la France de cette période ? Elle n’est alors qu’un puzzle de principautés, nous dit Claude Gauvard. Une douzaine, aux frontières floues, fluctuantes, sans grande rigueur administrative. Il n’y a pas de Pouvoir central. Ce concept que nous utilisions jusque là pour l’évoquer, affirme-t-elle encore, aura été préjudiciable à la description de cette France qui n’existe que sur le papier, interdisant d’en comprendre le fonctionnement politique et administratif.
A quoi ressemble donc la France de cette période ? Elle n’est alors qu’un puzzle de principautés, nous dit Claude Gauvard. Une douzaine, aux frontières floues, fluctuantes, sans grande rigueur administrative. Il n’y a pas de Pouvoir central. Ce concept que nous utilisions jusque là pour l’évoquer, affirme-t-elle encore, aura été préjudiciable à la description de cette France qui n’existe que sur le papier, interdisant d’en comprendre le fonctionnement politique et administratif. Comment fonctionnait ce pouvoir ? L’étude est particulièrement intéressante sur ce point, qui décrypte les actes établis au long des règnes des capétiens. Au commencement, le Roi a besoin de témoins en très grand nombre pour valider ses propres actes : sa parole ne suffit pas. Et ces témoins sont les châtelains qu’il récompense en leur offrant des offices. Le succès économique de la principauté des capétiens est tel, que bientôt le roi, lié par tant d’allégeances, pourra se passer de témoins. En 1077 apparaissent les premiers Commandements, qui sont des petits ordres brefs sans grande portée, mais symboliquement importants : le roi commence d’affirmer son Pouvoir. Il ne cherche pas encore à s’imposer au sens d’un Etat qui décide : la monarchie des Capétiens est d’abord familiale, patriarcale. Dans leur stratégie de conquête du pouvoir, les capétiens ne vont pas d’abord imposer un royaume, mais la personne du roi, qui peu à peu va pouvoir émanciper son autorité de la dépendance des nobles
Comment fonctionnait ce pouvoir ? L’étude est particulièrement intéressante sur ce point, qui décrypte les actes établis au long des règnes des capétiens. Au commencement, le Roi a besoin de témoins en très grand nombre pour valider ses propres actes : sa parole ne suffit pas. Et ces témoins sont les châtelains qu’il récompense en leur offrant des offices. Le succès économique de la principauté des capétiens est tel, que bientôt le roi, lié par tant d’allégeances, pourra se passer de témoins. En 1077 apparaissent les premiers Commandements, qui sont des petits ordres brefs sans grande portée, mais symboliquement importants : le roi commence d’affirmer son Pouvoir. Il ne cherche pas encore à s’imposer au sens d’un Etat qui décide : la monarchie des Capétiens est d’abord familiale, patriarcale. Dans leur stratégie de conquête du pouvoir, les capétiens ne vont pas d’abord imposer un royaume, mais la personne du roi, qui peu à peu va pouvoir émanciper son autorité de la dépendance des nobles