 L’auteur du succès mondain Comment parler des livres que l’on n’a pas lu, réitère avec une sorte de guide de l’apprentissage tortueux de soi, qui n’est au fond rien d’autre que la complaisance à l’art de se mentir en affectant la sincérité du savant qui sait ce que jacter veut dire…
L’auteur du succès mondain Comment parler des livres que l’on n’a pas lu, réitère avec une sorte de guide de l’apprentissage tortueux de soi, qui n’est au fond rien d’autre que la complaisance à l’art de se mentir en affectant la sincérité du savant qui sait ce que jacter veut dire…
Il s’agit donc pour lui d’élucider ce qu’il aurait pu être pendant la guerre de 39-45. La réponse en soi est statistiquement simple : comme l’immense majorité des français, ni héros, ni salaud. Mais Bayard est bouffon et ne peut se contenter de figurer dans les comptes pâlichons de la nation française. Sa vanité le pousse à travailler un clivage plus ambitieux, et notre homme de se demander si, après tout, il n’aurait pas été de l’étoffe des héros, ou, tant qu’à se distinguer, de la graine des salauds.
Né en 1954, voici qu’il se projette dans les années 20. Comme papa… Il lui prend même sa place, ce qui, pour un psychanalyste, est assez loustic, avouez… Pour enrober le tout d’un semblant de discipline, Bayard élabore un concept fumeux qui va lui permettre de démarrer l’enquête : celui de personnalité potentielle… Je vous rassure, il l’abandonnera lui-même en cours de route, n’y constatant aucune épaisseur, pour se rabattre sur les concepts coutumiers de la psychologie et se référer à des travaux plus solides que le sien –qu’il prend en otage de sa navrante démonstration. Car elle est bien navrante cette démonstration, professant sans rire que la personnalité potentielle, c’est cette partie (admirez la précision conceptuelle) de notre personnalité qui peut (plus imprécis tu meurs) surgir quand les circonstances l’autorise (itou). Quelle découverte ! Quelle avancée pour la science, d’autant que notre chercheur n’hésite pas à scier sa propre branche en avouant qu’il existe une vraie porosité entre la personnalité potentielle et la personnalité réelle, ce que d’aucun avait compris… Sur le front théorique, force est de constater que Bayard n’est pas de l’étoffe dont on fait les penseurs. Les roublards, oui, peut-être…
Et puis au bout d’une centaine de pages notre homme avoue qu’il n’aurait pas été bien différent de ce qu’il est aujourd’hui… Mais le plus beau reste à venir. Quand Pierre Bayard, plein d’un bon sens édifiant, argue qu’il est facile aujourd’hui d’affirmer une position, "tranquillement assis dans son fauteuil, lequel se trouve lui-même installé dans une maison sise dans un pays en paix". Admirez la force du raisonnement… Ce qui seul interpelle, c’est le dispositif de cette insignifiante indolence : un fauteuil, une maison, un pays pacifié… Voilà qui sent son confort d’héritier, aveugle à la misère qui sévit dans le pays, au racisme qui s’y est élevé comme un vrai front de guerre, muet sur la situation désespérée que vivent des millions de français… Un vrai pantouflard, oui, de la veine des mesquins qui taillent leur bonheur dans l’immonde confort d’une citoyenneté de salon. On devine à quoi aurait ressemblé en vrai le bonhomme sous l’occupation, aux indignations tardives et à l’égoïsme forcené…
Le plus drôle, c’est de le voir se fonder sur l’attitude de papa pour dire qu’au fond, il n’aurait rien fait. De papa, il rappelle quand même un grand geste résistant : en khâgne, papa avait osé afficher sur la porte de son casier le portrait du Maréchal Pétain, à l’envers… Il en sera gourmandé et tout est rentré dans l’ordre…
Bayard-fils-papa, lui, pense qu’il n’aurait de toute façon pas été sensible aux discours de la Révolution Nationale, pour preuve : dans les années 60 (il avait alors entre 10 et 15 ans), l’enfant qu’il était s’est entiché de communisme. La belle affaire…
Tout le reste est à l’emporte-pièce, puisant aux sources d’études sérieuses, sans convaincre : mieux vaut lire la littérature scientifique que les littératures secondaires… Bayard serait donc resté en France et comme tant d’autres, se serait accommodé de la présence allemande, pourvue qu’elle ne l’empêchât pas d’entrer à Normal Sup’…
Gâteau sur la cerise, la cogitation de Bayard reconnaissant tout d’abord que la question prétexte (aurais-je été, etc.) était tout de même passablement limitée, pour ne pas dire chétive, pour affirmer ensuite que bien que limitée, il n’en démord pas : elle demeure à ses yeux la meilleure façon de poser celle de l’engagement… En d’autres termes : pour savoir si je saurai m’engager demain, il faut que je me pose la question de savoir si je me serais engagé en 39-45… Mieux, avance-t-il : celui que la période n’attire pas pourra répéter la démarche en l’appliquant à une autre période historique, comme 1789. Voyons voir : qu’aurais-je été en 1789 ? -(sérieux, c’est dans son essai)-… Voire à la Cour de Louis XIV… Là, on défaille : combien d’entre nous aurait pu y prétendre ? Bref…Une nouvelle manière d’écrire l’histoire ? La littérature ? De faire de la biographie ? De l'autofiction ? Rien de tout cela : un marketing bien rôdé fait bien assez l’affaire.
Aurais-je été résistant ou bourreau ?, de Pierre Bayard, éd. de Minuit, Collection : Paradoxe Langue, janvier 2013, 158 pages, 15 euros, ISBN-13: 978-2707322777.



 Philosophe, historien de l’Antiquité, méditant obstiné de l’éternité qu’il attendait avec la gourmandise d’un Rimbaud, ne cessant de peaufiner l’art d’être différent de soi, l’ouvrage de textes posthumes de Lucien Jerphagnon publiés par les éditions Albin Michel, recueil de correspondance, d’articles, de conférences diverses, est absolument savoureux.
Philosophe, historien de l’Antiquité, méditant obstiné de l’éternité qu’il attendait avec la gourmandise d’un Rimbaud, ne cessant de peaufiner l’art d’être différent de soi, l’ouvrage de textes posthumes de Lucien Jerphagnon publiés par les éditions Albin Michel, recueil de correspondance, d’articles, de conférences diverses, est absolument savoureux. Bar-sur-Aude, un petit village de Champagne, pays de vallons et de collines, l’immensité intime sillonnée de ruisseaux. Le Vallage, dans la langue du pays, poinçonné des hachures bleutées que font les martin pêcheurs dans le ciel. Une histoire de gamins. Ça commence comme ça, la vie de Gaston : dans l’échappée des écoles buissonnières. Gaston, le fils du dépositaire de journaux, commis des postes et des télécommunications. Rien ne le retient plus que le feu devant la cheminée de ses parents. Gaston ne cesse de lui prodiguer ses soins. Il sait, mieux que personne, le rouge des braises qui convient pour rallumer la flamme. Et s’interroge déjà : qu’est-ce donc qui me retient dans le spectacle du feu ? Gaston poursuit sa route la journée achevée, jusqu’à la maison basse de sa grand-mère, attentif à ses gestes, toujours les mêmes quand elle prépare les gaufres. Le grésillement de la pâte, et puis le feu, encore et toujours. A peine plus loin dans le village, plus tard, sa femme, institutrice. A deux jours de son mariage, une lettre qu’on lui tend : nous sommes en 1914, Gaston doit partir pour le front, s’enterrer vif dans les tranchées de la Marne. Il a trente ans. Il écrit à sa femme qu’il voit au front le feu comme jamais il ne l’avait envisagé. "Celui qui pétrifie. Qu’on se jette à la figure et qui brûle tout". Une bombe explose, tue son ami d’enfance. Partout autour de lui la terre est éventrée, les camarades brûlent tandis que Gaston rampe au fond d’un trou. Le sentiment originel du feu se macule de l’horreur qui éclate soudain. Gaston étudiera le feu. Il s’en fait la promesse, là, dans les tranchées de la Marne. Il en fera une science. Une physique, dans son laboratoire du collège où il enseigne bientôt. La chaleur est un objet pour le savant, et peut-être cela le rassure-t-il de la tenir dans cette distance mathématique. Mesurer est une opération inflexible. Une science intraitable. Mais il voit bien que le feu est autre chose encore. Gaston qui aimait tant le feu n’a guère de goût pour la lumière administrée. Alors voici que tout revient, et qu’il n’aime plus guère administrer la lumière dans l’objectivité intraitable de sa discipline. Il a analysé le feu comme un objet de science, désormais le sensible le retient, le sensuel. "lI faut être poète pour dire le singulier des flammes". Gaston va s’y employer le reste de sa vie. Superbe moment de philosophie destinée à la méditation des enfants des écoles. Superbe enseignement qui leur est offert, dans la lecture insistante que le livre ébauche et à laquelle il contraint heureusement les adultes, dans l’accompagnement nécessaire des questions auxquelles il ouvre.
Bar-sur-Aude, un petit village de Champagne, pays de vallons et de collines, l’immensité intime sillonnée de ruisseaux. Le Vallage, dans la langue du pays, poinçonné des hachures bleutées que font les martin pêcheurs dans le ciel. Une histoire de gamins. Ça commence comme ça, la vie de Gaston : dans l’échappée des écoles buissonnières. Gaston, le fils du dépositaire de journaux, commis des postes et des télécommunications. Rien ne le retient plus que le feu devant la cheminée de ses parents. Gaston ne cesse de lui prodiguer ses soins. Il sait, mieux que personne, le rouge des braises qui convient pour rallumer la flamme. Et s’interroge déjà : qu’est-ce donc qui me retient dans le spectacle du feu ? Gaston poursuit sa route la journée achevée, jusqu’à la maison basse de sa grand-mère, attentif à ses gestes, toujours les mêmes quand elle prépare les gaufres. Le grésillement de la pâte, et puis le feu, encore et toujours. A peine plus loin dans le village, plus tard, sa femme, institutrice. A deux jours de son mariage, une lettre qu’on lui tend : nous sommes en 1914, Gaston doit partir pour le front, s’enterrer vif dans les tranchées de la Marne. Il a trente ans. Il écrit à sa femme qu’il voit au front le feu comme jamais il ne l’avait envisagé. "Celui qui pétrifie. Qu’on se jette à la figure et qui brûle tout". Une bombe explose, tue son ami d’enfance. Partout autour de lui la terre est éventrée, les camarades brûlent tandis que Gaston rampe au fond d’un trou. Le sentiment originel du feu se macule de l’horreur qui éclate soudain. Gaston étudiera le feu. Il s’en fait la promesse, là, dans les tranchées de la Marne. Il en fera une science. Une physique, dans son laboratoire du collège où il enseigne bientôt. La chaleur est un objet pour le savant, et peut-être cela le rassure-t-il de la tenir dans cette distance mathématique. Mesurer est une opération inflexible. Une science intraitable. Mais il voit bien que le feu est autre chose encore. Gaston qui aimait tant le feu n’a guère de goût pour la lumière administrée. Alors voici que tout revient, et qu’il n’aime plus guère administrer la lumière dans l’objectivité intraitable de sa discipline. Il a analysé le feu comme un objet de science, désormais le sensible le retient, le sensuel. "lI faut être poète pour dire le singulier des flammes". Gaston va s’y employer le reste de sa vie. Superbe moment de philosophie destinée à la méditation des enfants des écoles. Superbe enseignement qui leur est offert, dans la lecture insistante que le livre ébauche et à laquelle il contraint heureusement les adultes, dans l’accompagnement nécessaire des questions auxquelles il ouvre. Le petit anthropos est comme ça : il danse, bouge. Il remue et place toute son attention dans le montage de ce qu’il met en scène : des gesticulations d’abord imprécises, inadéquates, et puis des gestes qui finissent par dessiner un mouvement.
Le petit anthropos est comme ça : il danse, bouge. Il remue et place toute son attention dans le montage de ce qu’il met en scène : des gesticulations d’abord imprécises, inadéquates, et puis des gestes qui finissent par dessiner un mouvement.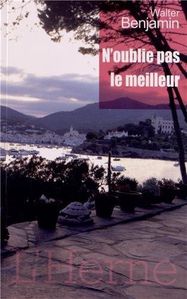 Des récits, des histoires, des contes, rédigés en même temps que Sens unique (1928), et Enfance Berlinoise (1932-1938). Des aphorismes, de très courts textes en fait la plupart du temps, quelques lignes, quelques pages. Walter Benjamin entendait apporter sa contribution à un débat initié par Adorno. Hors du concept, hors de toute cohérence théorique, s’exposant, se risquant, risquant dans ces formes fugitives une réconciliation qu’Adorno affirmait "prématurée", illusoire : celle que l’art propose.
Des récits, des histoires, des contes, rédigés en même temps que Sens unique (1928), et Enfance Berlinoise (1932-1938). Des aphorismes, de très courts textes en fait la plupart du temps, quelques lignes, quelques pages. Walter Benjamin entendait apporter sa contribution à un débat initié par Adorno. Hors du concept, hors de toute cohérence théorique, s’exposant, se risquant, risquant dans ces formes fugitives une réconciliation qu’Adorno affirmait "prématurée", illusoire : celle que l’art propose.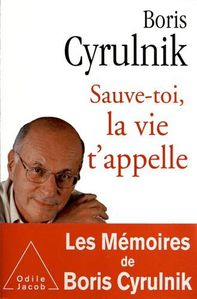 La clef du passé, c’est le présent. Ce présent que construit Boris Cyrulnik, ce présent qu’il instruit littéralement dans ce récit de vie. Un présent structuré par notre relation au monde, à autrui, un présent qui a renoncé non pas aux égarements ni aux erreurs de jugement, mais aux dangereuses abstractions utopiques auxquelles nous aimons tant nous soumettre quand nous coupant les choses du passé de la réalité pour en faire des blessures autour desquelles tourner sans cesse. Un présent au cœur duquel insérer, vivre la cohérence narrative d’un récit qui tirera sa force de l’harmonie que nous aurons su bâtir entre les récits de soi et les récits d’alentour.
La clef du passé, c’est le présent. Ce présent que construit Boris Cyrulnik, ce présent qu’il instruit littéralement dans ce récit de vie. Un présent structuré par notre relation au monde, à autrui, un présent qui a renoncé non pas aux égarements ni aux erreurs de jugement, mais aux dangereuses abstractions utopiques auxquelles nous aimons tant nous soumettre quand nous coupant les choses du passé de la réalité pour en faire des blessures autour desquelles tourner sans cesse. Un présent au cœur duquel insérer, vivre la cohérence narrative d’un récit qui tirera sa force de l’harmonie que nous aurons su bâtir entre les récits de soi et les récits d’alentour. C’est au fond le plus important de cet ouvrage pour nous, que cette modalité d’écriture que nous voyons s’effectuer au fil des pages, balançant entre les lésions de l’enfance et le relèvement que la science apporte et qui contribue, elle aussi, à fabriquer cette chimère de soi qui permet d’échapper au trauma de la mémoire.
C’est au fond le plus important de cet ouvrage pour nous, que cette modalité d’écriture que nous voyons s’effectuer au fil des pages, balançant entre les lésions de l’enfance et le relèvement que la science apporte et qui contribue, elle aussi, à fabriquer cette chimère de soi qui permet d’échapper au trauma de la mémoire. Il faut donc s’évader, échapper au poids des images traumatiques. La clinique du traumatisme décrit une mémoire singulière : intrusive. Une mémoire qui modifie le fonctionnement même du cerveau, explique Cyrulnik. Centrée sur une image claire entourée de perceptions floues, elle impose l’horreur de la sidération visuelle. Elle barre, biffe, empêche que le langage, dans son aptitude à verbaliser, ne puisse aider à prendre la distance salvatrice qui nous soustraira aux images terrifiantes qui ne cessent de tétaniser l’être. «Tous les traumatisés ont une claire mémoire d’images et une mauvaise mémoire des mots », nous dit-il encore. Mais «les enfants dans la guerre ne sont pas les enfants de la guerre » : nous pouvons, nous devons, que l’on nous y aide ou non, chercher ailleurs des solutions. Ce peut être la fonction des ordalies intimes lorsque manque l’analyste qui viendra sceller la possibilité d’un récit de soi cohérent. Au moment où la douleur se re-présente, nous n’avons parfois que très peu de moyens à notre disposition. Boris Cyrulnik voit très bien comment ce courage morbide lui fit reprendre ses études par exemple, lui qui a choisi cette voie difficile à celle qui l’aurait soumis à la compassion mutilante que l’entourage propose trop souvent. Il faut pouvoir se faire témoin plutôt que martyr, bien que l’étymologie des deux mots soit identique : l’un est marqué, l’autre se dé-marque dans la distance qu’impose le témoignage. Car ce n’est qu’après coup qu’il est vraiment possible, dans la représentation du trauma vécu, d’affronter sa douleur. Dans cette créativité du témoin, comme lieu de résilience entre l’assemblage des images par trop précises et un halo de mots qu’il faut peu à peu arracher au trauma. C’est tout l’enjeu de ce travail d’écriture, dont la structure rhapsodique montre assez comment il se relance, tournant autour des mêmes images traumatisantes pour se défaire du poids de leur sidération par l’attention de l’explication savante
Il faut donc s’évader, échapper au poids des images traumatiques. La clinique du traumatisme décrit une mémoire singulière : intrusive. Une mémoire qui modifie le fonctionnement même du cerveau, explique Cyrulnik. Centrée sur une image claire entourée de perceptions floues, elle impose l’horreur de la sidération visuelle. Elle barre, biffe, empêche que le langage, dans son aptitude à verbaliser, ne puisse aider à prendre la distance salvatrice qui nous soustraira aux images terrifiantes qui ne cessent de tétaniser l’être. «Tous les traumatisés ont une claire mémoire d’images et une mauvaise mémoire des mots », nous dit-il encore. Mais «les enfants dans la guerre ne sont pas les enfants de la guerre » : nous pouvons, nous devons, que l’on nous y aide ou non, chercher ailleurs des solutions. Ce peut être la fonction des ordalies intimes lorsque manque l’analyste qui viendra sceller la possibilité d’un récit de soi cohérent. Au moment où la douleur se re-présente, nous n’avons parfois que très peu de moyens à notre disposition. Boris Cyrulnik voit très bien comment ce courage morbide lui fit reprendre ses études par exemple, lui qui a choisi cette voie difficile à celle qui l’aurait soumis à la compassion mutilante que l’entourage propose trop souvent. Il faut pouvoir se faire témoin plutôt que martyr, bien que l’étymologie des deux mots soit identique : l’un est marqué, l’autre se dé-marque dans la distance qu’impose le témoignage. Car ce n’est qu’après coup qu’il est vraiment possible, dans la représentation du trauma vécu, d’affronter sa douleur. Dans cette créativité du témoin, comme lieu de résilience entre l’assemblage des images par trop précises et un halo de mots qu’il faut peu à peu arracher au trauma. C’est tout l’enjeu de ce travail d’écriture, dont la structure rhapsodique montre assez comment il se relance, tournant autour des mêmes images traumatisantes pour se défaire du poids de leur sidération par l’attention de l’explication savante 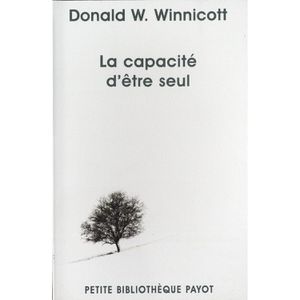 L’ouvrage est technique, plutôt qu’inscrit dans on ne sait quelle philosophie de la vie, voire compulsion à la sagesse new age recyclant tout texte ouvert à l’expérience de soi en bréviaire d’une assomption laborieuse.
L’ouvrage est technique, plutôt qu’inscrit dans on ne sait quelle philosophie de la vie, voire compulsion à la sagesse new age recyclant tout texte ouvert à l’expérience de soi en bréviaire d’une assomption laborieuse. Winnicott décrit cette solitude comme "un état sans orientation", où l’être s’ouvre d’un coup à une expérience toute "instinctuelle". Que faire de ce vocabulaire, de cet "instinctuel" jaillit d’on ne sait trop quelle pulsion ? Que faire de cette pulsion, de ce moment où sa venue s’impose en nous comme réelle et seule vraie expérience personnelle ? Une pulsion ? Je comprends bien, oui, que dans cette solitude, je ressente ce qui m’envahit comme m’étant propre plutôt que d’un autre, ou d’un lieu qui ne serait pas le mien. Pourtant… Winnicott affirme également que "l’état de solitude est un état qui (paradoxalement) implique toujours la présence de quelqu’un d’autre". La mère, évidemment. Et dont l’introjection maintiendrait de bout en bout la possibilité d’être seul. (En prenant garde que cette introjection ne recouvre pas tout, au point de se muer en pathologie, comme dans l’orgasme de l’extase que convoque Winicott). La mère donc, sa présence indicielle plutôt, marque, trace, mémoire, on ne sait trop. Pouvoir être seul donc, plutôt que l’être. Dans cette présence confiante, différée, asymétrique sinon dissymétrique, de la mère qui peut ne plus être, là, inaugurale pourtant, qui fait que l’on n’est plus jeté là (Dasein) dans le monde puisqu’elle a précédé ce jeté.
Winnicott décrit cette solitude comme "un état sans orientation", où l’être s’ouvre d’un coup à une expérience toute "instinctuelle". Que faire de ce vocabulaire, de cet "instinctuel" jaillit d’on ne sait trop quelle pulsion ? Que faire de cette pulsion, de ce moment où sa venue s’impose en nous comme réelle et seule vraie expérience personnelle ? Une pulsion ? Je comprends bien, oui, que dans cette solitude, je ressente ce qui m’envahit comme m’étant propre plutôt que d’un autre, ou d’un lieu qui ne serait pas le mien. Pourtant… Winnicott affirme également que "l’état de solitude est un état qui (paradoxalement) implique toujours la présence de quelqu’un d’autre". La mère, évidemment. Et dont l’introjection maintiendrait de bout en bout la possibilité d’être seul. (En prenant garde que cette introjection ne recouvre pas tout, au point de se muer en pathologie, comme dans l’orgasme de l’extase que convoque Winicott). La mère donc, sa présence indicielle plutôt, marque, trace, mémoire, on ne sait trop. Pouvoir être seul donc, plutôt que l’être. Dans cette présence confiante, différée, asymétrique sinon dissymétrique, de la mère qui peut ne plus être, là, inaugurale pourtant, qui fait que l’on n’est plus jeté là (Dasein) dans le monde puisqu’elle a précédé ce jeté. 30 juin 1869, Friedrich Engels quitte l’usine de textile qu’il dirige à Manchester. Il est heureux. Il clôt vingt années de labeur éprouvant, de contradictions douloureuses. Il chantonne, l’humeur légère, le visage rayonnant. Un brin canaille, lui qui aime mener grand train, boire plus que de raison, lui qui fut toute sa vie grand amateur de bonne chair et de la compagnie des femmes, se sent pousser de ailes.
30 juin 1869, Friedrich Engels quitte l’usine de textile qu’il dirige à Manchester. Il est heureux. Il clôt vingt années de labeur éprouvant, de contradictions douloureuses. Il chantonne, l’humeur légère, le visage rayonnant. Un brin canaille, lui qui aime mener grand train, boire plus que de raison, lui qui fut toute sa vie grand amateur de bonne chair et de la compagnie des femmes, se sent pousser de ailes. Sade, le dernier "philosophe médiéval", selon Onfray… On ne savait déjà pas trop ce qu’était un philosophe médiéval, ni moins encore de quel Moyen Âge parler dans cette constellation, celui de l’Europe ou celui de l’Afrique –la bibliothèque de Tombouctou demeurant peu fréquentée aujourd’hui encore par nos intellectuels. Mais Sade "philosophe", on le savait moins encore, et l’assignation aurait mérité d’être à tout le moins explicitée, s’agissant d’un auteur en qui la filiation critique a plutôt reconnu un écrivain qu’un penseur.
Sade, le dernier "philosophe médiéval", selon Onfray… On ne savait déjà pas trop ce qu’était un philosophe médiéval, ni moins encore de quel Moyen Âge parler dans cette constellation, celui de l’Europe ou celui de l’Afrique –la bibliothèque de Tombouctou demeurant peu fréquentée aujourd’hui encore par nos intellectuels. Mais Sade "philosophe", on le savait moins encore, et l’assignation aurait mérité d’être à tout le moins explicitée, s’agissant d’un auteur en qui la filiation critique a plutôt reconnu un écrivain qu’un penseur.