 Claire, Bob Dylan dans les oreilles, "un peu cow-boy, un peu indien". Elle va bientôt quitter son mari. Quand ? Elle ne le sait pas encore. Quand il le faudra. Bien qu’elle ne sache pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu’il a changé, qu’il est devenu prétentieux. Un consommateur prétentieux. D’elle comme de tout le reste, à gérer si scrupuleusement sa carrière. Elle l’a aimé pourtant. Tout juste aurait-elle pu se méfier de sa trop grande assurance. Une assurance qui l’a rejetée, elle, un peu en dehors du mouvement de la vie. Alors aujourd’hui elle contemple sa solitude.
Claire, Bob Dylan dans les oreilles, "un peu cow-boy, un peu indien". Elle va bientôt quitter son mari. Quand ? Elle ne le sait pas encore. Quand il le faudra. Bien qu’elle ne sache pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu’il a changé, qu’il est devenu prétentieux. Un consommateur prétentieux. D’elle comme de tout le reste, à gérer si scrupuleusement sa carrière. Elle l’a aimé pourtant. Tout juste aurait-elle pu se méfier de sa trop grande assurance. Une assurance qui l’a rejetée, elle, un peu en dehors du mouvement de la vie. Alors aujourd’hui elle contemple sa solitude.
Claire fait le point. Se rappelle son père dans les années 70, un peu communiste. Maintenant elle est seule avec ses deux garçons. Ni oncle, ni tante. Elle se rappelle son père qui rentrait au petit matin du boulot quand elle se levait pour aller à l’école. Un père modeste. Sage : "il n’y a rien que nous et nos choses, qui ne sont pas petites", avait-il coutume de lui dire. Enlevé par la mort.
Et elle observe son mari, joueur opportuniste de golf. Et sa propre vie professionnelle à elle, qui gère le patrimoine des autres. Une bête de maths, Claire. Mais elle n’en a plus vraiment le goût. Elle préfère admirer le désordre magique de la chambre des garçons. Tandis que son mari ne songe qu’à faire du fric, laminant jour après jour leur couple, leur famille. Le fric. Son seul truc désormais.
Et puis la narration tourne brusquement les talons. Surgit Jiordan, musicien nigérian, le professeur passionné de musique des enfants de Claire et des autres, du quartier. Mais un sans-papier, violemment projeté face contre à terre par les flics. Claire a voulu prendre sa défense, jetée à terre, elle se retrouve au commissariat au grand dam de son mari, inquiet pour sa carrière : dans quel pétrin t’es-tu fourrée ?… Un bruit de matraques envahit le roman. Jiordan est menotté, cogné, sa guitare fracassée avant qu’on ne le jette dans un fourgon et le déplace dans le centre de rétention de Vincennes.
Claire divorce. Cette fois sa décision est prise. La goutte d’eau que ce mari obsédé par sa carrière. Elle ne mange plus, fume, écoute de la musique, s’inquiète de Jiordan derrière ses barbelés, bien français – la France a une longue expérience des camps. Qu’il refuse. Il s’évade, retrouve un jour le bar qu’il fréquentait, Claire aussi, par hasard ou presque -une sorte de destin lie ces deux-là, qui se ressemblent au fond tellement. Le style est magique de concision, tout en pure dénotation : les faits parlent d’eux-mêmes. Pas d’adjectifs : il ne reste que ce grand vide entre les êtres, un monde disloqué, une sorte de viduité que nos vies ne parviennent presque pas à combler. Claire et Jiordan se retrouvent bien sûr, s’aiment, tentent quelque chose que la vie va déjouer. Le récit ne s’attarde pas, nous loge dans la retenue d’une aventure qui n’aura duré que le temps d’une ballade, de Dylan aussi bien, nous élève dans le charnel des sensations qui le traversent, le monde comme une meute, déjà lancée à nos trousses.
Mektoub, Denis Soula, éditions : Joëlle Losfeld, Collection : Littérature française/Joëlle Losfed, 2 février 2012, 128 pages, 13,50 eurosISBN-13: 978-2072462214.
 Par décret, l’air a été raréfié, puis privatisé. Les habitués se firent plus rares au gymnase, et l’opposition finit par se taire. Seul le Pouvoir ne manquait pas d’air. Greg-la-cloche, lui, dormait. Sur un tas de lettres qu’il destinait à sa fille. Mon petit cœur, ma merveille… Des lettres qu’il n’avait jamais envoyées : il pensait n’avoir jamais su trouver le ton. Le mot juste pour lui dire combien il l’aimait. La ville, elle, n’avait vécu que pour le CAC 40. Greg avait fui cette symbolique assujettie à des logiques obscures. Il avait écrit des milliers de lettres à sa fille. Tandis que la ville se dépeuplait. Les gens vivaient sous terre désormais. Comme Fleur, silhouette fugitive dans la pénombre des souterrains. Et bien d’autres, rebelles à bout de souffle malgré leur rage contre le Pouvoir. Contre les semi-remorques en particulier, qui déportaient les gens. Fleur avait quitté la terre avant qu’on ne la trie. Sous terre, une vraie galerie de personnages se fit jour. Organisant la dispersion du récit entre ces portraits farouches, sensibles, émouvants, comme si le monde ne tenait plus à grand-chose. Quelques visages, à peine. Quand la ville d’en haut ne jurait que par les marchés financiers. Des entités qui avaient fini par défaire la société. Briser les communautés. Les identités. Il aurait fallu prendre la parole contre les flux financiers, contre leur sémantique inhumaine. Mais il était peut-être trop tard. Les autorités s’employaient déjà à siphonner l’air du sous-sol. On payait cher désormais l’impôt sur l’air. Et parce qu’on en manquait et qu’on était à bout de souffle, l’estime de soi dégringolait jour après jour vertigineusement. Fleur luttait toujours. Comme elle pouvait. Et Greg, l’un des rares à ne pas payer l’impôt. La guerre était en cours. Les autorités aspiraient l’air. Une histoire de souffle. Du manque tragique de souffle de l’Histoire. Dans un récit où la langue s’effiloche, ou la grammaire, la syntaxe, la sémantique s’étiolent. Qui parle ou ne parle plus n’a pas d’importance. Ça parle encore, et c’est bien tout, comme un flux héraclitéen charriant la débandade du monde et des moyens d’en parler encore.
Par décret, l’air a été raréfié, puis privatisé. Les habitués se firent plus rares au gymnase, et l’opposition finit par se taire. Seul le Pouvoir ne manquait pas d’air. Greg-la-cloche, lui, dormait. Sur un tas de lettres qu’il destinait à sa fille. Mon petit cœur, ma merveille… Des lettres qu’il n’avait jamais envoyées : il pensait n’avoir jamais su trouver le ton. Le mot juste pour lui dire combien il l’aimait. La ville, elle, n’avait vécu que pour le CAC 40. Greg avait fui cette symbolique assujettie à des logiques obscures. Il avait écrit des milliers de lettres à sa fille. Tandis que la ville se dépeuplait. Les gens vivaient sous terre désormais. Comme Fleur, silhouette fugitive dans la pénombre des souterrains. Et bien d’autres, rebelles à bout de souffle malgré leur rage contre le Pouvoir. Contre les semi-remorques en particulier, qui déportaient les gens. Fleur avait quitté la terre avant qu’on ne la trie. Sous terre, une vraie galerie de personnages se fit jour. Organisant la dispersion du récit entre ces portraits farouches, sensibles, émouvants, comme si le monde ne tenait plus à grand-chose. Quelques visages, à peine. Quand la ville d’en haut ne jurait que par les marchés financiers. Des entités qui avaient fini par défaire la société. Briser les communautés. Les identités. Il aurait fallu prendre la parole contre les flux financiers, contre leur sémantique inhumaine. Mais il était peut-être trop tard. Les autorités s’employaient déjà à siphonner l’air du sous-sol. On payait cher désormais l’impôt sur l’air. Et parce qu’on en manquait et qu’on était à bout de souffle, l’estime de soi dégringolait jour après jour vertigineusement. Fleur luttait toujours. Comme elle pouvait. Et Greg, l’un des rares à ne pas payer l’impôt. La guerre était en cours. Les autorités aspiraient l’air. Une histoire de souffle. Du manque tragique de souffle de l’Histoire. Dans un récit où la langue s’effiloche, ou la grammaire, la syntaxe, la sémantique s’étiolent. Qui parle ou ne parle plus n’a pas d’importance. Ça parle encore, et c’est bien tout, comme un flux héraclitéen charriant la débandade du monde et des moyens d’en parler encore. 


 Dix ans. Inlassablement fasciné par les mouvements de la barque de pêche au gré des vagues. Dix ans, le cap solennel, l’enfance qui prend fin. Eri se rappelle la guerre à l’époque de ses dix ans, dont on sortait à peine et les livres de son père. Et puis surtout, le jour où il s’est mis à pleurer. Beaucoup. A force d’observer la vulnérabilité du monde des adultes. Pathétiques pour la plupart.
Dix ans. Inlassablement fasciné par les mouvements de la barque de pêche au gré des vagues. Dix ans, le cap solennel, l’enfance qui prend fin. Eri se rappelle la guerre à l’époque de ses dix ans, dont on sortait à peine et les livres de son père. Et puis surtout, le jour où il s’est mis à pleurer. Beaucoup. A force d’observer la vulnérabilité du monde des adultes. Pathétiques pour la plupart.
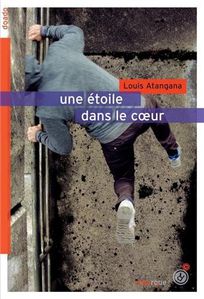 Papa est parti. Envolé. Il en a eu assez de la misère : ingénieur en Afrique, gardien de supermarché en France, avec de nombreuses escales à Pôle Emploi, qui l’a laissé en rade. Ingénieur pourtant, mais noir. Reste sa sœur et sa mère. Juive. Dans la cité des Iris. Juif congolais donc. Mais Damien ne sait pas trop ce que ça veut dire. Dans la cité, il se voit plutôt Black. Ni juif ni africain. Un black des Iris, où beaucoup de naufragés dérivent. En dérive lui-même, à se vouloir black quand il n’est que noir en France. En dérive comme Ahmed, l'ex-ouvrier révolutionnaire de 68, bouquiniste sans bouquins, sans domicile fixe, laissé pour compte des révolutionnaires bourgeois qui ont fondé Libé. Ou bien Hussein, le grand blond déguisé en taliban, originaire de Roubaix. En dérive donc, sans savoir quoi faire de sa négritude juive. Il crèche dans une blessure. Observant qu’aux Iris, la moitié des gens ne savent plus ce qu’ils font là. Pris au piège.
Papa est parti. Envolé. Il en a eu assez de la misère : ingénieur en Afrique, gardien de supermarché en France, avec de nombreuses escales à Pôle Emploi, qui l’a laissé en rade. Ingénieur pourtant, mais noir. Reste sa sœur et sa mère. Juive. Dans la cité des Iris. Juif congolais donc. Mais Damien ne sait pas trop ce que ça veut dire. Dans la cité, il se voit plutôt Black. Ni juif ni africain. Un black des Iris, où beaucoup de naufragés dérivent. En dérive lui-même, à se vouloir black quand il n’est que noir en France. En dérive comme Ahmed, l'ex-ouvrier révolutionnaire de 68, bouquiniste sans bouquins, sans domicile fixe, laissé pour compte des révolutionnaires bourgeois qui ont fondé Libé. Ou bien Hussein, le grand blond déguisé en taliban, originaire de Roubaix. En dérive donc, sans savoir quoi faire de sa négritude juive. Il crèche dans une blessure. Observant qu’aux Iris, la moitié des gens ne savent plus ce qu’ils font là. Pris au piège.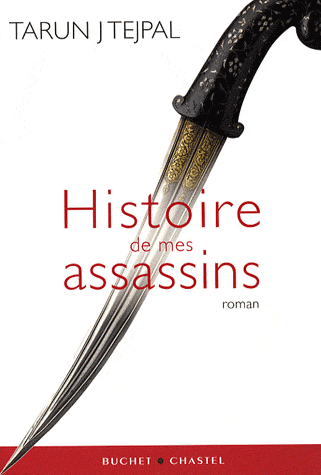 « Le fascisme nous gagne sans même que nous le sachions »
« Le fascisme nous gagne sans même que nous le sachions »
 Une ligne de rides coupant le front de part en part, que l’on découvre un jour tout surpris, ou bien une écorchure infime sur le bout de la langue, enroulant soudain le monde à sa médiocre ulcération. La matière de cet écrivain pourrait n’être que négligeable, ses outils d’auscultation du Cosmos, dérisoires : la peau, tout juste la main. Mais l’adhérence à ce monde semble ne tenir jamais qu’aux plus succincts détails : l’étonnement de pouvoir encore s’examiner comme une surface. Jean-Luc Moreau révèle ainsi la nostalgie des curiosités impossibles qui sommeillent en nous. Des seuils de conscience qui, littéralement, nous enlèvent au monde pour mieux nous y réinscrire, en faisant naître le réel de la fiction.
Une ligne de rides coupant le front de part en part, que l’on découvre un jour tout surpris, ou bien une écorchure infime sur le bout de la langue, enroulant soudain le monde à sa médiocre ulcération. La matière de cet écrivain pourrait n’être que négligeable, ses outils d’auscultation du Cosmos, dérisoires : la peau, tout juste la main. Mais l’adhérence à ce monde semble ne tenir jamais qu’aux plus succincts détails : l’étonnement de pouvoir encore s’examiner comme une surface. Jean-Luc Moreau révèle ainsi la nostalgie des curiosités impossibles qui sommeillent en nous. Des seuils de conscience qui, littéralement, nous enlèvent au monde pour mieux nous y réinscrire, en faisant naître le réel de la fiction. Claire, Bob Dylan dans les oreilles, "un peu cow-boy, un peu indien". Elle va bientôt quitter son mari. Quand ? Elle ne le sait pas encore. Quand il le faudra. Bien qu’elle ne sache pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu’il a changé, qu’il est devenu prétentieux. Un consommateur prétentieux. D’elle comme de tout le reste, à gérer si scrupuleusement sa carrière. Elle l’a aimé pourtant. Tout juste aurait-elle pu se méfier de sa trop grande assurance. Une assurance qui l’a rejetée, elle, un peu en dehors du mouvement de la vie. Alors aujourd’hui elle contemple sa solitude.
Claire, Bob Dylan dans les oreilles, "un peu cow-boy, un peu indien". Elle va bientôt quitter son mari. Quand ? Elle ne le sait pas encore. Quand il le faudra. Bien qu’elle ne sache pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu’il a changé, qu’il est devenu prétentieux. Un consommateur prétentieux. D’elle comme de tout le reste, à gérer si scrupuleusement sa carrière. Elle l’a aimé pourtant. Tout juste aurait-elle pu se méfier de sa trop grande assurance. Une assurance qui l’a rejetée, elle, un peu en dehors du mouvement de la vie. Alors aujourd’hui elle contemple sa solitude. Troisième volet de l’autobiographie fictive de Coetzee, confiée ici à un jeune universitaire chargé de collecter des témoignages sur l’auteur qui atteint la trentaine et fait retour au pays natal, retrouvant son père vieillissant dans sa maison délabrée du Cap.
Troisième volet de l’autobiographie fictive de Coetzee, confiée ici à un jeune universitaire chargé de collecter des témoignages sur l’auteur qui atteint la trentaine et fait retour au pays natal, retrouvant son père vieillissant dans sa maison délabrée du Cap. Il est des livres qui vous frappent par leur intelligence. Comme celui-ci. Par son adéquation en particulier, entre la forme et le fond. Voilà une manière d’écrire l’histoire du rugby qui colle parfaitement à sa nature ! C’est intelligent au possible et étonnant. Des miscellanées ! Tout à fait dans l’esprit de ce sérieux mêlé d’humour qui caractérise selon Walter Spanghero -qui signe la préface-, le rugby. Pas moins savant que n’importe quelle étude sur le sujet, ces miscellanées se relancent un peu comme la balle au détour d’un rebond capricieux, ouvrant mille surprises et autres anecdotes savoureuses, tout autant qu’à l’intelligence de comprendre autrement le rugby, interrogé ici dans sa réalité sensible plutôt que dans sa théorie. Olivier Villepreux brise même la hiérarchie de l’approche théorique, donnant pour le coup à comprendre le vrai sens étymologique du mot théorie, qui est "chercher". On le voit bien chercher, proposer, offrir contre la linéarité du discours historien par exemple, le tracé aventureux du sensible dans cette parole ouverte par le rugby. Ce que parler rugby veut dire me semble tout entier présent, là. Dans cette errance apparente, oscillant sans cesse entre le banal et le sublime, les lieux mêmes du rugby, comme de la poésie au sens où l’entendaient les romantiques allemands. C’est qu’Olivier Villepreux a parfaitement compris que le sens n’était pas un objet planté dans un décor commode, mais un dialogue.
Il est des livres qui vous frappent par leur intelligence. Comme celui-ci. Par son adéquation en particulier, entre la forme et le fond. Voilà une manière d’écrire l’histoire du rugby qui colle parfaitement à sa nature ! C’est intelligent au possible et étonnant. Des miscellanées ! Tout à fait dans l’esprit de ce sérieux mêlé d’humour qui caractérise selon Walter Spanghero -qui signe la préface-, le rugby. Pas moins savant que n’importe quelle étude sur le sujet, ces miscellanées se relancent un peu comme la balle au détour d’un rebond capricieux, ouvrant mille surprises et autres anecdotes savoureuses, tout autant qu’à l’intelligence de comprendre autrement le rugby, interrogé ici dans sa réalité sensible plutôt que dans sa théorie. Olivier Villepreux brise même la hiérarchie de l’approche théorique, donnant pour le coup à comprendre le vrai sens étymologique du mot théorie, qui est "chercher". On le voit bien chercher, proposer, offrir contre la linéarité du discours historien par exemple, le tracé aventureux du sensible dans cette parole ouverte par le rugby. Ce que parler rugby veut dire me semble tout entier présent, là. Dans cette errance apparente, oscillant sans cesse entre le banal et le sublime, les lieux mêmes du rugby, comme de la poésie au sens où l’entendaient les romantiques allemands. C’est qu’Olivier Villepreux a parfaitement compris que le sens n’était pas un objet planté dans un décor commode, mais un dialogue.