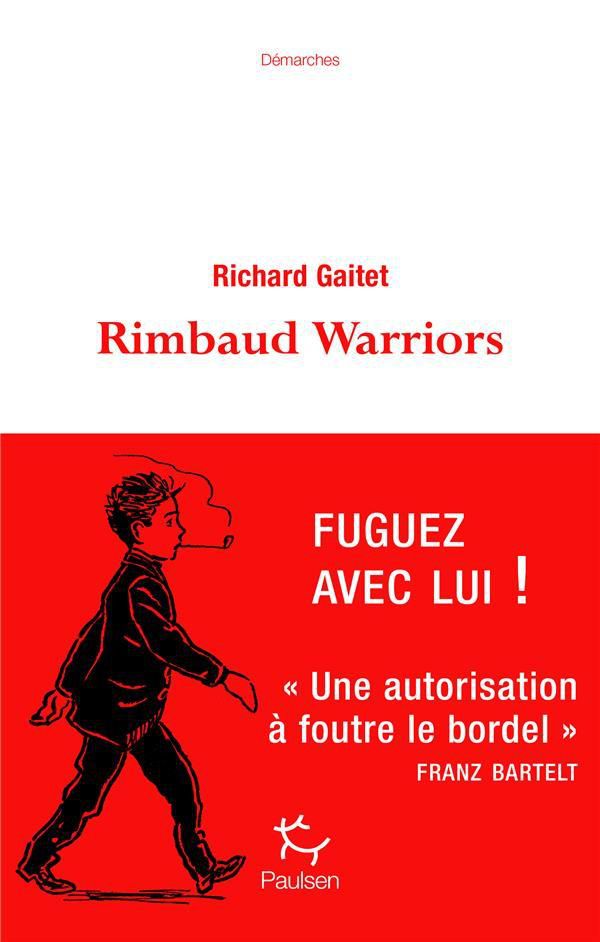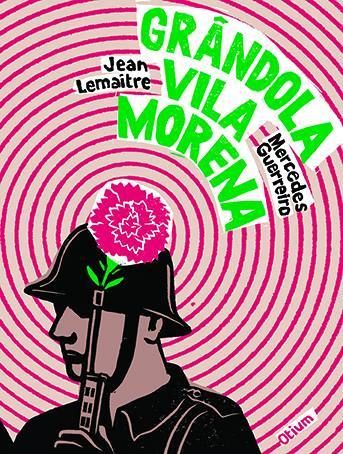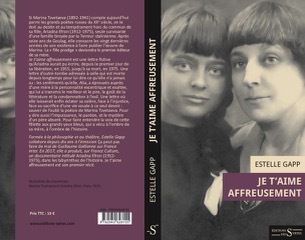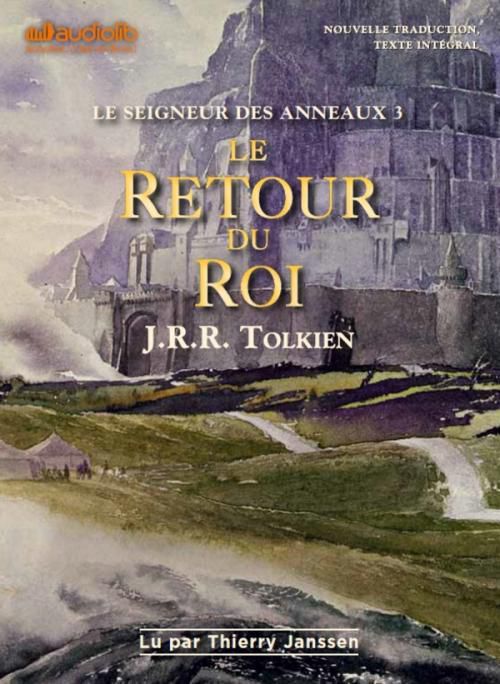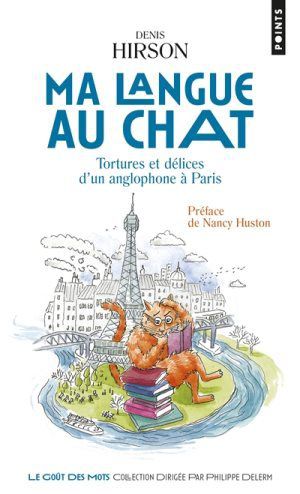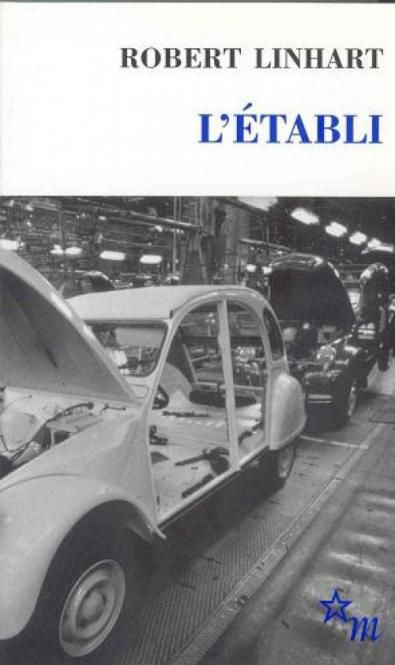Un poème. Un seul et long poème. Mais un polar en poème ! Une forme unique, fiévreuse, incandescente, le flux héraclitéen des mots déversé comme une rivière en crue qui ne cesserait de répandre son trop plein. Quand tout est consommé, consumé. West Texas. Serpents et coyotes. Tout au fond d’un puits, deux cadavres et Dany, qui agonise. La chute ne l’a pas tué. Il hurle : Papa ! Tandis qu’au fond de l’eau pourrissent deux Mexicains. Papa !... A lui, le flic, le Sheriff, qui tourne le dos et rentre tranquillement s’occuper de sa femme, la mère du petit, boire sa bière, se détendre devant sa télé. Sheriff de King County. Tournant les bottes, le petit au fond du puits, pour ne songer qu’à sa soirée. Un bon bœuf et vidéo gags. Tranquille : son ordre règne. L’ordre des flics. En attendant demain pour organiser une battue à la recherche de Dany. Qu’on ne trouvera pas. C’est ça le putain d'ordre des flics, partout dans le monde. C’est ça être flic : être comme un clebs en rut, n’écouter que son instinct, à l’unisson de la nature sauvage du Texas. Un long poème. Sauvage. Accomplissant le projet adornien d’une poésie qui ne peut plus être que barbare désormais dans ce monde, où seule la prose la plus mercantile a trouvé à s’établir. Un poème magnifique, fort, serein, accomplissant le sursaut de Paul Celan (lisez Todesfuge de Celan !), luttant de toutes ses forces contre la dépoétisation du monde. Un poème ahurissant, où l’ordure de la morale policière y est vrillée avec force. Dany au fond du puits, parce qu’il voulait se mêler de Justice ! Mais il n’y a pas de Justice : il y a la loi du plus fort qui est sa propre justification, et le forfait de l’ordre accompli, juste une orgie de gnôle qui vous attend à la maison, et foutre une branlée à la mère du petit, en faire une poupée de chiffon : un flic a tout pouvoir. Un long poème dans lequel s’épanche le Sheriff. Ne cachant rien de ses inactions, enfin, si, cherchant comment se soustraire, comme les nazis cachaient les leurs, en parfaite conscience de n’être qu’une crapule. Le bébé qu’il a gazé, la jeune mère qu’il a violée, les nègres qu’il a lattés, les femmes qu’il a lattées, les enfants qu’il a lattés. Tout est permis quand on est flic. Son long poème dégueulant le bréviaire des violences policières. Qu’il adresse à Dany, au fond de son puits. Assis sur les deux cadavres mexicains. Les Mex. Cent clandos Mex à King County, qu’il va bien falloir exterminer un jour. Tueurs de chiens de blancs. N’est-ce pas justice d’exterminer ceux qui tuent nos chiens ? Son long poème convoquant ses raisons, les esquintés de la famille après cette foutue guerre de Corée. Dany ? C’est ça qui l’a tué : ce con voulait perdre son innocence et se mêler de Justice ! Le gosse était même devenu dangereux, malgré les raclées, nuit et jour, le racisme, l’homophobie, le sexisme patiemment enseignés. De toute façon, ce n’était pas son enfant. Et puis, dans le bordel de la Création, il n’y a que les chiens à sauver. Et Mary. Sa Mary, tant qu’elle demeure sa chose. Attention : le Sheriff n’est pas un psychopathe. Juste un flic. On est trop exposé quand on est flic. Faut comprendre : toute cette puissance d’un coup entre les mains… Comment n’être pas tenté ? Et puis, à la longue, cette toute puissance, il faut que le monde la reconnaisse, l’éprouve. De toute façon, toute notre culture n’est plus qu’un tas d’ordure. Dont nous sauve cet immense poème !
King County Sheriff, Mitch Cullin, traduit de l’anglais (américain) par Yoko Lacour, éditions Barnum / Inculte, septembre 2018, 116 pages, 7.90 euros, ean : 9191095086864.