 Le livre des violences est tout à la fois un catalogue, une réflexion, un essai, un roman, un document journalistique, la mise en abîme de discours hétérogènes, une proto-encyclopédie, bref un texte. Tout ou presque, campant au milieu des genres, jouant de toutes les justifications, de toutes les mystifications, ré-articulant les genres pour mieux construire son objet.
Le livre des violences est tout à la fois un catalogue, une réflexion, un essai, un roman, un document journalistique, la mise en abîme de discours hétérogènes, une proto-encyclopédie, bref un texte. Tout ou presque, campant au milieu des genres, jouant de toutes les justifications, de toutes les mystifications, ré-articulant les genres pour mieux construire son objet.
Certes, les (pâles) tentatives de catégorisation des types de violences qui s’affrontent dans le monde, voire le préambule et l’introduction pseudo méthodologique sur la démarche "inductive", pourraient tromper. Mais à le lire comme un essai, on risque d’en perdre la vraie richesse. Car ce livre est plus et moins que cela.
Vollmann a parcouru le monde et le parcourt encore depuis des décennies, construisant toujours ce même rapport à ce monde qu’il ne cesse de questionner sur ses lieux les plus sensibles. On se rappelle son inquiétant Pourquoi êtes-vous pauvres ?, avec sa démarche si contestable. Et face à son Livre des violences, on se prend souvent à se demander quelle peut être la finalité d’un tel ouvrage. En somme, tout à fait ce genre de livre au statut incertain que dénonçait B.W. dans BW….
1. DES RAISONS DE NE PAS LE LIRE.
A maintes reprises, chaque articulation narrative de l’ouvrage paraît fléchir rapidement pour ressasser une position réductrice. Son introduction sur la mort par exemple, qui n’apprend rien qu’on sache, récapitulant un peu tout ce que l’on a dit déjà sur le sujet. Ou bien ses réflexions sur la violence justifiée : qu’apportent-t-elles à celles de Max Weber ? Voire à celles de Franz Fanon, ou Hans Mayer évoquant la violence vengeresse qui crée une égalité négative, une égalité de la souffrance, ou à Jean Améry dissertant sur les violences qui "humanisent", et bien d’autres encore, tel Malcom X, cruellement absent de l’ouvrage, ou l'étude : L’Homme enfanté par la violence (1971, Widersprücke, éd. Klett-Cotta), sans parler de toutes les analyses sur le sujet provenant du fonds des littératures de la décolonisation?…
On peut être aussi surpris par le style, "fleuri", de l’aveu de l’auteur (un mot, quel mot!, importé tout droit du vocabulaire non critique des plus mauvaises littératures du XIXème siècle). Style que l’auteur revendique et défend en outre en référence à l’intention affichée de gagner "l’adhésion" du lecteur… "L’adhésion" du lecteur !!! Là encore, ressortissant aux rouages des sous-littératures d’identification que dénonçaient déjà les auteurs du XIXème…
Vollmann ne brille pas par l’innovation stylistique, c’est le moins qu’on puisse dire, mais par ce qui est un peu la tarte à la crème du roman plus ou moins expérimental d’aujourd’hui : la composition. Car au fond, il n’est pas jusqu'au sens de son projet qui n’apparaissent candide, quand il en appelle à "l’espérance" comme lieu où rassembler notre lecture, sans se rendre compte qu’il emprunte ce concept au monde chrétien qui fait de l’espérance une vertu, et pas n’importe laquelle, permettez : une vertu théologale, c’est-à-dire une vertu à laquelle l’homme, sans le secours de Dieu, ne peut accéder…
Apprendre enfin que la violence fut de tout temps pour le rester de tous les temps ne nous avance pas à grand-chose, sinon à nous encourager à relire les belles études bibliques de Ricœur quand ce dernier, commentant le Décalogue et son commandement inquiétant-"tu ne tueras point"-, s’interroge sur cette proposition grammaticale qui d’emblée inscrit le meurtre comme déjà là, un donné inévitable de la condition humaine.
Que faire, en somme, d’un tel ouvrage ?
Publié qui plus est dans une version abrégée ce qui, comme le souligne la librairie L’établi, à Alfortville (94), dans un entretien exclusif et inédit publié dans son premier bulletin –LIVraison 1# – (offert à ses clients), ce qui donc n’est pas rien quand on prétend donner au lecteur le choix des situations dans lesquelles construire sa lecture. Version au demeurant fabriquée par suppression de chapitres entiers, formatant une bien curieuse compilation - à moins que l’on prétende que les 7 volumes américains sont largement redondants…
Que faire de ce livre ?
Que faire, quand c’est moins la question de la justification de la violence qui peut retenir, ni moins encore celle de savoir quand elle est justifiée dans l’Histoire et dans sa forme collective (il n’y a ici de réponse que dans l’Histoire) ? Qu’en faire lorsqu’on découvre l’auteur s’aventurer jusqu’au seuil inquiétant des violences dites d'"autodéfense" ?
Reste la personnalité de l’auteur courant les mondes glauques, sauvages, abrutis, non pour le sauver, mais le donner à lire.
Reste des pages superbement écrites, des descriptions du siège de Sarajevo par exemple, convoquant un plaisir inouï – pour un peu on en redemanderait, de grâce : un autre siège, d‘autres horreurs, guerres et massacres…
 2. DES RAISONS DE LE LIRE.
2. DES RAISONS DE LE LIRE.
Reste cette violence qui submerge tout,
le monde et l’ouvrage et la lecture qu’on en fait. Comme d’un geste de désespéré (Artaud) les mains haut levées au-dessus de la tête.
Reste la mise à plat roborative des catastrophes, des violences que Vollmann met à notre disposition en une somme indigeste dans laquelle creuser chacun ses propres questionnements.
Reste moins une encyclopédie que le naufrage d’un monde épars dont on relèverait les épaves, le témoignage d’une épouvante, celle de Vollmann ne parvenant pas à échapper à ses phobies, courant encore une fois les mondes glauques pour tenter d’y découvrir la forme de sa vie et ne rencontrant que ses contradictions auxquelles il ouvre la seule solution qui lui permette de tenir et dont il nous fait les témoins (...de sa folie, non de celle du monde) : sa solution poétique.
Et voir dans ce traitement "fleuri" qu’il y apporte l’artifice d’avoir créé une œuvre d’art remuante. Car Vollmann ne se fait pas l’historien des violences, il s’en fait l’artiste : la violence comme art poudréraire comme dirait Pierre Senges, qui nous serait dédiée, à nous, hommes de peu d’aplomb, intéressés à l’accélération de notre perte.
Et ce faisant rédige Une dramaturgie de la Violence.
Reste une démarche intellectuelle de prémices : construire un genre sans doxa. Où sans cesse se pose néanmoins la question de l’autorité du texte, évacuée sans l’être vraiment, jouant de toutes les ambiguïtés des genres : celui de l’essai par exemple et de ses postures langagières. Une démarche qui ouvre à cette interrogation : l’écriture, pour échapper au sens ou pour le recouvrir ? Pour le produire peut-être, Vollmann s’installant tout autant dans la revendication autotélique de la littérature (dont il ne faut pas oublier qu’elle accompagna la montée en puissance de la bourgeoisie), que dans son refus d’être coupée du monde.
Le silence rimbaldien et la fin de la lisibilité du monde, en sus. Où, depuis le XIXème siècle, la réalité est en quelque sorte devenue un cadavre dans le placard de la littérature. Ici, Vollmann exhiberait ce cadavre. Pour montrer aussi ce qu’il demeure de réalités dans les plis de la langue.
Mais rappelons-nous les revendications de la littérature expérimentale : ni catharsis, ni mimésis. Voici que Vollmann tout à la fois l’approuve et le refuse, construisant sa somme insensée. L’œuvre, dans ces conditions, comme expérience de quoi ? Une simulation ? Derrière les pages, plus de cosmos, à peine une sphère, un réel de fin de combines, ou bien le monde de chair et d’os ? Que nous montre Vollmann ? Les stigmates du monde pour rendre compte de son réel, car tout le reste serait épuisé ?
Reste donc l’intrigante identité littéraire de ce texte, et les filiations que lui reconnaît son éditeur français dans cet entretien inédit avec la Librairie l’établi : pour lui l’encyclopédie de Diderot et les Chants de Maldoror, pour moi seul ce dernier sans doute, superbe compilation des styles, des doutes, des terreurs d’une époque. –joël jégouzo--.
LE LIVRE DES VIOLENCES. QUELQUES PENSÉES SUR LA VIOLENCE, LA LIBERTÉ ET L'URGENCE DES MOYENS (RISING UP AND RISING DOWN), de William T. Vollmann, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Paul Mourlon, éd. Tristram, septembre 2009, 944 pages, 35 €, EAN : 9782907681773.
LIBRAIRIE L’établi, Du Mardi au Samedi 10h/19h30 - Dimanche 10h/13h
121, rue Paul Vaillant-Couturier 94140 Alfortville, tél. 01 49 77 79 14 - librairie-etabli@orange.fr
 Quelle nouvelle narration politique rendra réellement justice du sort réservé au grand nombre ? A moins que la misère du monde ne soit, aux yeux des élites politiques, qu’une différence discursive ouvrant la voie aux manipulations textuelles de tragédies dont personne n’a rien à faire.
Quelle nouvelle narration politique rendra réellement justice du sort réservé au grand nombre ? A moins que la misère du monde ne soit, aux yeux des élites politiques, qu’une différence discursive ouvrant la voie aux manipulations textuelles de tragédies dont personne n’a rien à faire.





 C’était à St Malo. Etonnants Voyageurs, toujours. La même année il me semble, Deniau dans une autre salle. En se retirant, la mer dévoilait un paysage morne, désabusé. A l’intérieur des remparts, journalistes et écrivains crapahutaient, se poursuivaient, les yeux rivés sur leur montre. Dégingandé, Jean Rollin promenait sa silhouette hauturière, lasse, amaigrie par un usage intempestif des champs de bataille.
C’était à St Malo. Etonnants Voyageurs, toujours. La même année il me semble, Deniau dans une autre salle. En se retirant, la mer dévoilait un paysage morne, désabusé. A l’intérieur des remparts, journalistes et écrivains crapahutaient, se poursuivaient, les yeux rivés sur leur montre. Dégingandé, Jean Rollin promenait sa silhouette hauturière, lasse, amaigrie par un usage intempestif des champs de bataille.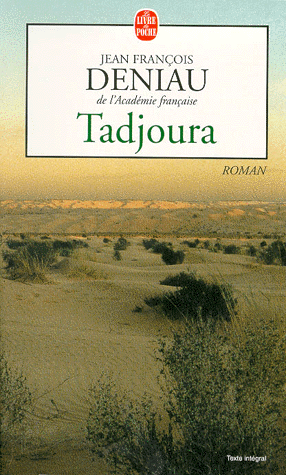
 Le retour des Cendres de Napoléon est l’occasion, pour deux officiers de son armée, de ressurgir du passé. L’un hante ses souvenirs de campagnes, l’autre les salons mondains. Moments obligeants qu’alimente leur correspondance, à travers laquelle le roman s’énonce. Celui-ci s’ouvre ainsi sur une lettre du Général Dewaeghe, narrant sa course vers un bois sombre à dos d’un Trakehner, cet incomparable cheval des hussards.
Le retour des Cendres de Napoléon est l’occasion, pour deux officiers de son armée, de ressurgir du passé. L’un hante ses souvenirs de campagnes, l’autre les salons mondains. Moments obligeants qu’alimente leur correspondance, à travers laquelle le roman s’énonce. Celui-ci s’ouvre ainsi sur une lettre du Général Dewaeghe, narrant sa course vers un bois sombre à dos d’un Trakehner, cet incomparable cheval des hussards.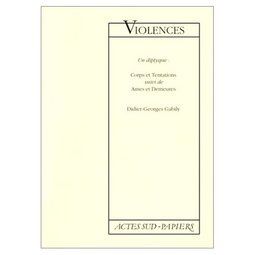

 Le livre des violences est tout à la fois un catalogue, une réflexion, un essai, un roman, un document journalistique, la mise en abîme de discours hétérogènes, une proto-encyclopédie, bref un texte. Tout ou presque, campant au milieu des genres, jouant de toutes les justifications, de toutes les mystifications, ré-articulant les genres pour mieux construire son objet.
Le livre des violences est tout à la fois un catalogue, une réflexion, un essai, un roman, un document journalistique, la mise en abîme de discours hétérogènes, une proto-encyclopédie, bref un texte. Tout ou presque, campant au milieu des genres, jouant de toutes les justifications, de toutes les mystifications, ré-articulant les genres pour mieux construire son objet.
 2. DES RAISONS DE LE LIRE.
2. DES RAISONS DE LE LIRE.