 "Essaie de vivre libre, toi, et tu verras le temps qu’il te reste pour dormir"…
"Essaie de vivre libre, toi, et tu verras le temps qu’il te reste pour dormir"…
S’il fallait n’en lire qu’un, lisez ce roman, autobiographique, de Goliarda. Mais qu’il serait dommage de l’enfermer dans le catalogue de l’invraisemblable rentrée littéraire 2012, tant il en déborde !
On connaissait de Goliarda L’art de la Joie, le Fil d’une vie. Voici enfin traduit ce texte qu’elle écrivit dans les dernières années de sa vie, tout à la gloire de l’enfance, ce rêve d’être, à tout jamais glorieux dans sa nudité même.
Militante presque par tradition familiale, caressant des idées anarchistes plus qu’elle ne l’avouait, rétive, née dans une famille éprouvée autant par l’adversité du fait de son engagement politique que par les maladies, Goliarda témoigne, sans commune mesure dans ce quartier invraisemblable de Catane, la Civita, de ce qu’il en coûte de vivre quand on ne veut pas renoncer à ses idéaux.
Fidèle à Pirandello, elle qui quitta tôt l’école pour courir les rues malfamées de la Civita et quelques années plus tard fonder une troupe de théâtre d’avant-garde, T45, elle qui joua pour Visconti (Medea, Senso), si elle vint à l’écriture en 1958, ce fut pour ne jamais connaître la notoriété –dont elle se souciait comme d’une guigne à vrai dire, non sans raison.
Io, Jean Gabin, c’est l’histoire de son enfance, d’une enfance prise dans les rets de l’Histoire, le Duce sur les talons et Gabin pour idéal, rebelle, traqué, à court d’amour mais crâne, pris au piège de la casbah d’Alger. Gabin qui lui apprend à aimer les femmes, à aimer les hommes, à aimer la Civita, à jamais immature mais droit dans ce livre écrit sous le règne de Thatcher et le triomphe de pacotille du libéralisme économique, qui lui fait se demander ce qui a bien pu s‘effondrer dans l’histoire des hommes pour qu’ils aient pareillement évacué de leur conscience toute exigence démocratique.
Un livre de traversée en somme, du battement fébrile d’une histoire en rupture, cercueil et berceau avec au loin la mer immense, la Méditerranée dressée aujourd’hui comme un mur entre les civilisations, avec sur l’autre rive justement, l’algérienne, Gabin rêvant un autre monde et courant à corps perdu se lover dans la casbah d’Alger. Goliarda sur les talons, aux prises avec le doute d’avoir voulu, si tôt, séjourner dans cet espace du beau déserté par la gente humaine. L’envie lui prend alors de défier les foules immenses, de bousculer ces brutes déguisées en êtres humains, déguisées en messieurs, démocrates de pacotille qui ne cessent de briser la Civita.
Io, Jean Gabin, c’est le fil d’un imaginaire rétif caracolant dans les ruelles d’un quartier que l’on nommerait de pittoresque aujourd’hui, mais que Goliarda somme de survivre au fil d’un récit éclatant et tendre, frappé de colère et d’amour, balançant entre le sublime et le banal dans l’exercice des langues de la rue. Goliarda courant les salles obscures, de Pépé le Moko au si attendu Quai des brumes, que des pages et des pages annoncent avant qu’enfin elle y soit affrontée, là, plongée dans l’obscurité d’une salle de quartier, extase pour soi seule, endiguée dans ces pages étranges où Goliarda relate le film pour n'en convier que l’atmosphère musicale, solennelle, ample et puis brutale, consommée bientôt dans le vacarme de la civitas, les hurlements des chiens et des coups de sifflets des policiers à la poursuite de Gabin, son beau visage calme manquant de sommeil et d’amour.
Io, Jean Gabin est un roman d’initiation, du temps qui presse, du désir qui monte, d’un corps qui se transforme, d’une fillette véhémente, navire en fête déjouant toutes les bourrasques pour déployer bien haut l’étendard d’une écriture qui a renoncé à se faire flamboyante, à se cajoler, affairée qu’elle est à dépecer le monde, à l’inciser pour scruter son épaisseur moite, suspecte, plus vivante que convaincue de l’être, tenue toujours loin même de toute nécessité d’écrire, festoyant le verbe plutôt que s’y complaisant, pour en faire celui de quelque Ulysse (de Joyce) déambulant dans le quartier de la Civita, inaliénable liberté dans cette Civita où tous volent, trafiquent, mendient et de balcon à balcon, profèrent leurs histoires la nuit pour la recouvrir entièrement, les yeux grand ouverts sur la vie.
Il faut lire ce seul ouvrage à l’écoute des gémissements de la Civita, ses monstres sculptés dans la pierre fasciste. On voudrait écrire comme elle le fait, dans la véhémence d’être présent enfin à soi, loin du prestige de la langue des hommes, et courir les rues sitôt sa lecture achevée, comme elle le fait au sortir de Quai des brumes, quittant la salle sous une pluie butée, quelques silhouettes désespérées enlacées au coin du cinéma de quartier, la ville au loin, très loin civitas embusquée dans son ironie obscène qui ne fera pourtant jamais changé Goliarda de cap. Il faut la lire, nommant, rêvant -(dormir, mourir, mourir, rêver peut-être… –Hamlet)-, étreignant les désespoirs utiles des exclus, rejoignant la belle figure du Gabin des Quais d’Alger pour descendre avec lui dans ces brumes où nos gestes prennent leur gîte.
Goliarda Sapienza, Moi, Jean Gabin, traduit de l’italien par Nathalie Castagné, éd. Attila, 30 août 2012, 176 pages, ean : 978-2-917084-30-2.
 "Bavasser" serait-il donc l’ultime langage de l’humanité ?
"Bavasser" serait-il donc l’ultime langage de l’humanité ? 


 "Après tout, les gens du voyage, c’est rien que des gens sans importance"...
"Après tout, les gens du voyage, c’est rien que des gens sans importance"...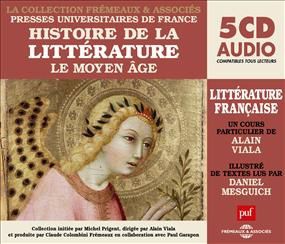 Un cours d’Alain Viala, passionnant, érudit, la Ballade des pendus pour ouvrir à cette superbe leçon de littérature, lue par Mesguich.
Un cours d’Alain Viala, passionnant, érudit, la Ballade des pendus pour ouvrir à cette superbe leçon de littérature, lue par Mesguich.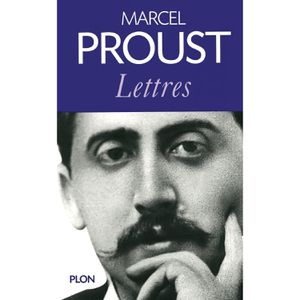 "Puisque le genre sublime ne me va pas, j’essaierai du bourgeois." (Proust à son grand-père, 1886).
"Puisque le genre sublime ne me va pas, j’essaierai du bourgeois." (Proust à son grand-père, 1886).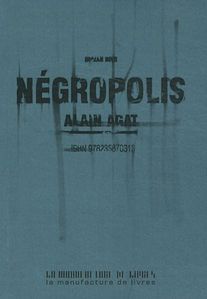 "Dans la cité, les jeunes connaissaient Malcom X mais pas Franz Fanon".
"Dans la cité, les jeunes connaissaient Malcom X mais pas Franz Fanon". "Essaie de vivre libre, toi, et tu verras le temps qu’il te reste pour dormir"…
"Essaie de vivre libre, toi, et tu verras le temps qu’il te reste pour dormir"… L’art n’est pas un savoir, bien qu’il ne se fasse pas sans raison. Il n’accomplit pas non plus de tâche ontologique, bien qu’il sache provoquer le surgissement de réalités nouvelles, et qu’il sache organiser le seul lieu peut-être, à partir duquel le réel nous fasse signe. Et si l’on peut raisonnablement admettre que la représentation esthétique met en résonance les facultés de l’imagination et celle de l’entendement, il faut maintenir que l’art est l’Autre de la Philosophie et qu’il ne saurait en conséquence être justiciable du seul discours philosophique, voire de tout autre discours spéculatif : il faut rejeter, absolument, l’illusion discursive qui consiste à croire que l’on peut réduire l’art aux catégories de l’entendement.
L’art n’est pas un savoir, bien qu’il ne se fasse pas sans raison. Il n’accomplit pas non plus de tâche ontologique, bien qu’il sache provoquer le surgissement de réalités nouvelles, et qu’il sache organiser le seul lieu peut-être, à partir duquel le réel nous fasse signe. Et si l’on peut raisonnablement admettre que la représentation esthétique met en résonance les facultés de l’imagination et celle de l’entendement, il faut maintenir que l’art est l’Autre de la Philosophie et qu’il ne saurait en conséquence être justiciable du seul discours philosophique, voire de tout autre discours spéculatif : il faut rejeter, absolument, l’illusion discursive qui consiste à croire que l’on peut réduire l’art aux catégories de l’entendement.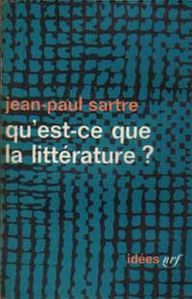 Sartre s’interroge en 1947. Mais c’est une interrogation de philosophe.
Sartre s’interroge en 1947. Mais c’est une interrogation de philosophe.