 Au fond, une petite histoire du peuple de Shanghai.
Au fond, une petite histoire du peuple de Shanghai.
Ou de cette fameuse Cité de la Poussière Rouge qui traversa les âges, résistant aux Empereurs, à la dictature du Prolétariat, à la Chine néo-capitaliste d’aujourd’hui.
De ces constructions dont on ne sait si elles sont le produit du peuple qui les habite ou le contraire, tant leur extravagante structure paraît douée d’une logique propre à organiser hardiment sa destinée. Un peuple hétéroclite quoi qu’il en soit, riche justement de la diversité qui le traverse, et le féconde, le recomposant dans une identité tout à la fois multiple et unique, unanimement tenace au final, opiniâtre et roué. De ces peuples qui ont su résister à tout en s’adaptant à tout.
Une petite histoire populaire raconté par l’écrivain chinois Qiu Xialong, lequel, à l’image de cette fantastique plasticité des habitants de la Cité, fut d’abord interdit d’école sous la Révolution Culturelle, avant de soutenir une thèse sur T.S. Eliot et partir aux Etats-Unis poursuivre ses recherches.
Une histoire éparpillée en nouvelles établies selon un ordre chronologique, de 49 à nos jours, organisant les moments clefs tout à la fois de la Cité et de l’Histoire chinoise du XXème siècle.
Et dès 49 l’on découvre la force d’inertie de cette Cité dont les nationalistes voulurent faire, avec Shanghai, une Stalingrad orientale. Le tournant qui allait les sauver, pensaient-ils. Mais rien ne put venir à bout de l’incrédulité des habitants de la cité et les nationalistes durent s’enfuirent, tandis que le narrateur passait à côté de l’Histoire, terré sous son lit, vaincu par une peur très ordinaire et non moins salutaire.
Mais de toutes les histoires que narre Qiu Xialong, la plus édifiante est peut-être celle de Bao, le poète ouvrier. Histoire construite en deux temps pour enjamber la Chine de Mao et trouver son dénouement dans celle d’aujourd’hui. Tout commença pour Bao en 1958, alors qu’on exhumait la vieille conférence prononcée par Mao en 42 sur la littérature et l’art, qu’il voulait mettre au service de la Révolution. Bao fut prié d’écrire des poèmes. Pas du tout familier de la chose, lui que l’on venait déjà d’arracher à sa cuisine pour l’envoyer secourir les forces vives de la nation dans les usines du Peuple, raconta au commissaire qui tentait de l’enrôler combien la réussite d’un plat de Tofu était chose malaisée. L’histoire plut. Bao fut sommé de composer son premier poème :
Telle fève de soja produit tel tofu
Telle eau donne telle couleur.
Tel savoir faire fabrique tel produit.
Telle classe parle telle langue.
Le poème fit le tour de la Chine et Bao devint membre de l’Association des écrivains chinois. Bien plus tard, en 1996, ayant traversé toutes les vicissitudes maoïstes, dénonçant quand il le fallait, s’auto-critiquant avec non moins d’opportunité, Bao fut encore sommé d’accepter un poste de chercheur à l’Université. Un poste qui, cependant, lui laissa le loisir de faire grandir ce genre de petite échoppe que la Chine nouvelle encourageait à développer (que cent fabriques s’épanouissent, quelque slogan post-communiste de cette sorte), dans laquelle il pouvait s’adonner à la seule passion qui ne l’avait jamais quitté : celle du Tofu. Si bien que dans cette Chine du capitalisme effréné, sa boutique put s’enorgueillir d’être l’une des rares à passer le cap du millénaire et produire un Tofu bien meilleur que le Tofu d’Etat.—joël jégouzo--.
Cité de la Poussière Rouge, de Qiu Xialong, traduit de l’anglais par Fanchita Gonzalez Batlle, Liana Levi – Piccolo, mars 2010, 222 pages, 9 euros, isbn : 978-2-86746-540-6.



 Aden, Tanger, les terminaux de nuit. La Tamise entre Gravesend et le bac Woolwich. Usines au bord de l’eau, la campagne alentour, rien, personne. Mais par cargos entiers, fruits et légumes, plastiques et prêt-à-porter, l’incessant convoi des marchandises rastaquouères régurgitées du bout du monde pour repaître nos insatiables fortunes. Un tanker parti de Rotterdam, gris acier, coupe l’horizon marin. Le monde dans ses cales et personne pour l’accueillir, sinon l’effarant balai des machines penchées comme de gros insectes au-dessus de lui. Le monde, loin. Ou à peine son ombre. Ici l’exil des zones portuaires, si retirées de tout qu’elles ont cessé d’exister. Aden, Tanger. Le monde déversé à nos portes. Zones portuaires, des lieux qui n’ont pas lieu, qui échappent à notre imaginaire. Juste dans la nuit quelques badauds maniaques pour témoigner de leur existence, photographes obsédés par les hélices des cargos. Grues à portique. A peine le grutier dans sa cabine. Minéraliers. Nous sommes déconnectés des bruits du monde, et c’est peut-être le mérite de ce livre –le seul- que de nous donner à penser le balai ahurissant des frets venus de Chine, d’Afrique, du Nord au Sud, échoués là devant nos portes. Tout une trame invisible, exclue de nos imaginaires, la marchandises mondialisée, dépossédée de tout sens, containers de livres, de plis, d’écrans éteints, sans plus aucun récit pour les dire, avant qu’ils réapparaissent sur nos étals, portés par l’illusion dont nous remplissons nos discours.
Aden, Tanger, les terminaux de nuit. La Tamise entre Gravesend et le bac Woolwich. Usines au bord de l’eau, la campagne alentour, rien, personne. Mais par cargos entiers, fruits et légumes, plastiques et prêt-à-porter, l’incessant convoi des marchandises rastaquouères régurgitées du bout du monde pour repaître nos insatiables fortunes. Un tanker parti de Rotterdam, gris acier, coupe l’horizon marin. Le monde dans ses cales et personne pour l’accueillir, sinon l’effarant balai des machines penchées comme de gros insectes au-dessus de lui. Le monde, loin. Ou à peine son ombre. Ici l’exil des zones portuaires, si retirées de tout qu’elles ont cessé d’exister. Aden, Tanger. Le monde déversé à nos portes. Zones portuaires, des lieux qui n’ont pas lieu, qui échappent à notre imaginaire. Juste dans la nuit quelques badauds maniaques pour témoigner de leur existence, photographes obsédés par les hélices des cargos. Grues à portique. A peine le grutier dans sa cabine. Minéraliers. Nous sommes déconnectés des bruits du monde, et c’est peut-être le mérite de ce livre –le seul- que de nous donner à penser le balai ahurissant des frets venus de Chine, d’Afrique, du Nord au Sud, échoués là devant nos portes. Tout une trame invisible, exclue de nos imaginaires, la marchandises mondialisée, dépossédée de tout sens, containers de livres, de plis, d’écrans éteints, sans plus aucun récit pour les dire, avant qu’ils réapparaissent sur nos étals, portés par l’illusion dont nous remplissons nos discours. Morgan Sportès écrivit Siam dans les hauts plateaux algériens.
Morgan Sportès écrivit Siam dans les hauts plateaux algériens.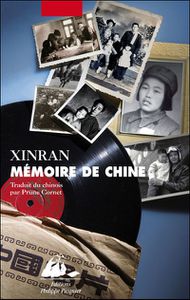 Mémoire de Chine. Mémoires plutôt, plurielles, fragiles. Mémoires enfouies, biffées, jamais révélées, risquées là pour tenter de recomposer l’imaginaire collectif d’une nation. Mémoires en forme d’hommage, superbe travail d’anamnèse, et d’identité, conduit par la journaliste Xinran autour de la génération de ses parents et de ses grands-parents, en forme de traversée du XXème.
Mémoire de Chine. Mémoires plutôt, plurielles, fragiles. Mémoires enfouies, biffées, jamais révélées, risquées là pour tenter de recomposer l’imaginaire collectif d’une nation. Mémoires en forme d’hommage, superbe travail d’anamnèse, et d’identité, conduit par la journaliste Xinran autour de la génération de ses parents et de ses grands-parents, en forme de traversée du XXème. Un été 48 à New York, devenue alors "la Capitale de Tout".
Un été 48 à New York, devenue alors "la Capitale de Tout". Jamais titre n’aura été plus approprié. Somerset Maugham, plus attaché aux conventions de sa classe que curieux des paysages qu’il découvre, n’a pas vu l’Asie, ou pas grand chose. C’est à peine s’il a jeté un œil maussade sur ces paysages souvent plombés par la chape grise du soleil des tropiques. Dès le premier chapitre, le ton est donné. Il s’émerveille de l’élégance du point-virgule, de la discrétion de la parenthèse et s’emporte contre le trop brouillon et fruste tiret. Certes, accordons-lui quelques notations vraiment biens senties sur des points essentiels de l’art de ponctuer un texte. Mais le voyage dans tout cela ? Refusant de tomber dans la facilité du pittoresque, Maugham ne veut consommer que des plaisirs intellectuels, autrement plus satisfaisants à ses yeux que les médiocres aventures dans lesquelles ces terres lointaines prétendent vous jeter. La jungle n’est enivrante qu’élever à la dignité du poème. Quant aux villes… Saigon lui rappelle une modeste bourgade française, Hanoï l’ennuie. Lorsqu’il débarque dans la baie de Tourane, proche de la capitale impériale de l’Annam (Hué), il n’en veut conserver qu’une impression fugace, celle d’un premier contact énonçant plus de promesses que la ville n’en saurait tenir. Haïphong lui paraît plus médiocre encore et il refuse tout net de se rendre dans la baie d'A-Long, lui préférant sa recension dans un numéro de l’Illustration, assis confortablement dans un bar huppé de Haïphong. Pour délaisser évidemment bien vite les pages consacrées au pittoresque de l’Asie du sud-est, et se pencher sur une aventure plus féconde : lire ses contemporains, "occidentaux" s’entend. Et là encore, tout n’est que prétexte à célébrer sa propre indolence désinvolte : Proust l’ennuie, mais à tout prendre, il préfère cet ennui à l’amusement que procurent les autres livres.
Jamais titre n’aura été plus approprié. Somerset Maugham, plus attaché aux conventions de sa classe que curieux des paysages qu’il découvre, n’a pas vu l’Asie, ou pas grand chose. C’est à peine s’il a jeté un œil maussade sur ces paysages souvent plombés par la chape grise du soleil des tropiques. Dès le premier chapitre, le ton est donné. Il s’émerveille de l’élégance du point-virgule, de la discrétion de la parenthèse et s’emporte contre le trop brouillon et fruste tiret. Certes, accordons-lui quelques notations vraiment biens senties sur des points essentiels de l’art de ponctuer un texte. Mais le voyage dans tout cela ? Refusant de tomber dans la facilité du pittoresque, Maugham ne veut consommer que des plaisirs intellectuels, autrement plus satisfaisants à ses yeux que les médiocres aventures dans lesquelles ces terres lointaines prétendent vous jeter. La jungle n’est enivrante qu’élever à la dignité du poème. Quant aux villes… Saigon lui rappelle une modeste bourgade française, Hanoï l’ennuie. Lorsqu’il débarque dans la baie de Tourane, proche de la capitale impériale de l’Annam (Hué), il n’en veut conserver qu’une impression fugace, celle d’un premier contact énonçant plus de promesses que la ville n’en saurait tenir. Haïphong lui paraît plus médiocre encore et il refuse tout net de se rendre dans la baie d'A-Long, lui préférant sa recension dans un numéro de l’Illustration, assis confortablement dans un bar huppé de Haïphong. Pour délaisser évidemment bien vite les pages consacrées au pittoresque de l’Asie du sud-est, et se pencher sur une aventure plus féconde : lire ses contemporains, "occidentaux" s’entend. Et là encore, tout n’est que prétexte à célébrer sa propre indolence désinvolte : Proust l’ennuie, mais à tout prendre, il préfère cet ennui à l’amusement que procurent les autres livres. La recherche, on le sait, doit se trouver de nouveaux modes de financements. Aussi, le responsable d’une association presque humanitaire (Understand Earth), et forcément nécessiteuse, décide-t-il de financer l’expédition de deux de ses plus mauvais scientifiques maisons d’une façon originale. Les russes ayant inauguré le tourisme orbital, rien n’interdit Understand Earth d’inventer le safari anthropologique.
La recherche, on le sait, doit se trouver de nouveaux modes de financements. Aussi, le responsable d’une association presque humanitaire (Understand Earth), et forcément nécessiteuse, décide-t-il de financer l’expédition de deux de ses plus mauvais scientifiques maisons d’une façon originale. Les russes ayant inauguré le tourisme orbital, rien n’interdit Understand Earth d’inventer le safari anthropologique. Le roman, mené tambour battant, est servi par une écriture d’une drôlerie peu commune. Mais il est aussi d’une pertinence achevée, le journal de l’anthropologue plombier s’avérant un modèle du genre. Il n’est pas un scientifique qui n’y reconnaisse ses travers, sinon ses méthodes. Une belle leçon de civilisation en outre !
Le roman, mené tambour battant, est servi par une écriture d’une drôlerie peu commune. Mais il est aussi d’une pertinence achevée, le journal de l’anthropologue plombier s’avérant un modèle du genre. Il n’est pas un scientifique qui n’y reconnaisse ses travers, sinon ses méthodes. Une belle leçon de civilisation en outre !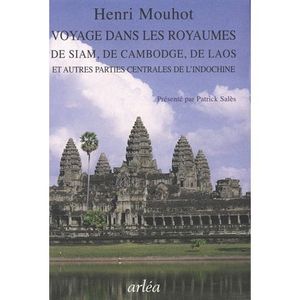 "Une envie d’Indochine sous le second Empire", sous-titre avec une très grande justesse cet ouvrage publié chez Arléa.
"Une envie d’Indochine sous le second Empire", sous-titre avec une très grande justesse cet ouvrage publié chez Arléa.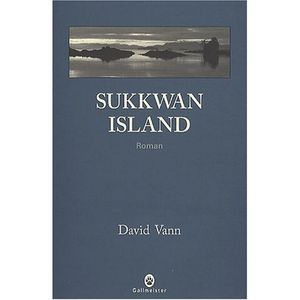 Roy, treize ans. Et son père.
Roy, treize ans. Et son père. Une critique unanime, unanimement dithyrambique. Mérité.
Une critique unanime, unanimement dithyrambique. Mérité.