
Le XXème siècle avait innové, en jouant de la faim comme d’une arme stratégique à l’échelle des populations, éparses ou ciblées dans le cas des crimes génocidaires. Mais le XXIème promet de faire mieux encore, cette fois à l’échelle de continents entiers : l’Afrique noire, avec d‘autant plus de facilité que la famine est sortie de nos cultures. A Dachau, Auschwitz, elle était méthodique, pensée au sommet de l’Etat. C’était un moyen d’administrer les populations, de contrôler leurs flux, de gérer les forces utilisables. La faim y apparaissait comme un instrument disciplinaire efficace. Aujourd’hui, cette gestion s’étend aux continents. 960 millions d’êtres humains meurent de faim actuellement dans le monde, un volume que nous ne connaissions plus depuis les années 60, 70… L’accaparement marchand des denrées agricoles fournit en fait d’inquiétantes similitudes avec le souci nazi des flux alimentaires. Le Grand Jeu géopolitique actuel, d’accaparement des terres agricoles en Afrique, par les Etats-Unis, la Chine, la France, pour y produire des «bio-carburants», détournant du cycle alimentaire des millions d’hectares d’où sont chassées en masse les populations qui les cultivaient et que nos productions intensives ne permettent même pas d’employer, ou bien, comme dans le cas de la Chine en 2008, la confiscation des stocks de riz, qui constitue la base alimentaire de la moitié de la population mondiale, aux seules fins de spéculation, provoquant artificiellement des famines ahurissantes, renvoie d’une façon nette à cette conception d’une gestion totalitaire de la production alimentaire mondiale.
L’étude d’Olivier Assouly fait froid dans le dos. Elle montre que l’explication naturaliste de la faim tient moins que jamais. Bien que le fatalisme en soit répandu, masquant commodément nos responsabilités politiques. La faim dans le monde n’est rien moins que l’expression d’une volonté économique abjecte, qui se traduit par l’asservissement éhonté de populations à une échelle jusqu’alors inconnue. Car la famine ne s’explique que rarement par le manque de nourriture. Les nazis l’avaient compris mieux que les autres, qui en firent un outil d’extermination et de contrôle des populations redoutablement efficace. En 1941, Himmler commanda une étude sur le sujet au Commissariat pour la consolidation de l’ethnie allemande. Un scénario fut réfléchi, pesé, argumenté, d’une politique alimentaire répressive à l’égard de la future Europe de l’Est. Le scénario prévoyait d’exterminer une partie de la population par la faim… Une partie seulement : exterminer la totalité de ces populations aurait été contreproductif. Il s’agissait pour le Reich de s’accaparer les terres agricoles de ces régions, pour le Reich et non l’économie locale. Le plan prévoyait de découper les espaces en aires de production agricole et en aires de famine. On imagina même de recomposer le maillage des villages et d’évaluer le nombre d’habitants admissibles pour chacun de ces villages en fonction de leur orientation productive, avec autour de ces villages des campements de main d’œuvre d’esclaves slaves… La modernité de ce plan était de conjuguer l’action répressive à la rationalisation économique. La Fonction Publique allemande tentait alors de penser l’administration des populations sur le très long terme, sur la base d’une planification alimentaire rigoureuse. Dans le rapport remis à Himmler, la famine était explicitement décrite comme un outil de sélection des races. On en vantait aussi la puissance d’asservissement inouïe. Olivier Assouly décrit par le menu cette pensée et celle de la bureaucratie allemande, tatillonne, rationnelle, évaluant scientifiquement la résistance à la faim et les effets de la privation sur la capacité de révolte ou de travail en fonction du nombre de calories administrées, autorisant en particulier de maintenir en survie une classe de «sous-hommes», que l’on pourrait ensuite retraiter au titre de déchets organiques. Il n’est pas jusqu’aux carcasses des déportées qui n’ait été évaluées sous leur angle marchand : les os et les cendres furent par exemple vendus à la société Strem pour recyclage en engrais, qui permirent à la production laitière de l’Allemagne nazie de se porter mieux. Entre 1943 et 1944, dans les archives de cette société on trouve trace de 100 tonnes d’ossements acquis à Auschwitz.

Aujourd’hui, l’usage criminel de la famine se passe de nouveau sur le terrain des races et de l’économie, en période de paix, au sein de l’économie de marché tellement vantée pour les bienfaits qu’elle nous apporte. Cette organisation criminelle de la faim répond à un plan, une administration, une idéologie, des responsables et des exécutants. La nouveauté, c’est l’imbrication des strates politiques, géopolitiques, culturelles, économiques, idéologiques et la totale opacité de nos responsabilités dans ce problème. Les motivations racistes (les noirs), tout comme les motivations sociales (les pauvres), sont tellement masquées que nul n’y voit rien à redire. Rien ne doit troubler l’ordre du marché, fût-il criminel, et même si, de fait, le monde cette fois est déjà découpé en aires de production agricole et en aires de famine.
L’organisation criminelle de la faim, Olivier Assouly, Actes Sud, coll. Essais sciences, 9 octobre 2013, 128 pages, 20 euros, ISBN-13: 978-2330024680.
 La voix de Dr House pour lire cette autobiographie d'un homme que la planète salue dans un curieux ensemble de louanges. A croire que nos chefs d'états se sont convertis à la raison des faibles épris de liberté et de justice... Mais à se demander tout de même s'ils l'ont seulement entendu, Mandela, évoquer les conditions de sa venue au politique : "Etre africain en Afrique du sud, s'interrogeait-il alors, signifiait qu'on était politisé à l'instant de sa naissance. Qu'on l'ait voulu ou non, qu'on l'ait su ou non". Parce qu'on naissait nègre dans des hospices de fortune, qu'on mangeait nègre, qu'on étudiait nègre, qu'on vivait nègre dans les quartiers férocement grillagés par les sbires de Pretoria. Combien, parmi ces chefs d'états, sensibles à pareille leçon d'histoire ? Il n'est que de transposer en France : non pas naître nègre mais roms, ou d'origine algérienne, jeté dans le marigot d'une France décidément réactionnaire. Certes, nous ne vivons pas le régime de l'apartheid. Mais les banlieues françaises sont tout de même des ghettos, dixit un rapport vite enterré du Sénat lui-même. Et les roms sont nos victimes. La voix de House donc pour nous raconter l'histoire d'un engagement qu'on voudrait aujourd'hui empailler. Moins la dérision de House. La voix du Mike de Breaking Bad pour nous rappeler ces lois abjectes qui circonscrivent et qui mutilent les enfants, les femmes, les hommes par millions, par milliards, victimes de l'organisation particulièrement ordurière du monde, soutenue par ces mêmes chefs d'états. Comment affronter une réalité pareille ? Une pareille hypocrisie ? Sans doute en ne participant pas à l'éloge thaumaturge. En refusant de construire cette posture du grand homme qu'on nous jette à la figure pour masquer l'outrage fait à la quasi totalité du genre humain. House donc, mais non pas cette fois à son spectacle, bien que l'écho y renvoit. Car il y a dans cette mise en scène quelque chose de salutaire. La notoriété de cette voix, son audience, ouvre comme un vide sur la scène imaginée. Mandela porté par la voix d'un anti-héros ! Odieux, intelligent, séduisant... Imaginez : l'humanité en souffrance traitée avec pareille désinvolture sous une puissante miséricorde à l'oeuvre... C'est un spectacle, certes, puisqu'un comédien interprète cette biographie de Mandela, mais comme mis en abîme et le choix de la voix de House se montre là très judicieux. Parce qu'il nous invite, dans le léger vacillement de nos raisons d'entendre Mandela, qui sont toutes, d'abord, de bien mauvaises raisons, à choisir de lever ou non l'ambiguïté du spectacle. Parce que la scène où se déroule ce spectacle est vide, comme elle l'était au moment où le jeune Mandela se posait la question d'entrer en politique. Une question qu'en fait il ne se posait pas, lui. Il n'y a rien dans ses mémoires sur ce sujet, aucun moment décisif, juste le souvenir de ces milliers d'offenses quotidiennes, de ces affronts, de ces humiliations qui jalonnent la vie des opprimés jour après jour. Juste l'accumulation d'une humiliation constante et Nelson se découvrant un jour engagé déjà sur le terrain de la lutte, à une époque où ces mêmes chefs d'états le considéraient comme un terroriste. Il y avait peu de choix possible à l'époque. Il n'y en a guère plus aujourd'hui pour nombre d'entre nous. Si : préférer le spectacle bon enfant et fossoyeur de l'enterrement solennel de Mandela. Feodor Atkine, par son interprétation, tourne le dos au spectacle. Mais il reste l'écho du Dr House dans cette voix, auquel s'accrocheront ceux qui préfèreront tourner le dos aux luttes libératrices pour applaudir des deux mains aux cérémonies hypocrites qui escamotent nos exigences.
La voix de Dr House pour lire cette autobiographie d'un homme que la planète salue dans un curieux ensemble de louanges. A croire que nos chefs d'états se sont convertis à la raison des faibles épris de liberté et de justice... Mais à se demander tout de même s'ils l'ont seulement entendu, Mandela, évoquer les conditions de sa venue au politique : "Etre africain en Afrique du sud, s'interrogeait-il alors, signifiait qu'on était politisé à l'instant de sa naissance. Qu'on l'ait voulu ou non, qu'on l'ait su ou non". Parce qu'on naissait nègre dans des hospices de fortune, qu'on mangeait nègre, qu'on étudiait nègre, qu'on vivait nègre dans les quartiers férocement grillagés par les sbires de Pretoria. Combien, parmi ces chefs d'états, sensibles à pareille leçon d'histoire ? Il n'est que de transposer en France : non pas naître nègre mais roms, ou d'origine algérienne, jeté dans le marigot d'une France décidément réactionnaire. Certes, nous ne vivons pas le régime de l'apartheid. Mais les banlieues françaises sont tout de même des ghettos, dixit un rapport vite enterré du Sénat lui-même. Et les roms sont nos victimes. La voix de House donc pour nous raconter l'histoire d'un engagement qu'on voudrait aujourd'hui empailler. Moins la dérision de House. La voix du Mike de Breaking Bad pour nous rappeler ces lois abjectes qui circonscrivent et qui mutilent les enfants, les femmes, les hommes par millions, par milliards, victimes de l'organisation particulièrement ordurière du monde, soutenue par ces mêmes chefs d'états. Comment affronter une réalité pareille ? Une pareille hypocrisie ? Sans doute en ne participant pas à l'éloge thaumaturge. En refusant de construire cette posture du grand homme qu'on nous jette à la figure pour masquer l'outrage fait à la quasi totalité du genre humain. House donc, mais non pas cette fois à son spectacle, bien que l'écho y renvoit. Car il y a dans cette mise en scène quelque chose de salutaire. La notoriété de cette voix, son audience, ouvre comme un vide sur la scène imaginée. Mandela porté par la voix d'un anti-héros ! Odieux, intelligent, séduisant... Imaginez : l'humanité en souffrance traitée avec pareille désinvolture sous une puissante miséricorde à l'oeuvre... C'est un spectacle, certes, puisqu'un comédien interprète cette biographie de Mandela, mais comme mis en abîme et le choix de la voix de House se montre là très judicieux. Parce qu'il nous invite, dans le léger vacillement de nos raisons d'entendre Mandela, qui sont toutes, d'abord, de bien mauvaises raisons, à choisir de lever ou non l'ambiguïté du spectacle. Parce que la scène où se déroule ce spectacle est vide, comme elle l'était au moment où le jeune Mandela se posait la question d'entrer en politique. Une question qu'en fait il ne se posait pas, lui. Il n'y a rien dans ses mémoires sur ce sujet, aucun moment décisif, juste le souvenir de ces milliers d'offenses quotidiennes, de ces affronts, de ces humiliations qui jalonnent la vie des opprimés jour après jour. Juste l'accumulation d'une humiliation constante et Nelson se découvrant un jour engagé déjà sur le terrain de la lutte, à une époque où ces mêmes chefs d'états le considéraient comme un terroriste. Il y avait peu de choix possible à l'époque. Il n'y en a guère plus aujourd'hui pour nombre d'entre nous. Si : préférer le spectacle bon enfant et fossoyeur de l'enterrement solennel de Mandela. Feodor Atkine, par son interprétation, tourne le dos au spectacle. Mais il reste l'écho du Dr House dans cette voix, auquel s'accrocheront ceux qui préfèreront tourner le dos aux luttes libératrices pour applaudir des deux mains aux cérémonies hypocrites qui escamotent nos exigences. 


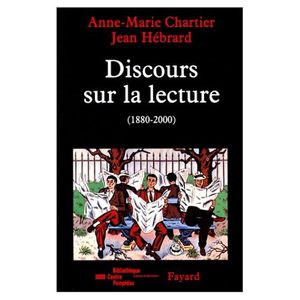 Dans le même temps où l’on créait en France, en 1959, un Ministère de la Culture, les élites intellectuelles et politiques s’inquiétaient de l’apparition d’une culture de masse...
Dans le même temps où l’on créait en France, en 1959, un Ministère de la Culture, les élites intellectuelles et politiques s’inquiétaient de l’apparition d’une culture de masse...


 On a voulu nous faire croire que les marchés financiers conditionnaient la régulation d’ensemble du capitalisme et qu’en conséquence, ils étaient favorables à la croissance économique. Alors qu’au fond, si l’on observe ce qu’il se passe vraiment, force est de constater qu’aujourd’hui,
On a voulu nous faire croire que les marchés financiers conditionnaient la régulation d’ensemble du capitalisme et qu’en conséquence, ils étaient favorables à la croissance économique. Alors qu’au fond, si l’on observe ce qu’il se passe vraiment, force est de constater qu’aujourd’hui, Au départ, on a un corps. Et puis il faut gagner autre chose : être ce corps, l’habiter, le découvrir, le connaître, l’aimer peut-être. L’exister. Dans sa chair, non dans ses signes. Dans cette chair ouverte à l’émotion, au risque de la voir déferler. Au début, un corps nous est donc donné. Inachevé. Il faut ensuite entrer en sa possession. En faire son corps. En nouer tous les morceaux. Le rassembler. Puis l’unifier. Pour ne rien céder au déterminisme biologique qui ferait de nous des viandes, fussent-elles lyriques. Il faut alors trouver la passion de l’animer. Lui donner vie, lui insuffler ce supplément sans lequel nous ne sommes rien. Et ce n’est pas facile, certes. Jamais gagné d’avance : longtemps, on est mal dans sa peau. Ce n’est pas une obligation, mais un fait sociologique. On est tout d’abord dans son corps comme dans la peau d’un autre. Celle d’un étranger. Dès l’enfance où le corps est immédiatement l’objet des attentes parentales. Il semble leur appartenir du reste, davantage qu’à l’enfant lui-même. Ils l’habillent, l’exhibent, le façonnent. C’est une structure, un genou qui saigne, une grippe qui l’enfièvre. L’auteure raconte ces signes qui rassurent les parents, la fabrique du genre, le bleu des garçons, le rose des filles. On est loin du corps pourtant, à travers ce façonnage des souvenirs, contraints par la forme romanesque à se déployer linéairement. C’est moins une histoire du corps au fond, qu’une histoire du Moi, ou de la conscience que l’on pourrait se faire de son propre corps comme objet sociétal… Tous les accessoires qui font corps sont égrenés sans surprise. Toute la panoplie des petits garçons, des petites filles. Toutes ces béquilles, ces étais que les parents installent jour après jour pour soutenir leur vision du monde. Mais on reste en surface des choses dans le roman, à peine à soulever l’écume d’un énoncé qui ne parvient pas à faire corps dans le récit. On reste dans la Lettre, loin du corps. Certes, il y a la justesse à penser, la question du genre par exemple. Toute l'entreprise éducative est longtemps exclusivement la question du genre. Le roman s’en empare à loisir, démonstrativement. Tout comme de l’apprentissage de la sexualité, ou de l’aventure d’aimer, passant en revue les phases, les codes, pour nous mener là où le roman veut nous mener : au romanesque d‘une trajectoire plus ou moins exemplaire. On n'y sent guère le désir fouailler. Sinon comme principe. Non cette affaire vrillée dans nos chairs. Tout est bien vu donc, intellectuellement. La découverte de la pudeur adolescente et la gêne qui s’installe dans l’espace intime de la famille, les changements de gravité du corps au cours des âges. Mais ce cours des âges plombe le récit, il me semble du moins, le rend factice, l’assujettit à sa seule entreprise romanesque où le physique va primer sur le corps, l’auteure n’étant jamais aussi prolixe que lorsqu’elle évoque ce physique qui ressortit au tempérament, ou au style : la mise en scène de soi, dans l’oubli du corps, du pathétique de la chair. Alors on suit comme ça le personnage central, qui vieillit, devient mère et réinstalle sa problématique dans la succession des filiations. Mais jamais l’épreuve d’être nu devant son objet d’écriture n’est advenue. Tout est terriblement fabriqué. Même les «mises à nu», l’aveu infime truqué, trop écrit. Quand il faudrait pouvoir se dénuder, se mettre à poil pour tout dire. Se mettre à poil devant autrui. Pas devant soi. Pas devant le miroir où le regard est toujours déjà trop habillé. Nu devant un autre. Non pas devant ce regard médical qui ramène le corps à sa machine. Ni devant le regard amoureux qui le revêt de ses parures sacramentelles. Peut-être pas même devant un regard désirant. A poil devant un autre, hésitant. Plutôt que de parler bourgeoisement du corps, dans l’apparat d’une conscience faite pour s'admirer, et subsumer le désir d'autrui sous le désir de soi…
Au départ, on a un corps. Et puis il faut gagner autre chose : être ce corps, l’habiter, le découvrir, le connaître, l’aimer peut-être. L’exister. Dans sa chair, non dans ses signes. Dans cette chair ouverte à l’émotion, au risque de la voir déferler. Au début, un corps nous est donc donné. Inachevé. Il faut ensuite entrer en sa possession. En faire son corps. En nouer tous les morceaux. Le rassembler. Puis l’unifier. Pour ne rien céder au déterminisme biologique qui ferait de nous des viandes, fussent-elles lyriques. Il faut alors trouver la passion de l’animer. Lui donner vie, lui insuffler ce supplément sans lequel nous ne sommes rien. Et ce n’est pas facile, certes. Jamais gagné d’avance : longtemps, on est mal dans sa peau. Ce n’est pas une obligation, mais un fait sociologique. On est tout d’abord dans son corps comme dans la peau d’un autre. Celle d’un étranger. Dès l’enfance où le corps est immédiatement l’objet des attentes parentales. Il semble leur appartenir du reste, davantage qu’à l’enfant lui-même. Ils l’habillent, l’exhibent, le façonnent. C’est une structure, un genou qui saigne, une grippe qui l’enfièvre. L’auteure raconte ces signes qui rassurent les parents, la fabrique du genre, le bleu des garçons, le rose des filles. On est loin du corps pourtant, à travers ce façonnage des souvenirs, contraints par la forme romanesque à se déployer linéairement. C’est moins une histoire du corps au fond, qu’une histoire du Moi, ou de la conscience que l’on pourrait se faire de son propre corps comme objet sociétal… Tous les accessoires qui font corps sont égrenés sans surprise. Toute la panoplie des petits garçons, des petites filles. Toutes ces béquilles, ces étais que les parents installent jour après jour pour soutenir leur vision du monde. Mais on reste en surface des choses dans le roman, à peine à soulever l’écume d’un énoncé qui ne parvient pas à faire corps dans le récit. On reste dans la Lettre, loin du corps. Certes, il y a la justesse à penser, la question du genre par exemple. Toute l'entreprise éducative est longtemps exclusivement la question du genre. Le roman s’en empare à loisir, démonstrativement. Tout comme de l’apprentissage de la sexualité, ou de l’aventure d’aimer, passant en revue les phases, les codes, pour nous mener là où le roman veut nous mener : au romanesque d‘une trajectoire plus ou moins exemplaire. On n'y sent guère le désir fouailler. Sinon comme principe. Non cette affaire vrillée dans nos chairs. Tout est bien vu donc, intellectuellement. La découverte de la pudeur adolescente et la gêne qui s’installe dans l’espace intime de la famille, les changements de gravité du corps au cours des âges. Mais ce cours des âges plombe le récit, il me semble du moins, le rend factice, l’assujettit à sa seule entreprise romanesque où le physique va primer sur le corps, l’auteure n’étant jamais aussi prolixe que lorsqu’elle évoque ce physique qui ressortit au tempérament, ou au style : la mise en scène de soi, dans l’oubli du corps, du pathétique de la chair. Alors on suit comme ça le personnage central, qui vieillit, devient mère et réinstalle sa problématique dans la succession des filiations. Mais jamais l’épreuve d’être nu devant son objet d’écriture n’est advenue. Tout est terriblement fabriqué. Même les «mises à nu», l’aveu infime truqué, trop écrit. Quand il faudrait pouvoir se dénuder, se mettre à poil pour tout dire. Se mettre à poil devant autrui. Pas devant soi. Pas devant le miroir où le regard est toujours déjà trop habillé. Nu devant un autre. Non pas devant ce regard médical qui ramène le corps à sa machine. Ni devant le regard amoureux qui le revêt de ses parures sacramentelles. Peut-être pas même devant un regard désirant. A poil devant un autre, hésitant. Plutôt que de parler bourgeoisement du corps, dans l’apparat d’une conscience faite pour s'admirer, et subsumer le désir d'autrui sous le désir de soi…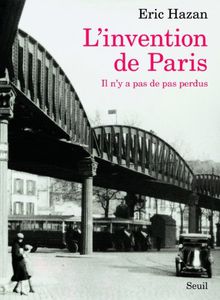 Une poétique de la ville qui s’ouvre sur le Paris de Balzac. Un parti pris déjà, d’une perspective critique. Celui d’une compréhension en profondeur de cette ville que l’auteur a tant habité semble-t-il, rue après rue, quartier après quartier, scrutant ses signes et les traces qui honorent encore cette ville que le lent épuisement contemporain voudrait tant congédier. Qu’est-ce qu’un quartier parisien aujourd’hui, en effet ? Dont on a chassé son âme la plus sensible, cette classe populaire qui avait élevé l’art d’habiter au rang de vivre et non de fréquenter. Eric Hazan évoque donc ce Paris turbulent, fiévreux, aux croissances irrégulières, soulevées en éruptions discontinues contre ses enceintes successives, de la muraille de Philippe Auguste au périphérique. Et ce n’est pas le moins troublant au demeurant que cette mise en perspective, qui donne à interroger la sourde volonté des pouvoirs publics au gré des siècles, d’enfermer Paris… Incroyablement documenté, cet homme a parcouru la ville en tous sens pour nous en livrer la chair la plus intime, celle du Paris Rouge, Paris défunt aujourd’hui, qui hier encore savait écrire les pages les plus glorieuses de notre Histoire. Il n’est que de nous rappeler l’immigration d’avant-guerre qui offrit tant de résistants dont Eric Hazan, de plaque en plaque commémorative, déploie le martyre. Des rues toutes simples, chargées d’une histoire vertueuse au contraire de ces avenues délétères, dont la plus célèbre, les Champs Elysées, ne s’illustra guère que pour constituer l’axe majeure de la collaboration ou celui de toutes les reprises en main réactionnaires des grandes avancées politiques… Qu’aurait été Paris sans cette vergogne ? Celui qu’Eric Hazan compulse justement : celui de la Commune, du Montmartre de Louise Michel et avant cela des barricades de 1830 révélant le vrai visage de la République Française : celui de la réaction, toujours. Quelle balade au final, dans ce Paris qui n’existe presque plus, où pour paraphraser Walter Benjamin affirmant que le « temps des opprimés est par nature discontinu », on n’en finirait pas d’espérer une autre fin que cette navrante gentrification de Paris.
Une poétique de la ville qui s’ouvre sur le Paris de Balzac. Un parti pris déjà, d’une perspective critique. Celui d’une compréhension en profondeur de cette ville que l’auteur a tant habité semble-t-il, rue après rue, quartier après quartier, scrutant ses signes et les traces qui honorent encore cette ville que le lent épuisement contemporain voudrait tant congédier. Qu’est-ce qu’un quartier parisien aujourd’hui, en effet ? Dont on a chassé son âme la plus sensible, cette classe populaire qui avait élevé l’art d’habiter au rang de vivre et non de fréquenter. Eric Hazan évoque donc ce Paris turbulent, fiévreux, aux croissances irrégulières, soulevées en éruptions discontinues contre ses enceintes successives, de la muraille de Philippe Auguste au périphérique. Et ce n’est pas le moins troublant au demeurant que cette mise en perspective, qui donne à interroger la sourde volonté des pouvoirs publics au gré des siècles, d’enfermer Paris… Incroyablement documenté, cet homme a parcouru la ville en tous sens pour nous en livrer la chair la plus intime, celle du Paris Rouge, Paris défunt aujourd’hui, qui hier encore savait écrire les pages les plus glorieuses de notre Histoire. Il n’est que de nous rappeler l’immigration d’avant-guerre qui offrit tant de résistants dont Eric Hazan, de plaque en plaque commémorative, déploie le martyre. Des rues toutes simples, chargées d’une histoire vertueuse au contraire de ces avenues délétères, dont la plus célèbre, les Champs Elysées, ne s’illustra guère que pour constituer l’axe majeure de la collaboration ou celui de toutes les reprises en main réactionnaires des grandes avancées politiques… Qu’aurait été Paris sans cette vergogne ? Celui qu’Eric Hazan compulse justement : celui de la Commune, du Montmartre de Louise Michel et avant cela des barricades de 1830 révélant le vrai visage de la République Française : celui de la réaction, toujours. Quelle balade au final, dans ce Paris qui n’existe presque plus, où pour paraphraser Walter Benjamin affirmant que le « temps des opprimés est par nature discontinu », on n’en finirait pas d’espérer une autre fin que cette navrante gentrification de Paris. Inventé en 1874, et bien qu'expression malingre du génie mécanique, le barbelé a conservé jusqu’à aujourd’hui sa redoutable efficacité pour délimiter les espaces.
Inventé en 1874, et bien qu'expression malingre du génie mécanique, le barbelé a conservé jusqu’à aujourd’hui sa redoutable efficacité pour délimiter les espaces.
