 Un livre tout entier consacré aux fameuses journées de juin 1780, à Londres, à une époque où ce genre d’émeute était hebdomadaire. Il est vrai que dans ce XVIIIème siècle britannique, l'insurrection était alors la forme habituelle et périodique de la protestation sociale, dans un pays où le débat social était mené comme une guerre –on sait en France, aujourd’hui encore, ce que cela veut dire…
Un livre tout entier consacré aux fameuses journées de juin 1780, à Londres, à une époque où ce genre d’émeute était hebdomadaire. Il est vrai que dans ce XVIIIème siècle britannique, l'insurrection était alors la forme habituelle et périodique de la protestation sociale, dans un pays où le débat social était mené comme une guerre –on sait en France, aujourd’hui encore, ce que cela veut dire…
Mais des émeutes festives, troublantes justement par ce caractère de liesse désordonnée, déroutant les analyses politiques et les hommes de Pouvoir tant leurs visées ne pouvait se comprendre dans le cadre des discours habituels (aujourd’hui encore). Emeutes joyeuses, "émotions populaires" comme on le disait alors non sans mépris dans les classes supérieures, provoquées par le ressentiment général d’un Peuple quotidiennement humilié, asphyxié, biffé des tablettes de l’Histoire. Emeutes farouchement arrosées de gin et tournant au délire collectif, à la débauche bachique, Sa Majesté la Foule soudain prise d’une folle envie de cuite mémorable, quand bien même elle se terminerait par une douloureuse gueule de bois -mitraille, prisons et lois iniques au réveil.
Des Emeutes séminales dans l’histoire qui s’ouvre alors en Europe et pour le monde, parce que cette première insurrection prolétarienne de l’ère industrielle fut pour les ouvriers l’occasion de la révélation fulgurante de leur être-ensemble : ils découvrirent en effet soudain qu’ils formaient la force centrale de la société urbaine naissante et en faisant front, ils révélèrent à toute l’Europe qu’ils pouvaient devenir une classe sociale non seulement moteur de l’Histoire, mais capable d’abattre des bastilles.
C’est cette histoire, dans la plus grande ville du monde d’alors, que décrit le présent essai. Heure par heure, une poignée de journées exceptionnellement documentées, fascinantes à bien des égards pour quiconque veut construire une réflexion de classe, mais surtout, au regard de leur caractère anarchique, pour quiconque veut comprendre le sens profond du soulèvement populaire.
Les Conservateurs sont au pouvoir, ruinés par leurs coûteuses guerres. Ils se préparent à voter des lois iniques bien sûr, car il leur faut de l’argent, et beaucoup, pour mener à terme leur politique dispendieuse. Accessoirement, ils ont besoin de troupes fraîches, qu’il pensent puiser cette fois dans les milieux catholiques. Aussi s’emploient-ils à monter les religions les unes contre les autres pour mieux diviser un Peuple déjà exsangue, sur des clivages ouvertement xénophobes –voilà qui nous rappelle quelque chose.
 Des foules dépenaillées parcourent la ville en tous sens, s’agrègent aux manifestations organisées sans trop savoir pourquoi. Pétitionnaires et peuples des ruelles confondus, "nègres" rescapés de l’esclavage antillais (7% de la population londonienne !). Des leaders tentent de structurer cette agitation qui leur échappe, part dans tous les sens, en conduisant la foule du matin, énorme, devant le Parlement. La Représentation Nationale se voit soudain sommée d’agir. Elle est encerclée, isolée, bousculée. On attend des élus des réponses, ils discourent et tergiversent comme à l’accoutumée, ou dénoncent la manipulation d’une foule "visiblement" peu politisée, enrôlée contre son gré dans une lutte dont elle comprend mal la finalité. Que veulent au juste ces loqueteux ? Rien, précisément. Rien, politiquement s’entend, ou plutôt non, ils veulent tout : abattre le Pouvoir et peut-être même, "Tout Pouvoir"…
Des foules dépenaillées parcourent la ville en tous sens, s’agrègent aux manifestations organisées sans trop savoir pourquoi. Pétitionnaires et peuples des ruelles confondus, "nègres" rescapés de l’esclavage antillais (7% de la population londonienne !). Des leaders tentent de structurer cette agitation qui leur échappe, part dans tous les sens, en conduisant la foule du matin, énorme, devant le Parlement. La Représentation Nationale se voit soudain sommée d’agir. Elle est encerclée, isolée, bousculée. On attend des élus des réponses, ils discourent et tergiversent comme à l’accoutumée, ou dénoncent la manipulation d’une foule "visiblement" peu politisée, enrôlée contre son gré dans une lutte dont elle comprend mal la finalité. Que veulent au juste ces loqueteux ? Rien, précisément. Rien, politiquement s’entend, ou plutôt non, ils veulent tout : abattre le Pouvoir et peut-être même, "Tout Pouvoir"…
L’incongruité bouffonne de la situation saute bientôt aux yeux de tous : une partie de la foule se disperse tandis qu’une autre prend en otage les parlementaires. La nuit, les insoumis s’arment de gourdins, de hachoirs, s’enivrent. Des gueux avinés affluent sans cesse, qui veulent simplement voir flamber les bagnes et semblent ne désirer qu’une chose : la fin de ce vieux monde corrompu.
Ils envahissent la ville, courent dans tous les sens, s’éparpillent. Impossible de centraliser l’action : la foule ne veut pas prendre le Pouvoir, elle veut l’abattre.
Les gueux se rassemblent, s’égaient littéralement dans Londres, pactisent avec les forces de police dont nombre d’entre elles rallient les bombances improvisées ici et là. Les émeutiers brûlent des bâtiments, pillent les magasins de luxe, mais dans un incroyable climat bon enfant ! Peu d’échauffourées, peu de blessés, ils ne montent aucune barricade qui viserait à fixer un front, ne s’enferment pas en ghettos dans leurs quartiers mais déferlent tout simplement, partout à la fois, au pas de course plutôt qu’ils ne défilent sous un rassemblement unitaire dont l’objectif politico-symbolique aurait été mûrement réfléchi. Et c’est bien la force de ce mouvement que cette dispersion, cette foule sans stratégie qui ne livre aucune bataille, va et vient sans que l’on puisse la circonvenir dans la ville : elle gagne.
Certes, dans les jours qui suivirent, sept mille soldats en armes venus de l’extérieur de Londres furent envoyés pour maîtriser la situation. Ils plongèrent alors la ville dans un bain de sang, mirent le feu à Londres, instaurèrent le carnage généralisé. L’essentiel n’est pas là. Il est dans l’analyse que l’on peut faire de l’essence même de ce mouvement, moral s’il en est, attaché à défendre une seule valeur, celle de la vie humaine.
Un soulèvement populaire n’a pour objet que de faire tomber un Pouvoir, pas d’en relever un autre. Construire le Pouvoir n’est pas l’objet des émeutes populaires, qui sont en réalité de grandes protestations morales.
C’est en cela que les minorités sont morales, en cela que le désordre est moral, en cela que l’éthique se révèle un puissant levier d’action révolutionnaire.
Les soulèvements populaires sont une formidable machine à abattre les bastilles. Des machines non politiques qui pointent l’essentiel de ce qui fonde l’homme dans son humanité : sa dignité pour l’autre.
Prenant conscience de soi, Sa Majesté La Foule soustrait l'individu à lui-même et l’entraîne dans le cercle d’une vie supérieure. Balayant l’utile elle pointe le Juste. L’ambition morale de ces mouvements n’est ainsi pas de changer l’homme mais de changer la vie sociale, en y réintroduisant le devoir de justice. Et c’est au nom d’une philosophie de l’Homme, larvée, à peine murmurée, que l’émeute s’élance et énonce la seule norme qu’un Etat doive tenir, qui est celle de l’égal respect des personnes. Traiter l’individu comme fin, non comme moyen. Distinguer nos droits de citoyens des conceptions de la Vie Bonne qui se font jour ici et là, entendu que nul ne peut définir à la place d’autrui ce que doit être sa Vie Bonne.
La finalité des mouvements populaires est de fixer une limite morale au gouvernement en place. De lui rappeler par exemple sa nécessaire neutralité devant les fins, de lui rappeler que la norme d’égal respect des personnes, seule, fonde la légitimité de son action Publique. Entendu ainsi, cela signifie par exemple que l’Autre doit être perçu comme un autre sujet ayant sa propre perspective qu’il faut respecter. C’est en cela que les mouvements populaires nous donnent le sentiment de redonner des couleurs aux nations qui les portent : ils ré-humanisent la société, parce qu’ils l’inscrivent dans une visée éthique de Justice et de Dignité de l’Homme pour l’Homme.
Beau comme une prison qui brûle, de Julius Van Daal, éd. L’Insomniaque, avril 2010, 94 pages, 7 euros, ean : 978-2-915-694451.
www.insomniaque.org




 Les allégations concernant Jean Moulin, celles de Thierry Wolton, avaient jeté sur le héros de la Résistance une lumière plus glauque que convaincante. Les contributions proposées par J.-P. Azéma en apportent le plus savant démenti. Toutefois, elles ouvrent un champ d'interrogations auxquelles elles répondent mal. Pour exemple, cette explication de la spectaculaire conversion au gaullisme d'un républicain de gauche par le coup de foudre qu'il aurait éprouvé pour le Général, paraît médiocre. D'autant qu'on ne saura jamais rien de cette année de réflexion qu'il s'accorda, de 1940 à 1941, quand il se proposait d'émigrer aux Etats-Unis, juste avant de rallier Londres. Impossible également de reconstruire sa première période londonienne. Il arrive auprès du Général De Gaulle comme mandataire auto-proclamé, mais repart comme son envoyé légitime. Fabuleux organisateur, il passera une grande partie de son temps en rivalités personnelles. Affrontements avec Christian Pineau, Pierre Brossolette, Henri Frenay... Jusqu'à son arrestation à Caluire, au moment où les luttes d'intérêts font rage dans la Résistance.
Les allégations concernant Jean Moulin, celles de Thierry Wolton, avaient jeté sur le héros de la Résistance une lumière plus glauque que convaincante. Les contributions proposées par J.-P. Azéma en apportent le plus savant démenti. Toutefois, elles ouvrent un champ d'interrogations auxquelles elles répondent mal. Pour exemple, cette explication de la spectaculaire conversion au gaullisme d'un républicain de gauche par le coup de foudre qu'il aurait éprouvé pour le Général, paraît médiocre. D'autant qu'on ne saura jamais rien de cette année de réflexion qu'il s'accorda, de 1940 à 1941, quand il se proposait d'émigrer aux Etats-Unis, juste avant de rallier Londres. Impossible également de reconstruire sa première période londonienne. Il arrive auprès du Général De Gaulle comme mandataire auto-proclamé, mais repart comme son envoyé légitime. Fabuleux organisateur, il passera une grande partie de son temps en rivalités personnelles. Affrontements avec Christian Pineau, Pierre Brossolette, Henri Frenay... Jusqu'à son arrestation à Caluire, au moment où les luttes d'intérêts font rage dans la Résistance.

 Cet événement, expliquait-il tout d’abord, dans sa réalité, était proprement invivable. Des milliers d’hommes jetés sur une plage. Le fracas de la mitraille, les éclats d’obus, les tirs incessants, le bruit, le feu, le souffre, le sable, la mer, jetés l’un contre l’autre, les barges qui ne cessaient d’affluer, les hommes qui ne cessaient de tomber, courir quelques mètres et tomber, le prochain un mètre de mieux que le précédent et tomber toujours, la plage jonchée de corps, de cadavres, de cris, de souffrance, de peur. Utah, Ohama, Gold, Juno, Sword. A Ohama, les américains qui descendaient des barges ne purent disposer du soutien des chars amphibies. La houle était trop forte, les duplex drive ne pouvaient y résister. De fait, sur les 29 chars mis à l’eau, 3 seulement purent gagner la rive… Les autres coulèrent dans la Manche. Sur la plage, les 270 sapeurs qui devaient ouvrir en moins de 30 minutes la quinzaine de passages pour permettre aux véhicules de traverser les 500 mètres qui séparaient la mer des positions allemandes, œuvraient sous le feu incessant de l’ennemi, à découvert, si bien qu’en moins de 25 minutes, 250 étaient morts déjà. Un seul passage fut ouvert. Samuel Füller débarque. Le feu le cloue aussitôt à terre. Tous sont déjà morts autour de lui. Une seconde vague est déversée sur la plage. Hébété, il ne comprend rien, ne voit rien, ne peut ni respirer ni bouger. L’expérience qu’il vit, rien ne l’y a préparé. Peut-être, si, celle des soldats engagés dans les tranchées de 14-18. Mais il ne la connaît pas. Tout n’est pour lui, comme cela l’était déjà pour eux, que cris, gémissements, ordres incompréhensibles, fracas des armes, jurons, râles. Certains se redressent après avoir repris leur souffle, font quelques mètres et tombent. L’espace s’est effondré. Le temps s’est arrêté. Son être semble faire organiquement corps avec la plage. Il n’y a pas d’issue. Le sable et le sang giclent de toute part. Partir. Fuir. Sortir. Rien n’est possible. La terre, déjà éventrée, s’évide encore. Pas le moindre petit bout de savoir pour s’arracher à ce cauchemar. Pas le moindre récit pour donner la mesure de ce qu’il vit. La solitude effarante de l’esprit répond à celle du corps, terré dans sa propre ignorance. Tout n’est alors qu’un immense chaos où l’être déversé ne parvient pas à se saisir, où le flux héraclitéen des événements interdit non seulement toute compréhension de la chose, mais toute connaissance de soi, voire toute sensation de ce moi charrié sans ménagement dans le désordre de la matière nue. C’est cela que raconte Samuel Füller. Qui ne sait plus comment il est sorti de sa terreur, de son trou, l’arme à la main et a survécu. Il ne lui reste pour souvenir que l’hébétude, longtemps après que le dernier coup de feu a été tiré.
Cet événement, expliquait-il tout d’abord, dans sa réalité, était proprement invivable. Des milliers d’hommes jetés sur une plage. Le fracas de la mitraille, les éclats d’obus, les tirs incessants, le bruit, le feu, le souffre, le sable, la mer, jetés l’un contre l’autre, les barges qui ne cessaient d’affluer, les hommes qui ne cessaient de tomber, courir quelques mètres et tomber, le prochain un mètre de mieux que le précédent et tomber toujours, la plage jonchée de corps, de cadavres, de cris, de souffrance, de peur. Utah, Ohama, Gold, Juno, Sword. A Ohama, les américains qui descendaient des barges ne purent disposer du soutien des chars amphibies. La houle était trop forte, les duplex drive ne pouvaient y résister. De fait, sur les 29 chars mis à l’eau, 3 seulement purent gagner la rive… Les autres coulèrent dans la Manche. Sur la plage, les 270 sapeurs qui devaient ouvrir en moins de 30 minutes la quinzaine de passages pour permettre aux véhicules de traverser les 500 mètres qui séparaient la mer des positions allemandes, œuvraient sous le feu incessant de l’ennemi, à découvert, si bien qu’en moins de 25 minutes, 250 étaient morts déjà. Un seul passage fut ouvert. Samuel Füller débarque. Le feu le cloue aussitôt à terre. Tous sont déjà morts autour de lui. Une seconde vague est déversée sur la plage. Hébété, il ne comprend rien, ne voit rien, ne peut ni respirer ni bouger. L’expérience qu’il vit, rien ne l’y a préparé. Peut-être, si, celle des soldats engagés dans les tranchées de 14-18. Mais il ne la connaît pas. Tout n’est pour lui, comme cela l’était déjà pour eux, que cris, gémissements, ordres incompréhensibles, fracas des armes, jurons, râles. Certains se redressent après avoir repris leur souffle, font quelques mètres et tombent. L’espace s’est effondré. Le temps s’est arrêté. Son être semble faire organiquement corps avec la plage. Il n’y a pas d’issue. Le sable et le sang giclent de toute part. Partir. Fuir. Sortir. Rien n’est possible. La terre, déjà éventrée, s’évide encore. Pas le moindre petit bout de savoir pour s’arracher à ce cauchemar. Pas le moindre récit pour donner la mesure de ce qu’il vit. La solitude effarante de l’esprit répond à celle du corps, terré dans sa propre ignorance. Tout n’est alors qu’un immense chaos où l’être déversé ne parvient pas à se saisir, où le flux héraclitéen des événements interdit non seulement toute compréhension de la chose, mais toute connaissance de soi, voire toute sensation de ce moi charrié sans ménagement dans le désordre de la matière nue. C’est cela que raconte Samuel Füller. Qui ne sait plus comment il est sorti de sa terreur, de son trou, l’arme à la main et a survécu. Il ne lui reste pour souvenir que l’hébétude, longtemps après que le dernier coup de feu a été tiré. Autour de lui, quatre silhouettes. Leur uniforme. Américain. Ils se regardent et se taisent, incapables du moindre mot. Longtemps comme ça, dit-il. Sans savoir combien de temps exactement. Une heure, deux heures. Les survivants. Une poignée. Et puis les premiers mots. Lesquels, il n’en sait rien. Rien ne concernant ce qu’ils venaient de vivre en tout cas : la réalité était inassimilable. Elle n’était que confusion, non-visibilité absolue du sens des actions, la clôture de l’expérience sur un présent sans fin.
Autour de lui, quatre silhouettes. Leur uniforme. Américain. Ils se regardent et se taisent, incapables du moindre mot. Longtemps comme ça, dit-il. Sans savoir combien de temps exactement. Une heure, deux heures. Les survivants. Une poignée. Et puis les premiers mots. Lesquels, il n’en sait rien. Rien ne concernant ce qu’ils venaient de vivre en tout cas : la réalité était inassimilable. Elle n’était que confusion, non-visibilité absolue du sens des actions, la clôture de l’expérience sur un présent sans fin. Ensuite, sont venus d’autres temps. Les survivants ont d’abord élaboré ensemble, avec peine, improvisant, explorant, hasardant une bribe, un récit, plusieurs, mille esquisses se chevauchant, se contredisant, pour arriver un jour à une solution satisfaisante qu’ils partagèrent sans même s’en rendre compte, parfois dans les mêmes mots, les mêmes expressions véhiculant à la longue comme un modèle du genre récit de débarquement. Puis vint, beaucoup plus tard, le temps de leur récit relayé par des voix étrangères à l’événement, faisant subir à leur récit un nouveau glissement, vers un modèle assumant cette fois une fonction plus idéologique que psychologique. Mais un récit qui faisait retour dans le leur, le transformait, l’augmentait et le diminuait tout à la fois, forçant leur propre mémoire, la pliant devant des usages qui n’étaient pas les leurs tout d’abord, mais avec lesquels ils finirent par se familiariser. Le roman, le cinéma vinrent donner forme à tout cela. Une mémoire collective du débarquement se mit en place. Qui transformait, codifiait, esthétisait l’événement si loin déjà. Un événement dont la violence finit par devenir acceptable. On put de nouveau l’assumer. Elle circulait dans de nouveaux espaces, se chargeait de sens, en appelant déjà au retour de la violence réelle, comme dans un mouvement de balancier, s’étant enfin rendu souhaitable de nouveau, si l’on voulait bien en disposer encore. C’est cela que racontait Samuel Füller.
Ensuite, sont venus d’autres temps. Les survivants ont d’abord élaboré ensemble, avec peine, improvisant, explorant, hasardant une bribe, un récit, plusieurs, mille esquisses se chevauchant, se contredisant, pour arriver un jour à une solution satisfaisante qu’ils partagèrent sans même s’en rendre compte, parfois dans les mêmes mots, les mêmes expressions véhiculant à la longue comme un modèle du genre récit de débarquement. Puis vint, beaucoup plus tard, le temps de leur récit relayé par des voix étrangères à l’événement, faisant subir à leur récit un nouveau glissement, vers un modèle assumant cette fois une fonction plus idéologique que psychologique. Mais un récit qui faisait retour dans le leur, le transformait, l’augmentait et le diminuait tout à la fois, forçant leur propre mémoire, la pliant devant des usages qui n’étaient pas les leurs tout d’abord, mais avec lesquels ils finirent par se familiariser. Le roman, le cinéma vinrent donner forme à tout cela. Une mémoire collective du débarquement se mit en place. Qui transformait, codifiait, esthétisait l’événement si loin déjà. Un événement dont la violence finit par devenir acceptable. On put de nouveau l’assumer. Elle circulait dans de nouveaux espaces, se chargeait de sens, en appelant déjà au retour de la violence réelle, comme dans un mouvement de balancier, s’étant enfin rendu souhaitable de nouveau, si l’on voulait bien en disposer encore. C’est cela que racontait Samuel Füller.
 Les médias exercent un effet de filtre sur les thèmes moraux qui parcourent la société civile, les laissant s’épanouir ou les étouffant pour renforcer la puissance publique aux dépens de la société civile, comme il en va en France. Car les grands médias français ne comprennent qu’une dimension du politique : celle selon laquelle c’est dans l’Etat qu’il se concentre.
Les médias exercent un effet de filtre sur les thèmes moraux qui parcourent la société civile, les laissant s’épanouir ou les étouffant pour renforcer la puissance publique aux dépens de la société civile, comme il en va en France. Car les grands médias français ne comprennent qu’une dimension du politique : celle selon laquelle c’est dans l’Etat qu’il se concentre. Un livre tout entier consacré aux fameuses journées de juin 1780, à Londres, à une époque où ce genre d’émeute était hebdomadaire. Il est vrai que dans ce XVIIIème siècle britannique, l'insurrection était alors la forme habituelle et périodique de la protestation sociale, dans un pays où le débat social était mené comme une guerre –on sait en France, aujourd’hui encore, ce que cela veut dire…
Un livre tout entier consacré aux fameuses journées de juin 1780, à Londres, à une époque où ce genre d’émeute était hebdomadaire. Il est vrai que dans ce XVIIIème siècle britannique, l'insurrection était alors la forme habituelle et périodique de la protestation sociale, dans un pays où le débat social était mené comme une guerre –on sait en France, aujourd’hui encore, ce que cela veut dire… Des foules dépenaillées parcourent la ville en tous sens, s’agrègent aux manifestations organisées sans trop savoir pourquoi. Pétitionnaires et peuples des ruelles confondus, "nègres" rescapés de l’esclavage antillais (7% de la population londonienne !). Des leaders tentent de structurer cette agitation qui leur échappe, part dans tous les sens, en conduisant la foule du matin, énorme, devant le Parlement. La Représentation Nationale se voit soudain sommée d’agir. Elle est encerclée, isolée, bousculée. On attend des élus des réponses, ils discourent et tergiversent comme à l’accoutumée, ou dénoncent la manipulation d’une foule "visiblement" peu politisée, enrôlée contre son gré dans une lutte dont elle comprend mal la finalité. Que veulent au juste ces loqueteux ? Rien, précisément. Rien, politiquement s’entend, ou plutôt non, ils veulent tout : abattre le Pouvoir et peut-être même, "Tout Pouvoir"…
Des foules dépenaillées parcourent la ville en tous sens, s’agrègent aux manifestations organisées sans trop savoir pourquoi. Pétitionnaires et peuples des ruelles confondus, "nègres" rescapés de l’esclavage antillais (7% de la population londonienne !). Des leaders tentent de structurer cette agitation qui leur échappe, part dans tous les sens, en conduisant la foule du matin, énorme, devant le Parlement. La Représentation Nationale se voit soudain sommée d’agir. Elle est encerclée, isolée, bousculée. On attend des élus des réponses, ils discourent et tergiversent comme à l’accoutumée, ou dénoncent la manipulation d’une foule "visiblement" peu politisée, enrôlée contre son gré dans une lutte dont elle comprend mal la finalité. Que veulent au juste ces loqueteux ? Rien, précisément. Rien, politiquement s’entend, ou plutôt non, ils veulent tout : abattre le Pouvoir et peut-être même, "Tout Pouvoir"…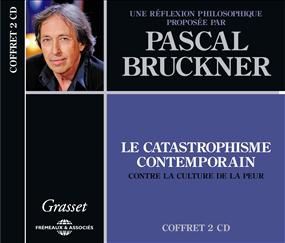 C’est ici l’écologie radicale qui est visée, celle qui aurait entraîné dans son sillage, selon Pascal Bruckner, l’explosion contemporaine de la pensée apocalyptique dans les pays riches. L’écologie, le seul mouvement authentique apparu ce dernier siècle, héritier du romantisme dans son rapport à la nature et dans sa tentative de réconcilier l’homme avec elle, aurait ainsi conduit à sacraliser cette nature au détriment de la sacralité de l’humain. Au point d’en faire l’ennemi, à nous expliquer qu’à moins d’un changement radical, nous serions entrés dans l’histoire de la fin des temps.
C’est ici l’écologie radicale qui est visée, celle qui aurait entraîné dans son sillage, selon Pascal Bruckner, l’explosion contemporaine de la pensée apocalyptique dans les pays riches. L’écologie, le seul mouvement authentique apparu ce dernier siècle, héritier du romantisme dans son rapport à la nature et dans sa tentative de réconcilier l’homme avec elle, aurait ainsi conduit à sacraliser cette nature au détriment de la sacralité de l’humain. Au point d’en faire l’ennemi, à nous expliquer qu’à moins d’un changement radical, nous serions entrés dans l’histoire de la fin des temps. Montchanin, Bourgoin-Jallieu, Romans-sur-isère… Jusque dans les années 90, 80 clubs français se disputaient le bouclier de Brennus. Désormais l’élite du rugby ne compte plus que 14 clubs, qui font du championnat français le plus relevé de la planète. En moins de 15 ans, le rugby a sauté un siècle et explosé tous les compteurs de «capitalisation»… Le tout sous les efforts conjugués d’une poignée de quadras, dont tout particulièrement Serge Blanco qui fut l’artisan majeur de cette transformation, les chaînes de télévision, Canal + en tête, les investisseurs internationaux et les politiques municipales, les villes étant devenues, selon l’heureuse mais terrible formule de Jean de Legge, des «entreprises de spectacles et de services»… En moins de quinze ans donc, on est passé d’une gestion de bénévoles à une gestion d‘entrepreneurs privés, au point que les grands stades sont devenus de grandes entreprises. Evidemment, cela n’a pas été sans conséquence sur l’esprit même du rugby, qui certes s’accroche encore à ces valeurs, de courage et de solidarité en tout premier lieu, mais déjà on sent bien monter dans ce rugby contemporain les égoïsmes, l’affairisme, l’afflux d’argent exacerbant typiquement des problèmes de riches : l’avidité et la lutte pour le pouvoir.
Montchanin, Bourgoin-Jallieu, Romans-sur-isère… Jusque dans les années 90, 80 clubs français se disputaient le bouclier de Brennus. Désormais l’élite du rugby ne compte plus que 14 clubs, qui font du championnat français le plus relevé de la planète. En moins de 15 ans, le rugby a sauté un siècle et explosé tous les compteurs de «capitalisation»… Le tout sous les efforts conjugués d’une poignée de quadras, dont tout particulièrement Serge Blanco qui fut l’artisan majeur de cette transformation, les chaînes de télévision, Canal + en tête, les investisseurs internationaux et les politiques municipales, les villes étant devenues, selon l’heureuse mais terrible formule de Jean de Legge, des «entreprises de spectacles et de services»… En moins de quinze ans donc, on est passé d’une gestion de bénévoles à une gestion d‘entrepreneurs privés, au point que les grands stades sont devenus de grandes entreprises. Evidemment, cela n’a pas été sans conséquence sur l’esprit même du rugby, qui certes s’accroche encore à ces valeurs, de courage et de solidarité en tout premier lieu, mais déjà on sent bien monter dans ce rugby contemporain les égoïsmes, l’affairisme, l’afflux d’argent exacerbant typiquement des problèmes de riches : l’avidité et la lutte pour le pouvoir. Deux normes fondamentales devraient toujours guider l’action des hommes politiques en charge du destin de la Nation : celle du respect égal des personnes, et celle d’un dialogue rationnel entre les hommes.
Deux normes fondamentales devraient toujours guider l’action des hommes politiques en charge du destin de la Nation : celle du respect égal des personnes, et celle d’un dialogue rationnel entre les hommes.