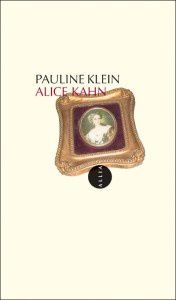 Le monde comme une image polie trônant sur la cheminée. La narratrice, spectatrice. Paris se dresse devant elle, crédible. Enfin, pas moins qu’elle. Tout comme les passants. Celui-ci. Ou celui-là. Celle-ci qui vient de s’arrêter pour planter ses yeux dans le regard étonné d’Anna. Mais elle, elle n’est pas Anna. Enfin, peut-être pas. Anna. Son rendez-vous : William. Alors la narratrice joue à être Anna, s’y conforme, ne bouge plus. Elle est Anna. A s’y méprendre. A quoi ressemble-t-on de toute façon ? Si bien que William n’y voit que du feu. Peut-être est-elle Anna, après tout. Qu’importe. Elle glisse dans la peau du personnage. William, lui, semble découvrir, ou redécouvrir, Anna. Son Anna. Mais la vraie Anna ? Qu’est-elle devenue ? Qu’importe. Pour l’heure, tenir le rôle. Laisser parler William : après tout, Anna est sa construction. Sa parole le dit assez. Et lui, il semble connaître son propre rôle. Elle, songe qu’il a dû répéter. Il la recouvre trop bien d’Anna. La fait entrer, sans reste ni excédent, dans l’image qu’il s’est forgée d’elle. Mais elle, elle entrevoit sous les mots qu’il profère des espaces où initier de nouveaux degrés de liberté pour ce personnage qu’il a trop bien écrit : "Je vaudrai mieux que son fantasme." Tandis qu’il parle pour combler sa description. Tandis que plus il parle, moins la vraie Anna lui manque. Il en rapièce les vides, même. Bien qu’il s’étonne, de loin en loin, de la physionomie de l’Anna qui lui fait face. Cette supposée Anna qui prend si bien en charge les ficelles qui animent son personnage.
Le monde comme une image polie trônant sur la cheminée. La narratrice, spectatrice. Paris se dresse devant elle, crédible. Enfin, pas moins qu’elle. Tout comme les passants. Celui-ci. Ou celui-là. Celle-ci qui vient de s’arrêter pour planter ses yeux dans le regard étonné d’Anna. Mais elle, elle n’est pas Anna. Enfin, peut-être pas. Anna. Son rendez-vous : William. Alors la narratrice joue à être Anna, s’y conforme, ne bouge plus. Elle est Anna. A s’y méprendre. A quoi ressemble-t-on de toute façon ? Si bien que William n’y voit que du feu. Peut-être est-elle Anna, après tout. Qu’importe. Elle glisse dans la peau du personnage. William, lui, semble découvrir, ou redécouvrir, Anna. Son Anna. Mais la vraie Anna ? Qu’est-elle devenue ? Qu’importe. Pour l’heure, tenir le rôle. Laisser parler William : après tout, Anna est sa construction. Sa parole le dit assez. Et lui, il semble connaître son propre rôle. Elle, songe qu’il a dû répéter. Il la recouvre trop bien d’Anna. La fait entrer, sans reste ni excédent, dans l’image qu’il s’est forgée d’elle. Mais elle, elle entrevoit sous les mots qu’il profère des espaces où initier de nouveaux degrés de liberté pour ce personnage qu’il a trop bien écrit : "Je vaudrai mieux que son fantasme." Tandis qu’il parle pour combler sa description. Tandis que plus il parle, moins la vraie Anna lui manque. Il en rapièce les vides, même. Bien qu’il s’étonne, de loin en loin, de la physionomie de l’Anna qui lui fait face. Cette supposée Anna qui prend si bien en charge les ficelles qui animent son personnage.
Retour à son rendez-vous. Retour à Anna. A William, qui est photographe. Il croit avoir développé un vrai regard sur les choses, les êtres et le monde. Tout cela parce qu’il est photographe. Artiste. Mais il ne voit pas qu’elle n’est pas Anna. Dont il a pourtant consigné une image, naguère. Qu’importe, ensemble, ils apprennent à se vivre. Lors d’un vernissage, la narratrice, pour faire bonne figure dans les conversations, s’invente une artiste d’elle seule connue : Alice Kahn. Qu’elle promène de soirée mondaine en soirée mondaine. Reprenant les mimiques, les tics, les manières de tous pour mieux leur ressembler. Rien de tel qu’un bon discours stéréotypé pour vous faire accepter. Ici et là, chacun attifé de son Moi Somptuaire, entretenu comme il le peut. Ce Moi somptuaire qui n’ouvre que l’horizon du conditionnel. Peut-être notre seul site désormais. Nous qui en sommes à raccommoder nos territoires, à recoudre nos images, à tenter de classer ce trop plein d’images qui fonde nos vies. Avant de redevenir invisible, comme la pseudo Anna. Qui finit par se fondre ailleurs. Demain une autre. Qu’importe William. Ou son contraire.
Et puis le récit tourne, s’ouvre à l’absente de leur propos : la narratrice. Ses souvenirs d’enfance. D’aussi loin qu’elle le peut. Depuis l’enfant qu’elle était et que nul ne remarquait jamais. Qu’on oubliait même, au propre. Jusqu’au jour où elle décida de se faire invisible, pour mieux imiter la vie. Invisible. Piochant dans les biographies des uns et des autres matières à exister. Son père par exemple, réinventé de toute pièce.
 Quelle lucidité, tout de même, dans ce personnage ! A décrypter les petites facéties par lesquelles nous tentons d’exister. Pourtant l’ensemble se tient comme sur le seuil d’un questionnement qui achoppe, ou ne sait se trouver. Qu’est-ce que se ressembler ? Un tel effort en vaudrait-il la peine ? On se prend, ici, à songer à Denys le Chartreux (mort en 1471), à convoquer ses textes sur ce même thème : la ressemblance. L’un des auteurs les plus lus du XVème au XVIIème siècle, aujourd’hui totalement ignoré. Denys, si peu à l’aise devant toute forme de manifestation du surnaturelle, reprenant à son compte ce grand genre littéraire du Moyen Age tombé ensuite en désuétude, celui du Miroir. Le Miroir ou l’impossible connaissance, malgré les arts du portrait, les techniques de description de soi. On se plait à songer, sur le même thème toujours, aux Miroirs de Vincent de Beauvais (1256), aux Miroirs exemplaires, aux Miroirs des Princes (Machiavel), voire au Miroir de l’âme pécheresse de Marguerite de Navarre (1531)…
Quelle lucidité, tout de même, dans ce personnage ! A décrypter les petites facéties par lesquelles nous tentons d’exister. Pourtant l’ensemble se tient comme sur le seuil d’un questionnement qui achoppe, ou ne sait se trouver. Qu’est-ce que se ressembler ? Un tel effort en vaudrait-il la peine ? On se prend, ici, à songer à Denys le Chartreux (mort en 1471), à convoquer ses textes sur ce même thème : la ressemblance. L’un des auteurs les plus lus du XVème au XVIIème siècle, aujourd’hui totalement ignoré. Denys, si peu à l’aise devant toute forme de manifestation du surnaturelle, reprenant à son compte ce grand genre littéraire du Moyen Age tombé ensuite en désuétude, celui du Miroir. Le Miroir ou l’impossible connaissance, malgré les arts du portrait, les techniques de description de soi. On se plait à songer, sur le même thème toujours, aux Miroirs de Vincent de Beauvais (1256), aux Miroirs exemplaires, aux Miroirs des Princes (Machiavel), voire au Miroir de l’âme pécheresse de Marguerite de Navarre (1531)…
Dans ses "Lunettes" -une autre appellation pour le même genre-, la rhétorique déployée par Denys le Chartreux épousait une forme parfaitement codifiée, au sein de laquelle les effets devaient se répondre, ainsi que les voix, multipliant en cascades les jeux de renvois soulignés par une écriture comme enroulée sur elle-même, monomaniaque et abusant d’échos de lectures, de dédoublements, le tout serti d’une réflexion profonde sur la nature humaine prise dans le drame de ses contradictions. L’homme s’y exposait en exilé, éternel pèlerin étranger à son propre monde. Cette étrangeté qui est précisément le lieu de l’écriture annoncé ici. L’homme, cette petite créature indicible, revêtue d’une beauté plus grande qu’elle n’en savait porter et trop souvent attaché à ses reflets et malgré cela, lui le mortel, fait plus qu’aucune autre créature terrestre pour le Vivant. Denys composait l’Imitation comme notre vraie condition. Dans son roman, Pauline Klein articule exclusivement l’imitation aux reflets de l’être. Chez Denys, cette imitation revêt une autre dimension, s’arrache à ces reflets dans l’étendue de la contemplation, prière pure et perfection de la charité -miséricorde pour l’homme dans son infinie petitesse. Un acte si complexe à force de simplicité. Son livre De Contemplatione (1440 – 1445), énorme bouquin jamais vraiment achevé, trace l’horizon de cette vie contemplative. Il ne papillonne pas, l’œil rivé sur quelque inaccessible, lieu le plus incomparable de l’être humain : là où sourdre en son amour, dans le démesuré de ce vaste monde. (Fundis ex dilectione).--joël jégouzo--.
Alice Kahn, de Pauline Klein, éditions Allia, août 2010, 126 pages, 6,10 euros, EAN : 978-2- 84485-355-4.
Denys Le Chartreux, Petit traité de la méditation, traduction nouvelle par Martial Tecxidor, asin : B00185EN40.



 "Une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde." Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme.
"Une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde." Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme. Le fin mot de cette séquence de pouvoir sera sans doute celui de la médiocrité de son héros, fort de succès obtenus sur des moribonds (cette Gauche qui avait tant trahi), et de victoires arrachées d’un sûr instinct politique, celui du vautour plutôt que de l’aigle.
Le fin mot de cette séquence de pouvoir sera sans doute celui de la médiocrité de son héros, fort de succès obtenus sur des moribonds (cette Gauche qui avait tant trahi), et de victoires arrachées d’un sûr instinct politique, celui du vautour plutôt que de l’aigle. La violence qui pèse ainsi sur le monde du travail n’est plus celle de patrons aux allures fordiennes –ceux-là sont eux-mêmes soumis aux pressions des marchés financiers-, mais celle de la finance, coupées des réalités du monde. La crainte s’est non seulement généralisée, mais intensifiée avec la montée en puissance de ce pouvoir financier.
La violence qui pèse ainsi sur le monde du travail n’est plus celle de patrons aux allures fordiennes –ceux-là sont eux-mêmes soumis aux pressions des marchés financiers-, mais celle de la finance, coupées des réalités du monde. La crainte s’est non seulement généralisée, mais intensifiée avec la montée en puissance de ce pouvoir financier. La vulgarité présidentielle ne traduit ainsi rien d’autre que ce nouveau rapport de force, au sein duquel vient d’émerger un Capitalisme Financier triomphant. Elle n’est rien d’autre que l’expression d’une permissivité sans précédent qui s’est forgée dans la conscience de ces nouveaux capitalistes. L’ivresse dont elle témoigne, son pathétisme vulgaire, n’est l’expression que d’un délire de l’illimité. Tout est possible. Et son représentant légal peut même courir le risque de l’opprobre, pratiquer l’insulte et la menace à découvert : cette radicalisation du gouvernement actionnarial par la crainte est sans précédent dans notre histoire et lui assure l'impunité.
La vulgarité présidentielle ne traduit ainsi rien d’autre que ce nouveau rapport de force, au sein duquel vient d’émerger un Capitalisme Financier triomphant. Elle n’est rien d’autre que l’expression d’une permissivité sans précédent qui s’est forgée dans la conscience de ces nouveaux capitalistes. L’ivresse dont elle témoigne, son pathétisme vulgaire, n’est l’expression que d’un délire de l’illimité. Tout est possible. Et son représentant légal peut même courir le risque de l’opprobre, pratiquer l’insulte et la menace à découvert : cette radicalisation du gouvernement actionnarial par la crainte est sans précédent dans notre histoire et lui assure l'impunité. L’année du jubilé royal. Celle, aussi, de l’éventreur du Yorkshire, un vrai God’s playground, terrain de jeu sauvage où s’affrontent la police, les journalistes, les truands, le tueur et mille autres démons médiocres – d’autant plus féroces donc. Une grande débâcle en somme, en folles parties de cache-cache dans les rues de Leeds. Au delà de l'histoire, au delà de l'intrigue, au delà des personnages même, un univers glauque où la fange le dispute à l’ignominie, servi par une écriture de pure dénotation qui, de contractions brutales en phrases arides, assène des séquences discursives d’une violence inouïe. Une grande débâcle narrative en quelque sorte : David Peace déserte les conventions d’écriture et par sa double narration, ses contrepoints, ses ruptures, nous projette de plain-pied dans l’Histoire telle que nous l’éprouvons désormais, erratique, indéchiffrable.
L’année du jubilé royal. Celle, aussi, de l’éventreur du Yorkshire, un vrai God’s playground, terrain de jeu sauvage où s’affrontent la police, les journalistes, les truands, le tueur et mille autres démons médiocres – d’autant plus féroces donc. Une grande débâcle en somme, en folles parties de cache-cache dans les rues de Leeds. Au delà de l'histoire, au delà de l'intrigue, au delà des personnages même, un univers glauque où la fange le dispute à l’ignominie, servi par une écriture de pure dénotation qui, de contractions brutales en phrases arides, assène des séquences discursives d’une violence inouïe. Une grande débâcle narrative en quelque sorte : David Peace déserte les conventions d’écriture et par sa double narration, ses contrepoints, ses ruptures, nous projette de plain-pied dans l’Histoire telle que nous l’éprouvons désormais, erratique, indéchiffrable.
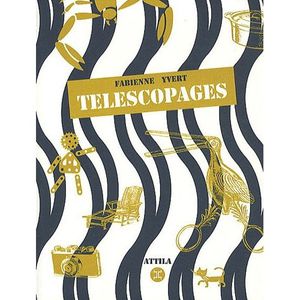 Une boîte de vingt centimètres de profondeur. Remplie de fiches cartonnées. De 1972 à 2002, Fabienne Yvert a rédigé des fiches recto-verso, inventaire de ses désirs, des attraits abandonnés ici ou là aux gestes qui venaient, réflexions diverses, apostrophes, notes en vrac. Des fiches qu’elle envoyait à des abonnés. Du bouche à oreille. Une littérature du couvert, carnet de route, à peine un journal de bord, du bord d’une vie que l’on pousse comme l’on peut. Comment articuler le monde aujourd’hui ? C’est un peu à cela que ces fiches nous convoquent. Situations, sensations. Une boîte de vingt centimètres de profondeur. Tous les mois, Fabienne envoyait ses fiches, imprimées à cent exemplaires, à près de quarante abonnés. Quand le boîte fut pleine, elle arrêta. Voici les fiches aujourd’hui réassignées, dans une chronologie souvent déroutante. Boîte à malice, à merveilles, "il y a des manques de désaffection propres et claires sur les étagères". Un peu l’esprit du temps dont on n’a rien vu venir. Sciemment de trop. Les amis, les voisins, les parents, des proches morts déjà –c’est effarant combien la mort frappe vite et aussi médiocrement. Le jardin, la vie douce et peut-être au fond une conception de la vie Bonne qui surgit au détour des phrases, sagesse à la Sénèque. Discernement, de savoir si bien ne pas attendre l’effondrement, lequel survient toujours trop tôt, dans l’étonnement d’un jour qui n’en finit pas de vouloir si mal tourner la page quand sans arrêt on apprend à vivre, encore et encore, avec de nouveau quelqu’un et l’autre sans cesse, même à seulement suivre la course du soleil ou celle du chat vers le garage ou cette drôle d’affaire : le monde qui tourne. Je regrette de n’avoir pas connu les fiches du temps où elles atterrissaient d’abord au fond de la boîte. Ici désormais c’est autre chose. Un effort s’impose, pour contourner cette présence de l’objet livre, pour laisser vivre, à l’intérieur de soi, une aventure d’avant le livre. Donner des chances à l’encore du monde, plutôt que son encours.
Une boîte de vingt centimètres de profondeur. Remplie de fiches cartonnées. De 1972 à 2002, Fabienne Yvert a rédigé des fiches recto-verso, inventaire de ses désirs, des attraits abandonnés ici ou là aux gestes qui venaient, réflexions diverses, apostrophes, notes en vrac. Des fiches qu’elle envoyait à des abonnés. Du bouche à oreille. Une littérature du couvert, carnet de route, à peine un journal de bord, du bord d’une vie que l’on pousse comme l’on peut. Comment articuler le monde aujourd’hui ? C’est un peu à cela que ces fiches nous convoquent. Situations, sensations. Une boîte de vingt centimètres de profondeur. Tous les mois, Fabienne envoyait ses fiches, imprimées à cent exemplaires, à près de quarante abonnés. Quand le boîte fut pleine, elle arrêta. Voici les fiches aujourd’hui réassignées, dans une chronologie souvent déroutante. Boîte à malice, à merveilles, "il y a des manques de désaffection propres et claires sur les étagères". Un peu l’esprit du temps dont on n’a rien vu venir. Sciemment de trop. Les amis, les voisins, les parents, des proches morts déjà –c’est effarant combien la mort frappe vite et aussi médiocrement. Le jardin, la vie douce et peut-être au fond une conception de la vie Bonne qui surgit au détour des phrases, sagesse à la Sénèque. Discernement, de savoir si bien ne pas attendre l’effondrement, lequel survient toujours trop tôt, dans l’étonnement d’un jour qui n’en finit pas de vouloir si mal tourner la page quand sans arrêt on apprend à vivre, encore et encore, avec de nouveau quelqu’un et l’autre sans cesse, même à seulement suivre la course du soleil ou celle du chat vers le garage ou cette drôle d’affaire : le monde qui tourne. Je regrette de n’avoir pas connu les fiches du temps où elles atterrissaient d’abord au fond de la boîte. Ici désormais c’est autre chose. Un effort s’impose, pour contourner cette présence de l’objet livre, pour laisser vivre, à l’intérieur de soi, une aventure d’avant le livre. Donner des chances à l’encore du monde, plutôt que son encours. "Je donne une interview pour la télévision française. Le journaliste commence très fort. "Vous, les gitans, vous êtes des voleurs." Je lui demande s’il est français. Il me dit que oui. Je lui dis : "Vous les français, vous avez volé la moitié de l’Afrique. Curieusement, on ne dit jamais que vous êtes des voleurs".
"Je donne une interview pour la télévision française. Le journaliste commence très fort. "Vous, les gitans, vous êtes des voleurs." Je lui demande s’il est français. Il me dit que oui. Je lui dis : "Vous les français, vous avez volé la moitié de l’Afrique. Curieusement, on ne dit jamais que vous êtes des voleurs". Troisième volet de l’autobiographie fictive de Coetzee, confiée ici à un jeune universitaire chargé de collecter des témoignages sur l’auteur qui atteint la trentaine et fait retour au pays natal, retrouvant son père vieillissant dans sa maison délabrée du Cap. Nous sommes dans les années 70. Les menaces se sont accumulées aux frontières, tandis que la situation intérieure s’est délitée un peu plus. Des extrémistes tentent d’entretenir la flamme de la civilisation occidentale à coups de discours sécuritaires fanatiques. Certes, l’Etat sécuritaire prend ici sa tournure la plus obsédante. Mais déjà en pure perte : il n’existe pas d’Etat qui puisse se faire durablement sécuritaire. Il n’y a que des discours fielleux dont le seul vrai objet, dissèque avec son talent habituel Coetzee, est d’attiser les haines. Les harangues des blancs s’exhibent ainsi comme un bluff meurtrier tarissant les forces vives de la nation. Et ceux qui voudraient mener la police comme un chasseur sa meute, finissent dans un show minable leurs gesticulations abjectes –on en sait quelque chose en France.
Troisième volet de l’autobiographie fictive de Coetzee, confiée ici à un jeune universitaire chargé de collecter des témoignages sur l’auteur qui atteint la trentaine et fait retour au pays natal, retrouvant son père vieillissant dans sa maison délabrée du Cap. Nous sommes dans les années 70. Les menaces se sont accumulées aux frontières, tandis que la situation intérieure s’est délitée un peu plus. Des extrémistes tentent d’entretenir la flamme de la civilisation occidentale à coups de discours sécuritaires fanatiques. Certes, l’Etat sécuritaire prend ici sa tournure la plus obsédante. Mais déjà en pure perte : il n’existe pas d’Etat qui puisse se faire durablement sécuritaire. Il n’y a que des discours fielleux dont le seul vrai objet, dissèque avec son talent habituel Coetzee, est d’attiser les haines. Les harangues des blancs s’exhibent ainsi comme un bluff meurtrier tarissant les forces vives de la nation. Et ceux qui voudraient mener la police comme un chasseur sa meute, finissent dans un show minable leurs gesticulations abjectes –on en sait quelque chose en France. "De la chair et du sang qui s’accumulent jusqu’à former une montagne de haine dressée toujours plus haute tous les jours plus haute devant nos yeux. Quand, mais quand donc chasserons-nous ces hordes assoiffées de sang de nos terres?" Dang Thuy Trâm
"De la chair et du sang qui s’accumulent jusqu’à former une montagne de haine dressée toujours plus haute tous les jours plus haute devant nos yeux. Quand, mais quand donc chasserons-nous ces hordes assoiffées de sang de nos terres?" Dang Thuy Trâm Un recueil de contes et légendes tirées semble-t-il de la collection de textes rroms établie par Heinrich von Wislocki qui, au détour d’un voyage à travers la Hongrie, en 1883, décida de consigner tout ce qu’il pouvait recueillir des traces orales d’un peuple qu’il découvrait avec passion. Dès 1888, une société américaine, la Gypsy Lore Society, se mit à publier ces textes traduits du rromani, en langue anglaise. La sélection que nous présentent les éditions Flies couvre un vaste périmètre, avec tout de même pour cœur de ce corpus les textes en provenance d’Europe Centrale. Un corpus organisé selon une thématique plutôt disparate, ouvrant aux cosmogonies rroms et rabattant malheureusement l’ensemble sur le prétendu emblématique thème du violon, dont on a vu par ailleurs qu’il n’offrait que des occurrences mineures dans l’ensemble de la littérature rrom –il fallait sans doute sacrifier à l’attente d’un public convaincu du contraire… On y trouve en tout cas un rayonnant conte sur l’origine des hommes «blonds», à mille lieux de tout ostracisme supposé, et une belle leçon sur les raisons de cette vie si courte accordée aux hommes: Dieu, agacé de voir l’Homme éternellement insatisfait alors qu’il se proposait de lui accorder deux vies plutôt qu’une, ramena les comptes à une seule vie, convaincu que mille n’auraient de toute façon pas réussi à combler le désert d’ennui dans lequel il entendait vivre. Sage. Très sage…–
Un recueil de contes et légendes tirées semble-t-il de la collection de textes rroms établie par Heinrich von Wislocki qui, au détour d’un voyage à travers la Hongrie, en 1883, décida de consigner tout ce qu’il pouvait recueillir des traces orales d’un peuple qu’il découvrait avec passion. Dès 1888, une société américaine, la Gypsy Lore Society, se mit à publier ces textes traduits du rromani, en langue anglaise. La sélection que nous présentent les éditions Flies couvre un vaste périmètre, avec tout de même pour cœur de ce corpus les textes en provenance d’Europe Centrale. Un corpus organisé selon une thématique plutôt disparate, ouvrant aux cosmogonies rroms et rabattant malheureusement l’ensemble sur le prétendu emblématique thème du violon, dont on a vu par ailleurs qu’il n’offrait que des occurrences mineures dans l’ensemble de la littérature rrom –il fallait sans doute sacrifier à l’attente d’un public convaincu du contraire… On y trouve en tout cas un rayonnant conte sur l’origine des hommes «blonds», à mille lieux de tout ostracisme supposé, et une belle leçon sur les raisons de cette vie si courte accordée aux hommes: Dieu, agacé de voir l’Homme éternellement insatisfait alors qu’il se proposait de lui accorder deux vies plutôt qu’une, ramena les comptes à une seule vie, convaincu que mille n’auraient de toute façon pas réussi à combler le désert d’ennui dans lequel il entendait vivre. Sage. Très sage…– "Il y a une guerre de classes, c’est un fait, mais c’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner." Warren Buffet, l’une des plus grosses fortunes du monde, CNN, 25 mai 2005.
"Il y a une guerre de classes, c’est un fait, mais c’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner." Warren Buffet, l’une des plus grosses fortunes du monde, CNN, 25 mai 2005.