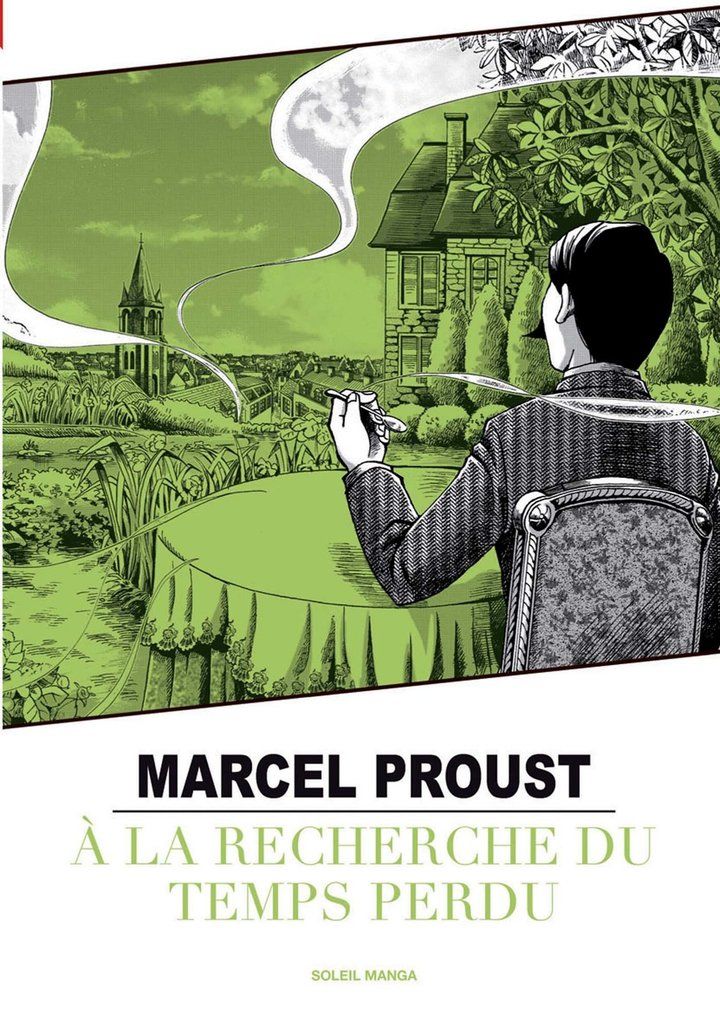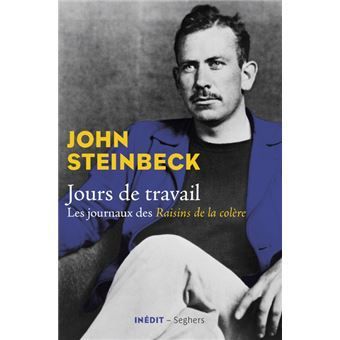Nous avons tout perdu. Autant fuir, s’en aller, déserter cette société sans issue que le capitalisme nous a fait, « vers le silence caché, dans l’illusion du monde »... Eli a filé. Quelque part dans le Cantal. Loin de tout donc. Il y vit un peu comme le dernier des hommes. Comme il y a eu un dernier léopard d’Egypte.
Dans une vieille ferme un feu se déclare. Le capitaine Laurentin en est saisi. Un feu dans les gorges de la Brune, c’est tout ce qu’il reste de l’humanité : l’incendie d’une ruine et l’image d’un homme des bois perdu dans le Cantal, avec à ses trousses un officier de police solitaire, qui n’a pas envie de jouer au flic de service. Non : reste le poids d’une région où il faut être né pour en comprendre les détours. Reste des personnages exilés dans cet espace inhospitalier qui bientôt va vouloir expulser tout ce qui lui est étranger, comme un corps le ferait d’une greffe qui ne doit pas prendre. Dont Louise, qui a atterri ici dans une sorte d’envol pourri hors du nid familial, après son échec au concours d’une école d’art. Ici, où personne ne va plus nulle part. Ici, le Grand Central, massif. Louise, Eli, Laurentin s’y sont égarés, plus qu’ils n’y sont installés. Par quel bout prendre la vie désormais ? Partout autour d’eux, des hameaux dépeuplés, le lourd silence abandonné. L’incendiaire est récupéré, soigné, caché. Lison vient d’enterrer son homme, il lui faut lui survivre à présent, là, dans ce pays relégué, en périphérie de tout. Qui est le sien pourtant. Eli, Andrew, Fiona… Des étrangers, le Cézallier au loin. Sans espoir, sinon de carte postale. Ce qui ne sert à rien ici, où le deuil règne en maître. Jamais déposé. Toujours renouvelé. Toujours renouvelable : l’incendiaire inquiète. Rassemble. Les pays s’organisent : un rôdeur hante le Cantal, menace ses us, ses coutumes. Le peu qu’il leur reste, ils ne veulent pas le voir s’effondrer. Laurentin reçoit un avis de recherche. Il y a un dossier à la préfecture sur Eli. Plus ou moins réfugié syrien. Une menace. Laurentin s’en fiche, tout comme il bat froid le préfet descendu à la hâte dans ces contrées perdues parce qu’un tag venait d’y apparaître : ACAB. Cela mérite battue, que l’on s’arme. On redoute une ZAD, on redoute des actes de survie : au sommet d’une colline, un ou des êtres humains n’ont-ils pas écrit : «APACHES»… La République prend peur, les pays prennent peur. Partout l’inquiétude gronde, s’arme de ces vieilles pétoires que l’on déterre de la guerre de 39-45. Assez pour s’entretuer. Une guerre se joue désormais. On se rappelle combien on se haïssait déjà, du temps des grands-parents, voire de plus loin encore. Premier roman instruit par une écriture superbe, où les femmes surgissent telles des figures de tragédies dans ce monde clos, géographie au front bas dictant ses affres sans concession.
Alexandre Lenot, Ecorces vives, Actes Sud, collection Actes noirs, octobre 2018, 204 pages, ean : 9782330113766.